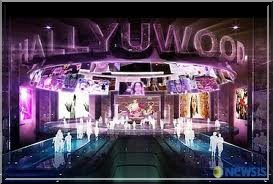Le cinéma coréen (et au-delà la culture de la Corée du Sud) connaissent un fort engouement dans bien des pays dont la France. Forte d’une génération dorée de cinéastes méconnus et pourtant de grand talent, l’industrie cinématographique Hallyuwood pourrait bien conquérir le monde. Que révèlent le cinéma coréen et son industrie florissante sur la Corée du Sud? Comment le cinémacoréen, soumis à la censure, a-t-il été condamné (pour le meilleur) à être toujours plus créatif? Que véhicule-t-il comme valeurs, messages ou visions de la société? Comment la démocratie en Corée du Sud a-t-elle fait émerger une génération dorée de cinéastes méconnus pour beaucoup et pourtant bourrés de talent? Cette culture sud coréenne pourrait-elle un jour détrôner l’industrie d’Hollywood?
Je peux déterminer avec précision les origines de mon intérêt pour la culture sud-coréenne. C’est Pascal Dayez-Burgeon, par ses écrits, qui m’a véritablement initié à elle. Cet ancien diplomate, par ailleurs agrégé d’histoire, est un familier de la péninsule : il y a été en poste de 2001 à 2006. Dans Les Coréens, il dépeint avec talent une nation dynamique, créative, sensible à la préservation des liens familiaux, attachée aux valeurs du travail et de l’apprentissage. Il y évoque un développement fulgurant, une technologie en progression constante et des villes ultramodernes – Séoul étant en outre l’une des mégapoles les plus peuplées du monde. Pourtant, rien ne prédestinait le pays à l’essor économique qu’il connaît depuis les années 1980. Ravagé par la guerre, menacé par la famine, étouffé par un pouvoir autoritaire, il a longtemps fait partie des miséreux de ce monde. Mais, en optant pour la transition démocratique, à partir de 1987, et le libéralisme, il s’est structurellement réformé, trustant même désormais les premières places de tous les classements internationaux. Un pied de nez à l’Histoire. Et l’insolente réussite des chaebols, ces géants nationaux parmi lesquels LG, Samsung ou Hyundai se distinguent, témoigne d’un savoir-faire indéniable et d’une volonté farouche d’aller de l’avant. Dans nos économies mondialisées hautement concurrentielles, Séoul, toujours redoutable, aspire à se tailler la part du lion. Et semble s’en approcher.
Si mon intérêt pour l’art coréen, et le cinéma plus particulièrement, peut s’apparenter à une passion tardive, j’ai par contre toujours été fasciné par l’histoire de la péninsule. Les rapports orageux qu’entretiennent le Nord et le Sud, séparés par la frontière la plus militarisée du monde, font depuis plusieurs décennies partie des grands enjeux géopolitiques. La dictature communiste dynastique du Nord tranche nettement avec le régime adopté par son voisin du Sud, ouvert et bouillonnant d’idées. Par ailleurs, la colonisation japonaise au début du XXe siècle s’est révélée lourde de conséquences : elle nourrit encore aujourd’hui une rancœur féroce des colonisés envers leurs anciens bourreaux. Les crises entourant les îles Dokdo, que Japonais et Sud-Coréens se disputent inlassablement, ou les polémiques au sujet des « femmes de réconfort » en témoignent largement. Enfin, la guerre de Corée (1950-1953) a dramatiquement mis en exergue les jeux d’influence qui opposaient le monde libre et le bloc communiste durant la Guerre froide. Elle a surtout eu des répercussions colossales sur l’évolution économique, démographique et diplomatique des deux jeunes nations coréennes.
Hallyu : quand la culture sud-coréenne crée l’engouement
En Corée, les auteurs Ko Un et Hwang Sok-yong sont, à juste titre, considérés comme des héros nationaux. Et leur faible rayonnement mondial indigne bon nombre de leurs compatriotes. Si certains veulent y voir le signe d’une nation complexée, cela résulte plus probablement d’une insatiable volonté de briller à l’étranger.
En réalité, les artistes sud-coréens sont loin de faire pâle figure face aux standards internationaux. Partout, le public découvre avec délectation leur travail, singulier, prolifique, souvent outrancier, parfois grave. Et l’industrie cinématographique nationale pourrait parfaitement symboliser ce nouvel engouement. Quantitativement dominée par Bollywood (Inde) ou Nollywood (Nigéria), la péninsule se trouve en revanche régulièrement au coude à coude avec Hollywood en ce qui concerne la qualité des œuvres produites. N’ayant plus rien à envier aux Européens, la Corée du Sud se hisse désormais au niveau du Japon, de la Chine ou de l’Indonésie, les leaders asiatiques du secteur. Et accroît, en conséquence, son influence culturelle en Extrême-Orient. Mais pas seulement, puisque ses réalisateurs accumulent les récompenses dans les grands festivals et élargissent progressivement leur public. Ainsi, une chose paraît certaine : la hallyu – la vague culturelle sud-coréenne – n’a pas fini de faire parler d’elle.
Pour contourner la censure : la créativité
En 2003, alors que le public occidental se familiarise chaque jour un peu plus avec le cinéma sud-coréen, Old Boy tient le haut du pavé. L’œuvre de Park Chan-wook renvoie en filigrane aux pires années de la dictature militaire. Par l’isolement forcé de son personnage principal, le réalisateur évoque indirectement l’époque où la péninsule était coupée du monde, une période noire s’étendant du début des années 1960 à la fin de la décennie 1980. Une métaphore à peine voilée du régime établi par le général Park Chung-hee.
Avec ce pouvoir autoritaire nouvellement installé, se révélant parfois presque paranoïaque, les cinéastes sud-coréens subissent de plein fouet une censure implacable. Encouragés par le gouvernement pour leur influence sur la société, les films de propagande ont alors pignon sur rue. Et les réalisateurs peinent à traiter les sujets considérés comme sensibles par les autorités ; ils doivent par conséquent se contenter de thèmes « officiellement acceptables ». L’anticommunisme, le rejet de la Corée du Nord ou encore l’apologie de la dictature de Park Chung-hee se trouvent sous le feu des projecteurs. Lee Man-hee, grand cinéaste des années 1960, sera même arrêté pour avoir offert au public des soldats du Nord un peu trop humains.
Mais, en dépit de ces considérations politiques, les cinéastes sud-coréens parviendront à contourner les obstacles et créer des œuvres fortes. Car la censure décuple paradoxalement leur créativité : ils doivent faire preuve d’ingéniosité afin de passer outre les consignes draconiennes d’un régime souvent aux abois, qui cherche à définir précisément les thématiques abordées et à calibrer strictement les messages véhiculés. Le film Iodo (1977), de Kim Ki-young, peut en témoigner. Alors que le pouvoir militaire amorce une industrialisation forcée du pays, Kim Ki-young inverse la tendance : il décide de porter son regard sur une île peuplée exclusivement de femmes, dont le quotidien dépend essentiellement de pratiques ancestrales. Traditions contre modernité. Quant à Night Journey (1977), drame érotique sans scènes de nu, il fait partie de ces films subversifs échappant à la vigilance des censeurs. Kim Soo-yong y met en scène une employée de banque vivant avec son patron. Le couple doit taire son amour pour éviter les commérages, tandis que l’héroïne doute quant à ses choix d’avenir. L’évocation limpide d’une Corée frustrée, incertaine, meurtrie par un régime autoritaire.
La dictature se montrait sévère à propos des contenus à caractère sexuel. Elle pouvait également exercer des pressions au moment de l’écriture ou du montage de films jugés trop sombres ou simplement contraires à ses intérêts. Les scènes coupées, les dialogues amputés et les séquences remodelées étaient alors monnaie courante. L’industrie cinématographique, que le pouvoir voulait à tout prix bâillonner, devait avant tout servir à soigner l’image de la péninsule. Pour éluder cette censure omniprésente, chaque cinéaste disposait de méthodes bien spécifiques. Yu Hyun-mok, qui réalisait essentiellement des films pour les autorités, allait au-delà des consignes officielles en introduisant par exemple des Nord-Coréens « humanisés ». Rainy Days, son long métrage sorti en 1979, le prouve amplement. S’intéressant à la guerre de Corée, le film se clôture par la réconciliation symbolique d’une famille divisée – grâce aux femmes. Régulièrement mises en scène dans les fictions de l’époque, ces dernières font souvent l’objet d’un traitement privilégié, permettant une critique indirecte du gouvernement. Ainsi, leurs sentiments reflètent l’état d’esprit d’une nation déprimée. Leurs doutes font écho à ceux de la société coréenne dans son ensemble.
Dans les faits, cette créativité, renforcée par la nécessité de combattre les nombreux tabous de la dictature, a contribué à l’émergence d’une élite nationale dans toutes les disciplines artistiques. Et la hallyu a progressivement pris le pas sur la culture américaine, pourtant prédominante depuis les années 1960.
La démocratie libère le cinéma sud-coréen
Il faudra attendre 1993 et la consécration de la démocratie pour que l’industrie cinématographique se libère de ses carcans. Cette année-là, Kim Young-sam décroche la présidence, succédant à Roh Tae-woo. Sous son mandat, la lutte anticorruption prend une ampleur considérable et l’on assiste à une tertiarisation soutenue de l’économie. Quant aux cinéastes, ils peuvent enfin se prévaloir d’une réelle indépendance artistique.
Les réalisateurs en profitent pour revenir sur les plaies encore béantes de la nation coréenne. Ils n’hésitent pas à aborder des sujets sensibles, trop longtemps passés sous silence. C’est ainsi que le très prolifique Im Kwon-taek, plus de cent films au compteur, critique l’occidentalisation brutale de la Corée dans La Chanteuse de pansori (1993). Dans Peppermint Candy (2000), Lee Chang-dong met quant à lui en scène la détresse d’un policier qui a réprimé les manifestations pro-démocratiques de Gwangju*. Un peu plus tard, Im Sang-soo propose The President’s Last Bang (2005), un drame politique narrant les dernières heures de Park Chung-hee. Le film provoquera une véritable polémique en Corée. Notons que bien d’autres œuvres engagées pourraient venir compléter le tableau.
Screen quotas, un moteur pour « Hallyu Wood »
Depuis 1993, la péninsule applique une politique volontariste pour encourager son industrie cinématographique : les screen quotas. Ceux-ci obligent dans un premier temps les salles de cinéma à projeter des œuvres nationales pendant au moins 146 jours par an. Favorisant les productions locales, les screen quotas ont néanmoins vu leur influence décroître depuis 2006 : suite à des accords commerciaux conclus avec les États-Unis, la Corée du Sud a diminué de moitié ses ambitions – pour finalement limiter les contraintes à 73 jours par an. Aux yeux de certains cinéastes, cette amputation drastique rend la mesure inopérante.
Quoi qu’il en soit, grâce aux screen quotas, la péninsule peut se targuer de posséder une industrie florissante, dynamique, exportant de plus en plus d’œuvres. Sans les effets salutaires de cette politique ambitieuse, nombre de films coréens n’auraient pas pu voir le jour, faute de financements. Car les quotas de diffusion réduisent les risques courus par les producteurs, puisqu’ils facilitent la rencontre entre l’œuvre et le public. Sans cela, les réalisateurs auraient sans doute dû réprimer leur audace et leur créativité pour se cantonner aux films « commerciaux », fédérateurs, voire consensuels, académiques et cousus de fil blanc.
La Corée à l’assaut du monde ?
En étudiant le cinéma sud-coréen, je dois avouer avoir été frappé par le haut degré d’expertise des techniciens de l’image, chefs opérateurs en tête. La photographie des œuvres issues de la péninsule se révèle souvent irréprochable. Il y a là, indéniablement, un travail minutieux autour de la composition des plans, des effets visuels inhérents à la lumière et du cadrage.
D’autre part, la manière dont l’industrie cinématographique s’est réinventée me paraît pour le moins intéressante. Après avoir traversé de nombreuses crises, elle façonne ses propres codes, transgressant parfois ceux des autres, pour mieux se démarquer. Aujourd’hui, la Corée du Sud regorge de réalisateurs clairement identifiables, suscitant l’enthousiasme du public dans les grands festivals. Si l’on s’en tient à la seule cinéphilie, elle semble prendre le dessus sur le Japon et la Chine.
Depuis l’avènement de la démocratie, la production de films explose littéralement. En avoisinant les 150 œuvres par an, pour un marché de 48 millions d’habitants et de 150 millions de spectateurs annuels, la péninsule ne cesse d’impressionner. En outre, les longs métrages locaux ont longtemps représenté plus de 50 % des entrées.
Depuis plusieurs années, le cinéma d’auteur sud-coréen séduit l’Occident. Avec des réalisateurs comme Lee Chang-dong, Hong Sang-soo ou Im Sang-soo, il ne manque pas de talents. Le contemplatif Kim Ki-duk se consacre quant à lui essentiellement à l’image, ses décors et sa mise en scène, offrant même quelques films presque muets. Il a par ailleurs renoué avec l’art du repérage dans le très poétique Printemps, été, automne, hiver… et printemps.
Le cinéma sud-coréen déborde de vitalité. Rarement dans l’histoire du septième art, on aura assisté à l’émergence d’autant de talents en si peu de temps. À n’en pas douter, une génération dorée commence à éclore. Et, parallèlement, l’industrie apprend à s’organiser : la KAFA (Korean Academy of Film Arts) constitue un inépuisable vivier, alors que le festival de Pusan, créé durant les années 1990, se pose en vitrine du cinéma national. Enfin, la Kofic, le CNC coréen, soutient financièrement et administrativement les projets les plus prometteurs.
Ceux qu’il faut garder à l’œil
Comment nier que l’avenir du septième art se joue, au moins partiellement, en Corée du Sud ? Pourquoi fermer les yeux sur cette génération dorée, audacieuse et pleinement décomplexée, qui multiplie les chefs-d’œuvre ? Même s’il me semble impossible de faire l’inventaire de tous les cinéastes à suivre – bien trop nombreux –, je peux m’avancer sur quelques noms, que chacun devrait s’efforcer de retenir.
Commençons par l’auteur de la trilogie de la vengeance, Park Chan-wook. Il s’affirme de plus en plus comme le Tarantino sud-coréen. L’esprit de ses productions renvoie clairement au metteur en scène de Kill Bill et Pulp Fiction. Ses films décalés – Je suis un cyborg ou Thirst – font état de sa griffe très singulière. Esthétiquement soignée, sa filmographie fait la part belle aux métaphores voilées et à une créativité visuelle débridée. Pour les cinéphiles sensibles à sa démarche, il fait figure de véritable institution. Comme lui, Bong Joon-ho, réalisateur et scénariste issu de la prestigieuse KAFA, sait exploiter habilement différents filons. Passant du thriller noir (Memories of Murder) au film fantastique (The Host), il développe des œuvres de grande qualité, souvent agrémentées d’un humour feutré qui ne parasite jamais le récit. Il fait indéniablement partie des meilleurs techniciens du pays et apprécie porter un regard ironique sur le monde. Depuis les 13 millions de spectateurs de The Host, il jouit d’une énorme popularité en Corée, tout en conservant un point de vue d’auteur, comme en témoigne le poignant Mother, où il s’attache à travailler sur la figure de la mère. Moins médiatique, mais tout aussi efficace, Lee Chang-dong multiplie les réussites : après Oasis et Secret Sunshine, le réalisateur de Peppermint Candy a mis en scène le superbe Poetry, un drame social bouleversant. Ancien romancier, proche de l’opposant historique Kim Dae-jung, il a été ministre de la Culture durant quelques mois. Revenant à ses amours cinématographiques, il remporte ensuite plusieurs prix à Cannes.
Dans un registre différent, on trouve Hong Sang-soo, qui se distingue par un style bien identifié. Ses personnages, ancrés dans la réalité, subissent des trahisons diverses, évoluent dans des univers guidés par l’amour, la haine ou la honte. Observateur avisé de la société sud-coréenne, le cinéaste dépeint des situations issues de la vie quotidienne, vécues par des individus souvent teintés d’absurdité et friands du spiritueux local, le soju. Matins calmes à Séoul pourrait symboliser sa filmographie : on y retrouve sa patte artistique et ses principaux ingrédients filmiques. Alors que Hong Sang-soo revisite la vie des Coréens, Im Sang-soo – encore un ancien élève de la KAFA – s’adonne quant à lui aux œuvres historiques. Cet ancien assistant d’Im Kwon-taek réalise ainsi The President’s Last Bang ou encore Le Vieux Jardin, reflet dramatique des manifestations de 1980 et de leurs conséquences indirectes, des contrecoups que subiront bon nombre de Coréens.
En réalité, dans un pays où les réalisateurs rayonnent davantage que les comédiens, l’industrie du cinéma regorge de talents plus ou moins connus. Pas étonnant dès lors que les œuvres nationales laminent la concurrence : hormis les États-Unis, les nations étrangères n’ont pas voix au chapitre. Au mieux, le Japon et la Chine récoltent quelques misérables parts de marché. Les Européens, eux, restent globalement inaudibles. Cela ne tient aucunement à une quelconque forme d’égocentrisme ou de patriotisme culturel.
Le meilleur facteur explicatif pourrait d’ailleurs se nommer Kim Ki-duk, maître de l’image parfaitement autodidacte, enchaînant les prouesses visuelles et narratives, aidé en cela par ses talents de scénariste. Car, c’est un fait, la Corée salue le talent de ses créateurs méritants en investissant en masse les salles de cinéma. Ajoutez à cela la politique des screen quotas et vous obtiendrez la clef du succès des productions de la péninsule. À mes yeux, Kim Ki-duk figure en tout cas parmi les meilleurs réalisateurs du monde. Le dramatique et engagé Samaria, le bluffant Locataires ou encore le superbe Printemps, été, automne, hiver… et printemps constituent autant de films remarquablement mis en scène. En dépit d’une carrière inégale – The Coast Guard ou Bad Guy n’ont pas l’aura des œuvres précitées –, le public averti scrute avec curiosité chacun de ses projets. Et, parmi les techniciens les plus brillants du pays, on peut également compter l’incomparable Kim Jee-woon. Ses films ont secoué le microcosme de la cinéphilie à plus d’une reprise. Citons les violents, mais néanmoins jubilatoires, A Bittersweet Life et J’ai rencontré le Diable. L’horrifique Deux sœurs détourne quant à lui un conte populaire pour mieux servir ses intérêts narratifs.
Plus généralement, je reste très attentif au parcours du jeune Na Hong-jin, dont les deux premiers films, The Chaser et The Murderer, figurent parmi les morceaux de choix du cinéma sud-coréen. L’action s’y avère percutante et haletante. Quant à Hwang Dong-hyuk, il signe selon moi l’un des plus grands drames sud-coréens, le saisissant Silenced, qui retrace l’histoire (vraie) d’enfants abusés au sein d’une école pour élèves sourds. Photographie impeccable, atmosphère oppressante, couleurs travaillées, le résultat se révèle captivant. Mais la comédie n’est pas en reste : My Sassy Girl, de Kwak Jae-yong, mélange habilement l’absurde et le réel, dessinant avec ironie la naissance d’une histoire d’amour. Sa fausse préquelle, Windstruck, du même réalisateur, s’avère moins efficace, mais toutefois réussie. Ma femme est un gangster, de Lim Jin-gyu, et sa suite, signée Jeong Heung-sun, parviennent également à faire mouche en dépit de faiblesses certaines. Le douteux Finding Mr. Destiny, de Jang Yu-jung, rappelle les ratés de la comédie occidentale, sans pour autant entamer le crédit de la scène comique sud-coréenne.
Dans un genre tout à fait différent, Kang Je-gyu propose un Frères de sang dont la densité thématique touche autant aux séquelles psychologiques des guerres qu’à leurs effets néfastes sur les liens humains. Il s’agit en outre d’une belle réflexion sur l’armée coréenne des années 1950. Le touchant Jiburo nous questionne quant à lui sur les attaches familiales et sur les conflits générationnels. Lee Jung-hyang déroule tranquillement son récit, imposant peu à peu ses enjeux. Enfin, il me faut également évoquer Champion, de Kwak Kyung-taek, l’histoire vraie d’un boxeur coréen ambitieux et adulé qui perdra la vie sur le ring. Le scénario met en exergue une carrière faite de sacrifices et d’illusions. Parmi les longs métrages à retenir, il y a également Fantasmes, de Jang Sun-woo, qui s’attache à observer les déviances sexuelles, ou Le Roi et le Clown, de Lee Jun-ik, œuvre inénarrable traitant de la Corée du 16ème siècle.
Concernant les thrillers, Princess Aurora tire son épingle du jeu par une narration rythmée, animée par l’idée de vengeance – décidément surexploitée par les cinéastes sud-coréens – et une image remarquable. Pang Eun-jin n’a rien à envier à Kim Hyeong-jun, qui signe No Mercy, l’histoire d’un médecin légiste participant à l’enquête visant à résoudre un meurtre et mis sous pression par le tueur en personne, qui tient sa fille en otage. On citera également le décalé Save the Green Planet !, de Jeong Jun-hwan, 2009 : Lost Memories, de Lee Si-myung, ou encore le conte horrifique Hansel et Gretel, de Yim Pil-sung, un autre grand technicien de l’image. Mais surtout, vous l’aurez compris, les médiocres Arahan, The Legend of Evil Lake, The Last Day, Duelist, Volcano High ou encore D-War ne doivent pas occulter l’immense richesse d’un cinéma encore méconnu par le grand public occidental.
Conclusion
Après l’essor économique amorcé sous Park Chung-hee, et tenant compte de la capacité de résilience de la Corée du Sud, notamment lors de la crise asiatique de 1997, Jim O’Neill verrait d’un bon œil l’intégration de la péninsule dans les BRICS – concept que l’économiste de Goldman Sachs a lui-même inventé. Nous n’y sommes pas encore, alors que l’on peut déjà consacrer le cinéma sud-coréen, l’un des plus prolifiques et audacieux du monde. Et s’il fallait réunir les émergents du septième art dans un même collectif, je parierais sur le leadership de la péninsule. Une sorte de Chine culturelle, en somme. Et, comme Pékin, Séoul pourrait un jour faire valoir son dynamisme et ses nombreux talents pour concurrencer la superpuissance américaine. Ce jour-là, « Hallyu Wood » détrônera peut-être Hollywood.
* Rappelons que ce soulèvement populaire, essentiellement syndical et étudiant, s’est soldé par des centaines de morts – les chiffres divergent fortement selon les sources. L’ambition initiale du mouvement consistait à dénoncer les excès du régime dictatorial de Chun Doo-hwan, mis en place après l’assassinat de Park Chung-hee en 1979, perpétré par Kim Chae-kyu, son ami de longue date, alors directeur du service central de renseignements (KCIA). Entre-temps, Choi Kyu-ha, ancien Premier ministre, prend très brièvement la tête du pays, avant d’être renversé par un coup d’état militaire.
Jonathan FANARA. Bachelier en communication, pigiste et membre du groupe Modus Vivendi, actif dans la composition musicale. Rédacteur du blog Jonathan Fanara.