Le roman populaire a ses lettres de noblesse, que l’on pense aux ‘Misérables’ du ViH ou aux ‘Mystères de Paris’ du père Eugène. ‘Les Déferlantes’ de Claudie Gallay sont de cette veine : il s’agit d’un bon roman populaire d’aujourd’hui dans lignée de Bernard Clavel.
Les ingrédients d’un tel succès sont :
• la longueur qui permet d’apprivoiser les personnages ;
• les chapitres courts qui apportent chacun quelque chose comme dans une intrigue policière ;
• un mystère qui peu à peu se dévoile (on comprend avant la fin mais ce n’est pas grave) ;
• un décor intemporel qui fait peur, au XIXè siècle « la ville », aujourd’hui « la campagne » – on n’a plus l’habitude de ce désert sentimental et relationnel ;
• les instincts, les passions et les idées qui surgissent comme toujours – mais se débattent dans les pauvres crânes limités des êtres.
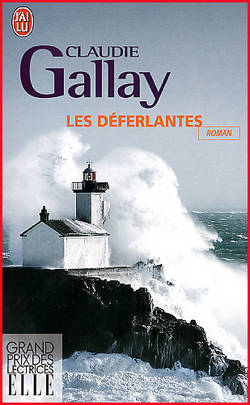
Durant la cicatrisation de l’écorchure de tôle, les événements vont bouleverser l’existence de tous avant de guérir eux aussi. L’auteur observe en éthologue la vie des bêtes, sa narratrice erre sur les falaises de la Hague en Cotentin pour compter les oiseaux. Cette position de base lui permet d’observer en ethnologue la vie des sales bêtes que sont les humains, hommes, femmes et enfants. Car nous sommes loin de l’idéalisme bobo du tout le monde il est beau et gentil : la campagne, c’est dur ; la mer, ça tue ; baiser, se haïr, s’aimer, c’est la nature. Les oiseaux, tous d’instinct, sont parfois plus humains que ces animaux que sont les hommes. Les chats donnent plus d’affection que les femmes ; les vaches vêlent mieux que les travailleuses et s’occupent mieux de leurs petits que les hommes…
Heureusement, les humains interagissent les uns sur les autres dans l’engrenage du mal comme du bien. C’est toute la société superstitieuse des campagnes qui a isolé Nan dans le deuil perpétuel, regardant d’un sale œil ses velléités de se lier ou de se marier. La société des campagnes, païenne, bêtasse et accrochée au qu’en-dira-t-on, a forgé un destin… Un jour de grand vent jadis, le phare s’est éteint et un voilier à chaviré. Seuls deux corps ont été repêchés, leur dernier enfant a disparu. Tout le monde sait pourquoi le phare s’est éteint et personne ne dit rien. Pas plus au frère survivant qui n’était pas parti en mer. La société est un destin, donc un non-dit. Personne ne réfléchit sur les conséquences, préférant se garder du regard des autres. Dès lors, le drame devient tragédie, écrite depuis les premiers temps du monde. La bêtise, l’inconscience, créent des événements qui s’enchaînent jusqu’à ce qu’une « crise » – ici la tempête – viennent dénouer les fils tendus au paroxysme. Nan la folle qui cherche toujours ses disparus reconnaît quelqu’un. Est-ce vraiment folie ? Et de fil en aiguille, la tapisserie s’anime. Jusqu’à l’apothéose finale, lentement mais habilement amenée.
Il y aura un dénouement. Il sera moral, il apaisera les malades et élèvera les gens vers une certaine spiritualité. C’est cela aussi qui fait un roman populaire, cette leçon que le destin peut se renverser sur l’initiative de quelques plus curieux ou plus courageux, ceux qui n’acceptent pas les choses telles qu’elles sont. Chapitres courts, très courts, langage direct et familier, très familier, sentiments au ras des tripes sans jamais s’étendre par peur de lasser ou par limitation intellectuelle des personnages – le roman est très bien fait. Réussi. Un bon roman populaire dont je me suis délecté !
Claudie Gallay, Les Déferlantes, 2008, poche J’ai lu mai 2010, 539 pages, 7.60€ – Grand prix des lectrices de ‘Elle’ !
