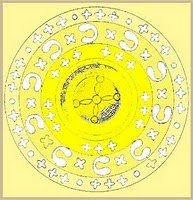 Une lune après la période solsticiale de Noël, voici venir la première grande fête celtique et européenne de l’année nouvelle. La Chandeleur, de festa Candelarum, est une fête catholique (purification de la Vierge et présentation de Jésus au Temple), au cours de laquelle, traditionnellement, les fidèles font bénir des chandelles et les rapportent dans leurs foyers. Bien entendu, cette pratique remonte à une antiquité pré-chrétienne et revêt une signification tout autre que celle que lui a attribué l’Eglise.
Une lune après la période solsticiale de Noël, voici venir la première grande fête celtique et européenne de l’année nouvelle. La Chandeleur, de festa Candelarum, est une fête catholique (purification de la Vierge et présentation de Jésus au Temple), au cours de laquelle, traditionnellement, les fidèles font bénir des chandelles et les rapportent dans leurs foyers. Bien entendu, cette pratique remonte à une antiquité pré-chrétienne et revêt une signification tout autre que celle que lui a attribué l’Eglise.

Cette fête de lumière marque tout d’abord le retour du soleil, à un moment de l’année où les jours se sont déjà sensiblement allongés. Elle est aussi un rite de passage, de purification, avant l’entrée définitive dans la nouvelle année, comme en témoigne le rite sauvage des Lupercalia à Rome (mi-février) : on sacrifiait un bouc dans la une grotte du Palatin réputée avoir recueilli Romulus et Rémus, puis des jeunes se livraient à une course autour de la colline, revêtus de dépouilles de capridés, et fouettant au passage les femmes en âges de procréer.
 Dans le monde celte, la Chandeleur correspond à la grande fête d’Imbolc (irlandais) ou Ambivollos (gaulois), lors de laquelle on célébrait la grande déesse Brigantia (stèle ci-contre), devenue Sainte Brigitte dans la tradition catholique (célébrée début février en Irlande). Imbolc aurait la signification de lustration (purification), et se rapporterait en particulier à des rites de protection des troupeaux, dont on attendait en particulier la fécondité pour l’année à venir. La fête serait donc une fête de la troisième fonction indo-européenne, comme sa parente des rives du Tibre. Très significativement, Brigantia est souvent surnommée la Brillante ou la Vachère.
Dans le monde celte, la Chandeleur correspond à la grande fête d’Imbolc (irlandais) ou Ambivollos (gaulois), lors de laquelle on célébrait la grande déesse Brigantia (stèle ci-contre), devenue Sainte Brigitte dans la tradition catholique (célébrée début février en Irlande). Imbolc aurait la signification de lustration (purification), et se rapporterait en particulier à des rites de protection des troupeaux, dont on attendait en particulier la fécondité pour l’année à venir. La fête serait donc une fête de la troisième fonction indo-européenne, comme sa parente des rives du Tibre. Très significativement, Brigantia est souvent surnommée la Brillante ou la Vachère.Nul doute que les Gaulois, dont on sait qu’ils affectionnent encore (et à fort juste titre) de préparer un repas de crêpes à la Chandeleur (image de la première lune de l’année), auront à coeur d’allumer quelques chandelles dans leurs foyers, à l’image de tous leurs ancêtres depuis des millénaires et en hommage à la course du soleil invaincu de la vieille Europe.
Les derniers articles par Patria Gallica (tout voir)
