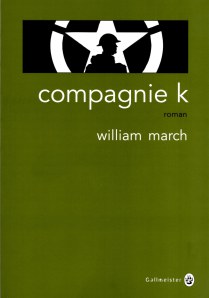
À l’approche du centenaire de la Première Guerre mondiale, pléthore de livres paraissent ou paraîtront dans les mois qui viennent. D’ores et déjà, il y en a un qui se détache de la masse. Il s’agit d’un roman américain publié en 1933 et qui, quatre-vingts ans plus tard, est édité pour la première fois en français par Gallmeister* : Compagnie K.
Son auteur, William March, est né le 18 septembre 1893 à Mobile, en Alabama. Il ne termina jamais ses études de droit et s’engagea en 1917 comme volontaire dans l’US Marine Corps. Il revint de la guerre avec trois décorations : la Croix de Guerre, la Navy Cross et la Distinguished Service Cross. Il en revint surtout traumatisé, comme en témoignèrent ses multiples accès de dépression après son retour à la vie civile. Une vie civile durant laquelle, parallèlement à sa carrière dans la finance, il rédigeait ses premières nouvelles. Et mit plus de dix ans pour réussir à coucher sur papier son expérience de la guerre relatée dans Compagnie K.
L’originalité du livre réside dans sa construction : il s’agit en fait d’une succession de petits textes, cent treize exactement, rédigés à la première personne et n’excédant pas parfois une page, correspondant au point de vue de chacun des cent treize hommes de la Compagnie K engagée dans le conflit. Le titre de chaque chapitre indique le nom et le prénom, éventuellement le grade, de celui qui s’y exprime, donnant ainsi une impression de réalisme. Les chapitres ressemblent en effet à d’authentiques témoignages de poilus. Il faut dire que beaucoup d’événements relatés dans le livre sont tirés d’expériences réelles vécues par William March. L’un des rares chapitres longs, celui consacré au soldat Manuel Burt, évoque le souvenir que March a souvent évoqué – mais est-il vrai ? – du jour où il a tué un jeune soldat allemand. La fiction se rappelle à nous quand ce sont des défunts qui parlent et se mettent à raconter leur mort, par exemple le soldat Christian Geils se faisant tirer dans le dos par son sergent alors qu’il s’enfuyait, ou le soldat Stephen Carroll tué par un obus avec deux autres de ses camarades.
La multitude des points de vue permet d’aborder une grande variété de situations, aussi bien liées à la vie quotidienne éprouvante – la faim, le manque de sommeil, la saleté, la folie dans certains cas… – qu’aux combats. Le soldat inconnu relate son agonie empêtré dans les barbelés ennemis, tandis que Silas Pullman raconte un assaut donné à une position allemande. Comme le dit le soldat Colin Urquhart, face à l’horreur de la guerre, « aucun homme ne réagit comme un autre ». Et c’est tout l’intérêt du livre de diversifier les points de vue : le lieutenant Jewett est rongé par le remords parce qu’il a envoyé quatre de ses hommes à la mort dans une mission vouée à l’échec ; le soldat Howard Bartow, ayant connu sa première expérience des tranchées, trouve ensuite mille et une astuces pour se trouver n’importe où sauf au front, afin de rentrer vivant chez lui ; le soldat Everett Qualls est hanté par sa participation à un massacre de prisonniers allemands ; le soldat Carroll Hart ne peut pas dormir parce qu’il a tué un soldat allemand en croyant qu’il allait se saisir d’une grenade alors qu’il cherchait simplement, dans sa veste, la photographie de sa fille ; et Robert Nalls a « honte pour l’humanité entière » parce que l’un de ses camarades a volé, chez un couple de Français, la médaille que leur fils mort au combat avait reçue à titre posthume.
Le livre montre à l’œuvre ce que l’historien George Mosse a appelé la « brutalisation » : comment les hommes, à l’épreuve de la guerre, sont transformés à tel point qu’ils acceptent la violence et y adhèrent, voire y prennent plaisir. C’est le sergent Mooney qui achève sans scrupule à coups de crosse de fusil et de baïonnette un blessé allemand. C’est aussi le sergent Tietjen qui, tel un chasseur, épie avec son fusil la tranchée ennemie et aime à réussir à toucher sa cible quand il y en a une qui se montre. Un goût pour la violence et l’agressivité qui se perpétue après la guerre, à l’image du discours du lieutenant Fairbrother, fraîchement réélu à la Chambre des représentants.
L’après-guerre : c’est aussi ce qu’évoque le roman de William March. Pour certains, tel Henry Demarest, c’est la joie simple d’avoir eu la chance de revenir vivant, malgré une jambe en moins. Mais le soldat Webster, lui, avec sa gueule cassée, se trouve confronté au dégoût de sa fiancée qui refuse de l’épouser en raison de sa laideur. Quant à Arthur Crenshaw, il exprime à sa façon le sentiment d’ingratitude que beaucoup de vétérans ont pu ressentir face à une société qui n’avait pas idée des sacrifices endurés pendant le conflit pour la « civilisation », leur pays et Dieu. D’ailleurs, pourquoi se sont-ils battus, les hommes de la Compagnie K ? « Pourquoi ? » : cette question terrible, c’est le soldat Leslie Yawfitz qui la soulève.
Les critiques saluèrent l’ouvrage à sa sortie en 1933, notamment en raison de sa méthode originale basée sur la présentation des différents points de vue. C’est la guerre vécue par les hommes qu’il nous est donné de lire dans Compagnie K. Le livre de March a souvent été comparé, d’ailleurs, avec le classique de Erich Maria Remarque paru quatre ans plus tôt, À l’ouest rien de nouveau qui relate aussi les horreurs de la Première Guerre mondiale endurées par un jeune soldat allemand et ses camarades. Allemands, Américains, Français, Anglais ou Autrichiens, tous les combattants ont subi les mêmes drames. C’est d’ailleurs ce qu’écrit William March dans Compagnie K, sous les traits du soldat Joseph Delaney : « Au début, ce livre devait raconter l’histoire de ma compagnie, mais ce n’est plus ce que je veux, maintenant. Je veux que ce soit une histoire de toutes les compagnies, de toutes les armées. […] Avec des noms différents et des décors différents, les hommes que j’ai évoqués pourraient tout aussi bien être français, allemands, anglais, ou russes d’ailleurs. »
Dans sa préface à la réédition américaine de 1989, le professeur de l’Université d’Alabama Philip Beidler a écrit que, pour March, l’écriture de Compagnie K était un « acte de courage formidable, équivalent ou plus grand que tout ce qui a pu lui valoir la Distinguished Service Cross, la Navy Cross ou la Croix de Guerre française ». La meilleure façon de récompenser ce courage serait de le lire.
.
.
* MARCH, William, Compagnie K, Paris, Gallmeister, « Americana », 2013, 230 p.
Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | RFID | Amazon Affiliate
Découvrez le Webzine d’histoire THUCYDIDE…
- Le Patrimoine en France entre histoire et identité - Sep 19, 2014
- Nazisme et révolution : le nazisme est-il un « centrisme » ou un socialisme ? - Mar 24, 2014
- Le baron de Batz, héros de « La Révolution fracassée » - Déc 5, 2013
