Le 22ème Festival international du photojournalisme est l’occasion de faire un peu de tourisme en Roussillon… et de partir à la découverte de Perpignan, la ville que Dali considérait comme le centre du monde et qui offre à l’occasion du festival un visa pour l’image…
Voilà un direct qui présente un peu de décalage. Le 22eme Festival international du photojournalisme a été inauguré il y a une semaine. Mais pour l’avoir vécu en direct pendant cinq jours, je suis resté sur l’impression qu’il m’avait retenu bien plus longtemps, au milieu de la foule qui a peu à peu envahi la ville de Perpignan, en passant crescendo de la file clairsemée de l’inauguration aux caravanes des journées professionnelles.
Partant d’un jeu de piste et lancé à corps perdu dans un labyrinthe, offert à ceux qui, comme moi, venaient y capturer des émotions autant que des informations mondiales saisies dans la chair et le souffle des hommes, je suis arrivé à participer de manière un peu marginale à une embrassade multinationale. Une foire aux images et aux contacts où les journalistes lauréats attirent les regards et se font prendre au piège de l’appareil photographique de leurs collègues, rendant par leur célébrité momentanée, un hommage à tous ceux qui ont traversé le miroir souvent mortel du terrain où ils travaillent. Témoins Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière dont les journées de détention s’accumulent sans que la France arrive à les retrouver.
Samedi et vendredi dernier, j‘ai joué au touriste. Et pour moi, c’est une vraie richesse. Rien ne me conviait là, sinon la curiosité que j’ai éprouvée l’an passé à la même époque en venant à Perpignan, pour de toutes autres raisons que la photographie. Rien, sinon la recommandation douce que des amis m’avait faite de ne pas manquer ce rendez-vous. Mais comme on le sait, j’ai raté bien d’autres rendez-vous festifs de l’été.
Pour une fois, j’ai eu du temps. J’ai pris du temps. J’ai pu jouir d’une visite à l’aveugle, ce qui pour un jeu photographique pris entre l’illusion, le mensonge et la vérité toute nue, est un luxe.
Première étape, la prise en compte d’une ville qui se déploie en se répandant sous l’abri que lui procure le Palais des Rois de Majorque. Un palais qui m’est apparu dans toute sa rudesse de pierres rondes alternées, de lignes brisées destinées à vaincre tous les assauts, avec l’impression maintenue pendant toute la visite que le sentiment de force qui est donnée aux assaillants potentiels se traduit tout autant à l’extérieur qu’à l’intérieur des murailles.
Les pièces, les couloirs, les escaliers sont eux aussi habités d’une force sourde à laquelle la mise en scène minimale d’un mobilier quasi inexistant permet de s’exprimer avec une plénitude de prison royale. N’étaient les concerts de guitare et l’hommage à Django Reinhardt pour la célébration des cent années de sa naissance, qui brouillent les pistes et attirent au soir tombé des milliers d’amateurs quasi religieux, je serais resté sur un profond sentiment de malaise.
Du haut de la tour, en tournant le dos au Canigou, on aperçoit à gauche le quartier gitan. En face la beauté étale du quartier commerçant qui s’étend du Castillet à la cathédrale Saint Jean et au Campo Santo. Et à droite enfin, le piège des rues qui s’entrelacent depuis le Couvent des Minimes et la Chapelle du Tiers Ordre, jusqu’à l’église Saint Jacques vers le haut, dans sa célébration d’un double culte et l’arsenal vers le bas, espace culturel établi dans les restes de l’ordre militaire.
Comme à Tunis, Alger ou pourquoi pas danscertains quartiers d’Istanbul, les hommes se prélassent dans la rue en laissant passer, entre les chaises lovées devant les portes et l’agitation ménagère des femmes, le flot des enfants.
Rien que du culturel, au milieu et entre les hommes, puisque les expositions ; une quarantaine officielles ainsi qu’une improbable et incalculable suite d’installations off sont célébrées dans certains de ces lieux découverts à vol d’oiseau. Des espaces à peine aménagés, sortis depuis peu de l’état de caserne, de celui de prison, de lieu de culte, d’entrepôt ou de cuisine collective, créant ainsi une sorte de sabbat mystique, plaquant le plus raffiné des portraits mortuaires de la misère du monde sur la lèpre des murs désertés.
De ces deux premiers jours du week-end qui ne m’ont pas permis d’épuiser l’ensemble des présentations, j’ai retenu le sentiment d’un plongeon dans le vide. Ou pour mieux dire, dans les remugles de l’émigration ordinaire, des attentes de Sangate, aux ensevelissements d’Haïti, des clochards du réseau souterrain des trains de New York aux pèlerins de Médine, des réprimés de Bangkok aux trafiquants colombiens et aux soldats civils de la camorra toute puissante.
Une accumulation de marges spatiales et temporelles pour de vrais marginaux, pour des armées en déroute fuyant les machettes et pour ceux que la violence des hommes et des catastrophes naturelles a projeté dans les débrisde la civilisation.
Que sont alors les photojournalistes, sinon ceux qui tournent autour de la misère, en attente permanente de cette espèce de bulle qui éclate, ici et là, parce qu’un président à décidé de montrer ses muscles ou qu’un ouragan a croisé la route des vivants à deux pattes ?
Et puis, à force de confrontations de talents, j’ai jeté mes yeux vides pour mieux regarder.
Des plus anciens comme William Klein fasciné par New York, Rome, Moscou et Tokyo des années cinquante et soixante, en passant par une génération intermédiaire de baroudeurs, comme Grégoire Korganow qui a échappé à la mort et présente dans son « Carnet d’urgence » le travail des gens du SAMU qui lui ont sauvé la vie, jusqu’aux plus jeunes comme Pietro Masturzo, petite barbiche et regard clair, qui est passé de la terre bouleversée d’Abruzzo aux toits de Téhéran où les femmes criaient la nuit leur révolte anonyme contre des élections truquées.
Dans la misère des cultures du monde, j’ai tenté de faire le départ entre la profusion des affrontements ordinaires vécus dans le vaste monde et ma recherche des images d’Europe. Ces dernières peu nombreuses, comme si nous vivions dans un continent apaisé et heureux. J’ai surtout appris à apprécier la découverte des miroirs brisés d’une ville multiculturelle où l’apaisement est revenu, justement, après la violence qui a jeté il y a cinq ans les Gitans contre les Maghrébins en faisant des morts.
Première étape. Première acclimatation.
En quelque sorte, je me suis apprivoisé.
La seconde mort de Tchernobyl

Dans le dispositif de Visa pour l’image, le Couvent des Minimes constitue le point principal de ralliement. Créé dans l’humilité d’une branche espagnole des disciples de Saint François, ce couvent accompagné d’une église est relié à la pente qui rejoint la paroisse saint Jacques, ou plutôt Sant Jaume pour respecter le nom catalan et vient historiquement se placer dans l’ancien quartier juif, ceci à la fin du XVIe siècle.



Un peu plus de quatre cents ans plus tard et son abandon après la révolution française, il en reste une suite d’espaces qui permettent sans aménagements excessifs de disposer des centaines de photographies où les auteurs dialoguent sans se nuire.
J’ai peur de n’avoir pas le temps de revenir sur l’ensemble des présentations. Mais est-ce le but ? J’ai beaucoup cherché à comprendre pourquoi l’Europe ne constituait qu’une partie un peu marginale des reportages. La réponse que j’ai donnée hier n’est certainement qu’un masque. Sous les assauts des migrations marocaine ou libyenne dont on connaît les répressions, dans la pente fascisante de l’invective permanente sur les Roms, ou bien dans l’agitation démesurée de quelques uns de nos dirigeant, pour ne pas parler des catastrophes naturelles, il y a certes matière à se glisser.
Mais le petit monde de Berlusconi pris dans ses bouffées mussoliniennes qui a été présenté lors de la projection du mercredi soir au Campo Santo, ressemble à une bien petite folie ordinaire en comparaison avec certaines images venues d’Afrique ou de Corée du nord, tandis que les images du Caucase qui se figent sur des maisons noircies par les bombes et sur des alignements de maisons bien peignées qui les ont remplacées pour y accueillir des réfugiés ossètes, mériteraient le contrepoint d’une analyse photographique du prix payé pour un retour rapide à la normalité.
Sage l’Europe ? Modérée ? Uniquement capable de forfanteries à a petite semaine ?
Le reportage de Guillaume Herbaut intitulé « L’or noir de Tchernobyl » nous dit tout autre chose. Bien sûr on se trouve situé dans ce cercle infernal qui renferme les mœurs d’un ancien grand empire du secret : l’Ukraine prise dans le drame permanent d’une glue qui contraint toute initiative politique à l’échec et la Biélorussie voisine dont la noirceur de l’horizon constitue un cauchemar permanent.
« Vingt-quatre ans après la catastrophe, les cimetières d’engins militaires et la centrale de Tchernobyl en Ukraine font l’objet d’un pillage en règle. Chaque semaine, près de deux cents tonnes de métal radioactif quittent la zone d’exclusion. Enquête sur le trafic de métaux contaminés de Tchernobyl. »
Telle est l’introduction de la présentation que l’on ne peut que qualifier d’effrayante. Effrayante parce que quotidienne, autrement dit banale. Une accumulation de radiateurs, des écrous par milliers, des carcasses d’hélicoptères, des fils de cuivre désossés, des barbelés recyclés, qui font penser à ceux que l’on récupère dans les débris d’Haïti.
Des hommes effondrés, attendant un autre jour, des hommes condamnés, comme l’ont été avant eux les habitants du cercle mortel et les pompiers qui ont payé le refroidissement de la centrale de leurs cellules irradiées.
Un trafic ordinaire. Une récupération qui ressemble à celle à laquelle se livraient les chiffonniers de mon enfance, ces tsiganes qui, à l’époque occupaient encore une fonction sociale en bonne entente avec ceux qu’ils désencombraient.
Et dans le vide laissé par le passage des pillards, les immeubles paraissent doublement blessés, fantômes de béton, images en creux d’autres fantômes, ces humains sacrifiés par le grand mensonge. Cette Europe là, celle des pays du Conseil de l’Europe qu’il m’arrive de parcourir vient – j’allais dire enfin tant mon attente était forte de rencontrer l‘image crue d’une Europe scandaleuse – faire effraction dans l’accumulation des scandales humains.
Comme si tout rentrait dans l’ordre. Comme si, de la Révolution de 1905 boutée contre les abus tsaristes, qui vient se déployer en 1917 en engendrant le monstre communiste, jusqu’aux exactions « civilisées », froides et cyniques de Poutine et de ses clones, venait aboutir à ces images sacrificielles que nous prenons dans la figure comme une punition des dieux.
Un photographe nous donne ainsi à toucher, le froid dans le dos, le triomphe de la Secte des Egoïstes !
Au fait, on a retrouvé récemment le métal radioactif en Italie.
Gali Tibbon : le sens du sacré
Gali Tibbon au travers de son exposition photos révèle le sens du sacré lors du Festival Visa pour l’image de Perpignan. Quand on choisit Jerusalem et qu’on évoque les croyants, les religieux et les religions, on ne peut évidemment pas ignorer les passions… Ces passions qui au nom du sacré justifient les heurts, les guerres, les oppositions millénaires…

Gali Tibbon tourne autour de Jérusalem. Il vit donc dans un monde où les heurts ne concernent pas que les mots.
Il était là où la guerre s’arrête, où la révolution commence, où les mains sont rouges de sang. Ses photographies regardent au plus près le mur des lamentations et les enfants révoltés. Elles embrassent autant les petits papiers glissés dans l’interstice des pierres que les pierres elles-mêmes quand elles volent pendant l’intifada. Et il sait créer le dialogue visuel entre le mur sacré qui recueille les murmures et le mur infamant, celui qui enferme les Palestiniens.



Et puis, c’est un habitué des larmes. Quand un enfant meurt ou qu’un autobus explose, une image se dessine. Se fait-il, par lassitude, à la fréquentation de ces cercles brisés ?
Les photographies présentées à Perpignan n’en sont donc que plus émouvantes. « Echos de la Jérusalem chrétienne » pénètre dans les ombres du Saint-Sépulcre là où une autre crucifixion a eu lieu, au bout d’un autre itinéraire : la Via dolorosa, à la naissance de la chrétienté. Là où la communion prendtout son sens, même si les différences s’affirment.
« Religieux et croyants y chantent des prières dans une multitude de langues qui évoque la Tour de Babel. Des évêques célèbrent des offices en araméen biblique comme jadis, tandis que les voûtes obscures renvoient l’écho de nombreuses autres langues anciennes. Des moines drapés de mystère évoluent autour du tombeau en agitant des encensoirs entre les rais de soleil qui s’infiltrent – étrange croisement de rituels, qui pour certains, remontent aux premières sectes chrétiennes. L’église du Saint-Sépulcre est sans doute l’unique lieu eu monde où plusieurs processions et messes peuvent se dérouler sous le même toit, devant une assemblée hétéroclite de fidèles récitant leurs prières respectives côte à côte. »
J’ai beaucoup entendu parler des Lieux Saints lorsque j’étais en Norvège au mois de juillet. Au nord de l’Europe, à Trondheim, la pasteure Berit Lanke a su créer un contrepoint à Jérusalem, en réunissant régulièrement autour de Saint Olav toutes les églises d’Europe et les trois religions du Livre. Ce Saint Viking dont une des plus anciennes représentation figure sur une colonne de l’Eglise de la nativité à Bethléem.
Disons alors que j’aimerais que ce court article photographique rende hommage à cette femme de dialogue et que je souhaiterais tout autant me fondre un jour dans les foules dont les fois s’épousent, autour d’un Christ sanglant couché sur le sol, mais dans la convergence de regards dont la compassion pour le monde ne peut être mise en doute.
LA PERSÉVÉRANCE DES SANS-ABRI
Une exposition de photos du festival de Perpignan Visa pour l’Image, festival de photojournalisme, attire l’attention du visiteur sur la précarité et sur la misère sociale, notamment au travers de clichés montrant des sans abris… Des regards sur les marges, la pauvreté et l’exclusion sociale… Parmi les photographes, Andrea Star Reese réalise un travail touchant dans la ville de New York…

Le thème est d’actualité. En France ! Mais on pourrait dire aussi bien : partout dans le monde. Là où les villes écrasent immédiatement ceux qui ne sont pas insérés dans un réseau qui les protège, ceux qui sont en transit entre deux destinations ou bien encore ceux qui vivent dans une société où ils ne peuvent trouver, psychologiquement, matériellement ou tout simplement du fait des écarts de civilisation, aucune place sociale. La fragilité sociale est mortelle !

L’actualité est française. Et si les projecteurs sont venus balayer en même temps que les bennes à ordure, les camps de Roms de Roumanie et de Bulgarie, ce n’est pas une nouvelle en soi. C’est juste une manière de concevoir l’information politique qui s’intitule – tout simplement : la recherche des boucs émissaires. Le maire de Rome et le gouvernement italien ont acquis une grande compétence dans ce domaine depuis plusieurs années. Quelques responsables politiques français ont repris, sans y changer grand chose, un scénario qui leur convenait : l’aménagement d’un espace théâtral permettant une mise en scène de la menace que nous suggère tout naturellement la misère quotidienne venue d’ailleurs.
L’actualité n’en est donc pas une. Les sans-abri constituent des invariants. Mêmes types de refuge, partout. Même allure égarée. Seules la peau et la nature des souvenirs groupés autour d’eux changent de couleurs et d’allure. Quand ils ont encore des souvenirs !
Des images de sans-abri, le Festival de Perpignan en présente une grande quantité. Et de toutes sortes. Mais le travail effectué par Andrea Star Reese à New York est certainement le plus touchant. Le mot est d’ailleurs plein d’équivoque. Avons nous vraiment envie d’être touchés par la crasse, la marge, les effets de l’alcool ou de la drogue ? A distance peut-être. Mais pourtant à Perpignan, les clochards sont aussi physiquement présents. Près de nous. Les jeunes migrants en recherche de rues ensoleillées, allongés sous les porches sont nombreux. La police les veille, entre contrôle strict et amitié quotidienne.
Les photos sortent donc des murs, ou la rue entre dans les caméras. C’est selon !
« Lancé en 2007, le projet « The Urban Cave » (intitulé en français, « Dans la pénombre des villes ») couvre la vie de ces hommes et femmes qui vivent à New York dans des campements de fortune malgré les efforts de la municipalité pour les expulser. C’est l’histoire de la résistance et de l’humanité de ceux qui vivent en marge de la société. C’est l’histoire, non pas d’un dénuement, mais d’un groupe d’individus, de leurs vies. Au fond d’une impasse, sous l’ombre d’un pont, dans un bâtiment délabré, ou le long des murs d’un tunnel ferroviaire, ces photographies dévoilent la beauté d’un lieu, de personnes, et sont le témoin de la dignité, de la détermination et de la persévérance des sans-abri. »
Voilà ce que dit le catalogue. Beauté, vraiment ?Il y a bien entendu toujours une dimension esthétique que le photographe introduit, même s’il ne fait que rapporter. Mais ici, la dimension esthétique est aussi une forme d’hommage à des compagnons d’un moment. Pas à monsieur X, mais à un groupe d’individus précis, suivis sur des mois. Ils se nomment Lisa et Chuck et attendent un enfant, Country et Snow White quand ils n’avouent pas même leur prénom ou bien encore Willy Colon, ce visage entre aperçu, enfoui sous ses cartons.
Leurs noms mêmes nous semblent universels, tant nous superposons leurs visages et leurs habits, leur nudité aussi, à ceux de milliers d’autres que nous avons fui ou que nous avons aidé, nous comportant de manière désordonnée, selon les variations de l’intensité de notre peur à les affronter. Selon l’effroi qui nous vient à nous regarder dans leurs yeux; aussi fragiles qu’eux, un jour, peut-être.
LA MORALE DU DRAME HUMAIN
Le monde global est d’abord le monde du rien et de l’insignifiant ! Le chat qui meurt sous les roues d’une voiture à Tucson n’est en rien différent de celui qui périt sous les crocs d’un chien dans les rues de Naples. Mais les deux morts peuvent faire immédiatement l’objet d’une retransmission mondiale sur les sites sociaux et venir se placer à égalité d’intérêt, à côté de l’immeuble d’Alep effondré sous les projectiles destructeurs commandés par un dictateur, ou bien venir voisiner le corps de la fillette anglaise réfugiée sous les corps criblés de balles de ses parents. Tous des chiens écrasés. Autrement dit : l’écume des jours.
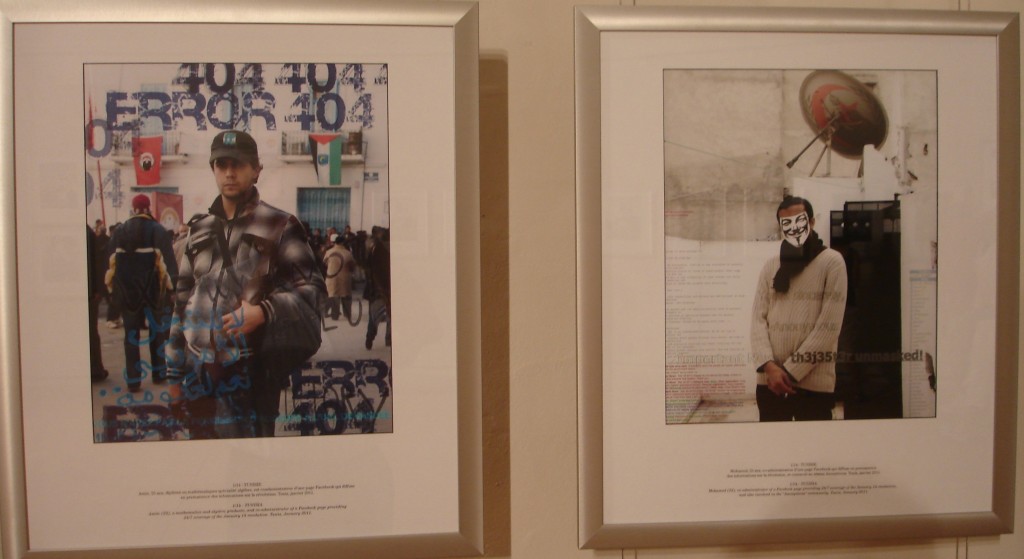
Mais qui montre la réalité des drames dans leur profondeur ? Qui en approche le sens et qui ose encore capturer et transmettre l’image des massacres quotidiens ? Ils paraissent nombreux ces enragés tant les images présentées à Perpignan sont en effet nombreuses. Mais en même temps ils sont si peu. Ils sont les héritiers des aventuriers qui offraient leurs émotions au monde quand il fallait encore rapporter un témoignage photographique sous forme d’une pellicule avec soi, pour être cru. Les photojournalistes que l’on croise et qui se croisent dans cette ville du Sud chaque année, au moment où le soleil décline, sont toujours des aventuriers car ils se chargent d’eux-mêmes et volontairement d’être notre conscience morale et de saisir l’instant où le tyran tombe à terre ou bien sort de son trou, l’instant où le prisonnier transpire de peur, celui où le vainqueur d’une joute sportive ou politique se met à sourire. Ils sont là par passion, par addiction, par conviction et d’ailleurs très souvent personne ne les envoie et ne les attend vraiment.

Photographes des chiens écrasés, vraiment ? Délégués de notre bonne conscience, vraiment ? Il y a ceux qui aiment la peur et il y a ceux qui s’arrêtent longtemps, s’immergent, qui reviennent souvent ébranlés, mais qui iront se fondre dans un nouveau monde pour le comprendre, jusqu’à ce qu’ils en saisissent la part d’humanité dont nous avons besoin.
On peut comprendre alors pourquoi cette nécessité de se retrouver régulièrement en dehors des zones de combat et de se tenir chaud, et de se raconter les profondeurs des drames humains dont ils se sont approchés, quitte à se brûler, persiste de manière impérieuse.
Ce sont nos témoins et pourtant leurs témoignages ne sont plus demandés par personne, alors qu’ils devraient être exigés. Ils ne sont plus demandés parce que nous pensons que nous sommes tous devenus journalistes sur nos profils internet et que nous y travaillons comme photographes grâce à l’étrangeté des clichés d’instagram. Ils ne sont plus recrutés sauf s’ils racolent le sensationnel, le scandaleux et satisfont les besoins des voyeurs.
Les princes du jour, dans leur nudité, récoltent des ovations et ceux qui les ont piégés, des récompenses. Je ne parle pas de ceux-là. Pourtant ceux que j’aime nous font voir des drogués, des prostitués, des morts-vivants, des mourants, des petites filles sacrifiées, des femmes violées, des fous enchaînés, des meurtriers, des foules apeurées ou agressives ; autrement dit l’arrière-plan et les coulisses du monde. Par leur exigence de vie, ceux-là sont des moralistes. Ils se placent exactement là où l’image jaillit, juste à cet instant-là, pour nous permettre d’amorcer un jugement personnel et ne pas simplement rester sur une compassion vaine.
Jean-François Bizot, le Directeur de Visa rappelle la célèbre phrase de Pierre Lazareff : « Un chien qui mord une vieille dame, ça n’intéresse personne ; une vieille dame qui mord un chien, c’est de l’information. » Certes, mais ce que cette morsure fait comprendre d’une offense qui a peut-être été faite à la dignité de cette vieille dame, de son exaspération devant la méchanceté du monde, et peut-être de sa folie, une photographie en donnerait un point de vue symbolique qui la ferait entrer dans le légendaire. La photographie qui montrerait cette scène pourrait alors certainement placer la vieille dame à côté d’Antigone ou d’Ulysse.
Je vais à Perpignan, comme je relis l’Odyssée, parce que je vis comme beaucoup dans des pays immédiats qui ne pratiquent plus la création des mythes et pensent même qu’ils n’en n’ont plus besoin !
Est-ce que le fait que la première publicité que j’ai aperçue en arrivant à Bucarest en septembre 1995 était une banderole qui annonçait l’ouverture du McDonalds le 16 juin de la même année était ou non une information ? Plus significative même que l’image d’un couple fusillé dans une arrière-cour un soir de décembre six années plus tôt ?

Combien puis-je sélectionner d’images sur la Roumanie parmi les milliers prises en plus de quinze années qui disent vraiment la Roumanie et qui en racontent un moment significatif ? Celle des manifestants d’associations Roms devant l’ambassade de France, à côté de chez moi, il y a deux ans dans les jours où les ministres français de droite étaient venus en visite ? Probablement, puisqu’en rappelant que la liberté de circulation, c’est-à-dire le droit de revenir au pays en y étant contraint, coûte 300 euros, elle garde une actualité frappante à la suite de la visite récente des ministres français de gauche, des hommes aussi désemparés que leurs prédécesseurs.
Ou bien en juillet 2001, celle du musée du village de Sighet où Ana Blandiana et des dissidentes tchèques boivent un verre de bière non loin de Stéphane Courtois, l’auteur du Livre Noir du Communisme et d’un ancien journaliste de Radio Romania Libera et que les étudiants qui ont suivi une semaine de conférences dans le cadre d’une école d’été de prise de conscience de l’importance d’une citoyenneté retrouvée, décompressent autour d’un feu qui dispersait l’humidité.
L’information et surtout l’information photographique c’est d’abord du temps, je veux dire de la durée, de la proximité, pas la capture d’une image brouillée, par un drone invisible !

On fête ces jours-ci le centenaire de Marshall McLuhan. Il n’a pas apporté toutes les réponses aux défenses dont nous aurions besoin vis-à-vis des changements anthropologiques que les nouveaux medias nous ont fait subir, mais il a posé pratiquement toutes les bonnes questions. Voici une « réponse » certes synthétique, mais qui s’adressait à tous puisqu’elle faisait partie d’une interview dans Playboy en mars 1969.
« Because inherent in the artist’s creative inspiration is the process of subliminally sniffing out environmental change. It’s always been the artist who perceives the alterations in man caused by a new medium, who recognizes that the future is the present, and uses his work to prepare the ground for it. But most people, from truck drivers to the literary Brahmins, are still blissfully ignorant of what the media do to them; unaware that because of their pervasive effects on man, it is the medium itself that is the message, not the content, and unaware that the medium is also the message — that, all puns aside, it literally works over and saturates and molds and transforms every sense ratio. The content or message of any particular medium has about as much importance as the stenciling on the casing of an atomic bomb. But the ability to perceive media-induced extensions of man, once the province of the artist, is now being expanded as the new environment of electric information makes possible a new degree of perception and critical awareness by non-artists… The present is always invisible because it’s environmental and saturates the whole field of attention so overwhelmingly; thus everyone but the artist, the man of integral awareness, is alive in an earlier day. In the midst of the electronic age of software, of instant information movement, we still believe we’re living in the mechanical age of hardware. At the height of the mechanical age, man turned back to earlier centuries in search of “pastoral” values. The Renaissance and the Middle Ages were completely oriented toward Rome; Rome was oriented toward Greece, and the Greeks were oriented toward the pre-Homeric primitives. We reverse the old educational dictum of learning by proceeding from the familiar to the unfamiliar by going from the unfamiliar to the familiar, which is nothing more or less than the numbing mechanism that takes place whenever new media drastically extend our senses.” Just brilliant!
Des présentations de différentes expositions de Visa : mon site de « curating » sur les photos et les photographes
William Albert Allard : L’enfant a grandi, le rêve s’est envolé
Au Festival de photojournalisme Visa pour l’image de Perpignan, William Albert Allard exprime comment l’enfant grandit sans pour autant sortir vraiment de l’enfance… Un regard sur chaque sujet considéré comme unique… Une enfance engourdie dans une ville endormie… Une invitation à découvrir des clichés admirables…

Toujours au Couvent des Minimes, William Albert Allard cite la chanson des Pink Floyd « Comfortably Numb ». Pour en marquer comme un opposé. L’homme n’est certainement pas sorti de l’enfance, engourdi. Mais est-il vraiment sorti de l’enfance ? Si l’enfance représente une continuité de l’étonnement, certainement pas.


Voilà un photographe que l’on dira classique. Grandement liée au destin de National Geographic, sa carrière dépasse aujourd’hui les cinquante années. On peut donc sans insulte, parler d’hommage.
Des visages ou des silhouettes, des poses alanguies, des moments capturés à des vedettes ou à des inconnu(e)s, un peu comme on enfonce les banderilles pour faire gicler le sang du taureau. Mais ces vedettes que finalement on ne voit pas vraiment, ne sont-elles pas des inconnu(e)s ?
Les admirations que suscitent ses clichés sont individuelles puisque chaque sujet est unique, mais elles s’accumulent pour former un style. Communs ou non, les visages sont en souffrance ou en état d’étonnement, et toujours sophistiqués. Ils jouent souvent avec nous. Même quand le propriétaire d’un ranch prend la pose ou qu’un Basque retrouve son identité au plus profond du chant qui résonne en lui.
Attirance pour la chair. En surface. Témoin, certes mais avec compassion. Jamais dans la recherche des endroits où l’on souffre collectivement. Juste le sang qui passe dans les veines et qui peut affluer au visage. De quelqu’un.
Des photographies en couleurs qui sonnent comme des phrases bien construites. Un îlot de calme. Comme une phrase de Giono regardant et écoutant de près des vieilles en train de veiller un mort. On voudrait bien connaître le secret de ces femmes en train de boire le café et de ces hommes figés devant la musique.
Giono, comme Allard nous fournissent les mots et les accents, la grammaire des couleurs. Et nous admirons la construction de la phrase qui nous pénètre.
L’enfance engourdie et la ville endormie. Correspondances entre ce que je regarde là, à côté de moi, et ce que je suis en train de lire, toujours à côté de moi.
« C’est entre deux flancs de montagnes, un petit bourg paisible, sans bruit. Le mot qu’on y prononce le plus souvent c’est : soleil. On prend le soleil. Venez prendre le soleil. Il est allé prendre le soleil. Il ne fait pas soleil. Il va faire soleil. Il me tarde qu’il fasse soleil. Voilà le soleil, je vais prendre le soleil. Ainsi de suite. C’est le plus gros bruit. Avant qu’un commerçant ait fait un tour sur lui-même, tu tuerais un âne à coups de figues. Les sucres d’orge fondent dans les vitrines et il faut trois étés pour faire fondre un sucre d’orge. Ils ne fondent pas à cause de la chaleur ; ils fondent parce qu’ils restent là trop longtemps. C’est pour le sucre d’orge et c’est pour tout. C’est un pays où on a tellement de temps que, tout ce dont on a envie, on ne finit par l’avoir que fondu. » (Jean Giono, Les âmes fortes)
