Après le bain de fraîcheur offert par Carine-Laure Desguin, je vous replonge un peu trop brutalement peut-être, dans un monde sans espoir, celui dans lequel vivait Adriana, dans la Bulgarie d’avant le communisme, pendant le communisme et après le communisme, un pays qu’il faut absolument fuir, selon elle, car il n’y a rien à en attendre, rien à en espérer.
Théodora Dimova, une plume imprégnée du romantisme slave
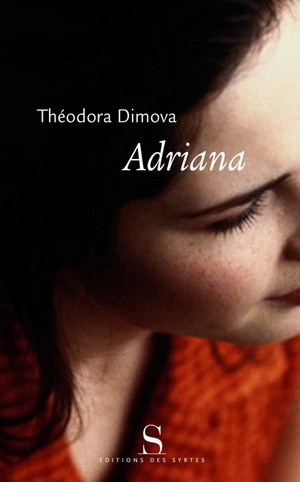
Ce texte, au romantisme slave exacerbé, raconte dans une grande envolée lyrique la vie d’Adriana, une femme qui a connu la Bulgarie avant le communisme, pendant le communisme, après le communisme, sans jamais trouver une bonne raison d’apprécier la vie dans ce pays maudit.
La Bulgarie, Un pays où la narratrice ne peut pas vivre…
Adriana est une vieille femme de quatre-vingt-treize ans qui raconte son histoire à Ioura, une jeune et jolie fille qu’elle emploie juste pour l’écouter transmettre son histoire. La jeune fille, à son tour, rapporte cette histoire à son cousin protecteur. Le récit oscille sans cesse entre ce qu’Adriana dit à Ioura et ce que Ioura rapporte à son cousin au risque d’égarer le lecteur, mais l’auteure précise régulièrement : « raconte Adriana et rapporte Ioura ».
Donc, un beau soir, Ioura déboule un peu cavalièrement chez son cousin écrivain, un homme plus âgé qu’elle, afin de lui transmettre le récit qu’elle vient de recueillir auprès de la vieille Adriana avant que celle-ci ne décède, ayant été recrutée aux seules fins d’écouter l’historique de son existence agitée et peu glorieuse. La vieille dame se confie à la jeune fille comme pour se soulager d’un poids qui pèse sur sa conscience avant de quitter cette vie dont elle a abondamment profité sans jamais obtenir la satisfaction qu’elle souhaitait.
Les premières paroles de la vieille femme surprennent son auditrice, « ce que j’aime par-dessus tout, c’est d’être allongée nue sur la plage en été », Ioura rit mais reste coite et entend la suite du récit avec beaucoup d’émotion. Le rire rapproche les deux femmes. Adriana relate : sa famille riche avant la révolution, sa mère bigote et superstitieuse, son père travailleur acharné mais étouffé par sa femme, la révolution, la pauvreté, la fin du communisme, la fortune retrouvée dans l’injustice, la violence, la corruption … La vieille femme ne trouve aucune raison d’aimer ce pays et conseille aux jeunes de le fuir.
Mais ce n’est pas cela que la vieille femme cherche à transmettre, ce qu’elle veut dire c’est sa vie personnelle, le dégoût qu’elle éprouvait pour l’amour car, comme elle était riche et jolie, elle focalisait la concupiscence masculine sur sa personne, la vie de débauche qu’elle a menée pour ne pas s’attacher à un seul homme, la dépression dans laquelle elle a sombré, la déchéance dans laquelle elle s’est vautrée et comment un beau jour tout a basculé quand elle a rencontré l’Homme de sa vie, l’Homme d’un jour, L’Homme à cause de qui tout a basculé.
Dans ce récit, Théodora Dimova construit un personnage mythologique digne des grandes légendes romantiques qui sont nées au cœur de l’Europe danubienne et qui ont inondée la littérature de la Mitteleuropa. Elle situe cette épopée dans les temps modernes, dans l’histoire contemporaine de la Bulgarie, une histoire qui la révolte et l’indigne. « Nulle part ailleurs il ne s’est produit cette chose abjecte qui s’est passée en Bulgarie, les faits dépassent l’imagination de tout Bulgare, il est même terrifiant de parler de ces choses-là, il est même terrifiant de se les représenter, le communisme était un sort meilleur pour la Bulgarie que la démocratie, la démocratie a été jetée en Bulgarie comme une victime expiatoire et elle a été immédiatement dévorée à belles dents, déchiquetée, mise à mort ». Adriana ne croit pas plus en son pays qu’en l’humanité. « Ioura, lorsque que je serai morte, il faudra que tu quittes ce territoire que certains, opiniâtrement et mus surtout par la nostalgie, continuent d’appeler Bulgarie. Tu n’as rien à faire à l’intérieur des frontières de ce territoire ». Et, quant à la richesse,« Mais la fortune que je te lègue ne te rendra pas heureuse…, ce n’est qu’un confort ou un inconfort qui ne rend jamais heureux… »
Adriana n’éprouve que répulsion pour les hommes obsédés par la richesse, plus attachés à l’avoir qu’à l’être : « L’homme aspire toujours à entendre la voix divine, Ioura, toujours même lorsqu’il ne s’en rend pas compte. La part la plus intime de son moi aspire uniquement à entendre la voix divine Ioura, ne l’oublie pas ». « Les relations n’ont pas lieu d’homme à homme, mais entre les hommes et Dieu. »
Et même si Adriana pense que « Les mots humains sont extrêmement inadaptés à la plupart des choses », nous avons très bien compris qu’à travers cette légende mythologique, Théodora Dimova nous confie que les hommes, quel que soit le système, sont trop pervertis, trop obsédés par l’avoir et le pouvoir pour se soucier de l’être. Ioura veut que son cousin écrive cette épopée des temps modernes pour témoigner, et peut-être avertir, prévenir, inciter les hommes à mener une autre existence.
» Acheter le roman Adriana de Théodora Dimova ; Editions des Syrtes
Denis BILLAMBOZ
Extrait :
Un jour, loura, mon adorable cousine germaine que toute la famille plaignait parce que sa mère était morte très tôt et que son père s’était presque aussitôt remarié avec une veuve originaire de la Bulgarie du Nord-Ouest -comme dans les contes les plus cauchemardesques où il était question de marâtres, il avait complètement cessé de s’occuper de sa fille aînée et de lui prêter attention, aiguillonné, bien entendu, par la veuve originaire du Nord-Ouest qui, après l’avoir taraudé et empoisonné pendant deux ans, réussit à chasser loura chez sa grand-mère, à la suite de quoi elle fit de furieuses tentatives pour concevoir un enfant à elle (elle allait de guérisseurs en rebouteux, de charlatans en sorcières, exorcistes, voyantes, Turques et hodjas, buvait des décoctions, accomplissait toutes sortes de trucs dégoûtants, comme faire le tour du quartier à minuit en saupoudrant les maisons de cendre depuis longtemps refroidie, ou rester accroupie durant des heures avant le point du jour au-dessus d’une casserole de chou bouillant, afin que ses entrailles s’imprègnent des vapeurs curatives du chou), quoi qu’il en soit, elle ne put avoir d’enfant capable de faire de l’ombre à la belle loura, d’adoucir le sentiment de culpabilité de son père, profondément refoulé, à l’égard de sa jolie fille unique ; ainsi donc, un dimanche, en fin d’après-midi, en plein milieu du mois d’août, dans la ville vidée de ses habitants comme en temps de peste, dans le désert de la canicule implacable de l’été qui ramollit à la fois le cerveau, le sang et les os des quelques Sofiotes demeurés en ville, par un tel soir d’été, dans l’odeur de poussière, d’asphalte et de rues désertes, la sensation des pierres chauffées à blanc et des nuits blanches qui s’ensuivent, sans m’appeler sur mon portable, ni me prévenir de sa visite, ni s’excuser d’avoir sonné l’alarme sans arrêt à l’interphone (il s’avéra ensuite qu’elle avait tout simplement appuyé la main sur le tableau de l’interphone, inconsciente de l’alarme qu’elle provoquait), sans prendre la peine de savoir si je n’étais pas en train de travailler, d’écrire, de rédiger un article à rendre deux heures plus tard, si je n’avais pas un engagement, si je ne devais pas sortir, si je n’attendais pas quelqu’un, si on ne m’attendait pas quelque part, bref si je n’avais pas d’autres projets, par un tel soir d’été, Ioura fit irruption dans mon atelier sans s’enquérir de tout cela et s’installa dans le fauteuil le plus confortable (l’unique, d’ailleurs).

