Pourquoi m’a-t-il fallu si longtemps pour écrire sur Dynasty (jusqu’au 5 septembre) ? Après plusieurs visites subsiste ce sentiment d’insatisfaction, de frustration qui m’avait saisi dès le premier jour. Est-ce à cause du titre, ridicule et prétentieux ? Est-ce parce que toute exposition qui prétend représenter la vitalité artistique d’un moment, sans thème (le temps ?) et sans unité, mais seulement sur la base de la ‘valeur’ des artistes, amène nécessairement à questionner les choix faits, présences ou omissions ? Sans doute.
La dualité entre Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et Palais de Tokyo, chacun des quarante artistes étant présent des deux côtés, parfois avec des pièces similaires, parfois au contraire en marquant le contraste, a-t-elle été pour moi un facteur de confusion, voire parfois d’ennui ? Peut-être. Tentons d’explorer les oeuvres présentées ici.
Commençons par les manques. Tout d’abord, la peinture est ici bien mal représentée. Je suis peu sensible aux exubérances d’Armand Jalut, aux niaiseries de Raphaëlle Ricol et encore moins aux banales scènes quotidiennes de Jean-Xavier Renaud, un des artistes les plus surreprésentés de cette exposition. Les ruines de Duncan Wylie, trop évidentes, me touchent peu. Seules émergent les violences de parking de Guillaume Bresson, et, bien entendu, les splendides compositions épurées de FarahAtassi (au second plan de la photo ci-contre de la pièce de Julien Dubuisson). C’est peut-être ce qui manque le plus à la peinture présentée ici, cette économie, cette pureté, cette sobriété présentes chez elle.
Ensuite, la photographie est quasiment absente de l’exposition: curieux, mais il n’y a pratiquement aucun véritable travail photographique présenté ici, seulement des photos ici ou là en documentation ou en support. C’est par la vidéo qu’un talentueux photographe comme Mohamed Bourouissa est présent ici, et c’est dommage : ses photographies étaient plus denses que ces petits reportages furtifs, à Barbès ou en prison.
D’ailleurs, la vidéo ne brille pas non plus toujours par sa qualité. Les histoires racontées par la vidéo de narration, que ce soit la bataille napoléonienne sanglante et l’errance du rescapé de Florian Pugnaire et David Raffini, les contes de Bertrand Dezoteux ou les fictions pseudo-hollywoodiennes de Gabriel Abrantes et Benjamin Crotty, manquent singulièrement de densité. Quant au film omniprésent de Gaëlle Boucand sur une teuf de musique électronique, c’est la pire nuisance de l’exposition (si j’ose, un boucan d’enfer), empêchant d’écouter, par exemple la belle pièce sonore de Pierre-Laurent Cassière qui a le malheur de se trouver à proximité. On se demande ce que font dans une exposition de découverte de la jeune scène française les très confirmés Fabien Giraud et Raphaël Siboni : ce ne sont pas leurs effets de lumière ultra-classiques qui vont me convaincre (on peut se poser la même question pour l’autre couple de non-découverte, Dewar et Gicquel, mais au moins leur tapisserie a de la gueule). Parmi les vidéos, j’ai quand même aimé Chen Yang aux deux films si différents (l’aquarium surpeuplé aux glaçons d’un côté, le vieillard endormi de l’autre) et surtout RebeccaDigne : ‘Mains‘, un beau film, lent, calme où le temps est suspendu autour d’un jeune homme les mains levés, prisonnier ou orant, et ‘Matelas’ où parfois apparaît un fragment, un morceau de corps humain; ces deux films silencieux, statiques, minimaux sont de petits bijoux au milieu du tumulte environnant.
Tu n’as donc pas aimé grand chose, critique bougon ? Si, des installations, et en assez grand nombre. Non que je fasse le choix d’un médium plutôt qu’un autre (encore que, comme vous savez, j’ai du mal avec 99% de la peinture contemporaine), mais simplement parce qu’ici ce sont les installations sculpturales, dans l’espace, qui se révèlent avoir le plus de poids. D’abord parce que certaines d’entre elles ont un rapport direct avec le lieu. Laetitia Badaut-Haussmann s’est intéressée à la mémoire du lieu, elle a planté sur le trottoir un cèdre en mémoire de celui qui ornait l’Ambassade de Pologne rasée en 1937 pour construire le Palais, présage du sort de la Pologne deux ans plus tard. Elle a aussi fait un mémorial pour les pianos des familles juives parisiennes, confisqués sous l’occupation et alors entreposés dans les sous-sols du Palais de Tokyo : dans une des salles de l’exposition, on entend simplement une pièce de Ligeti, rien d’autre. Ces deux pièces s’appellent No One Returns, souvenirs tragiques.
Toujours dans l’esprit des lieux, Cyril Verde et Mathis Collins ont réalisé le projet utopiste de creuser un puits artésien sous le Palais (Monument pour un huitième puits artésien) : documentation, maquette, plans d’exécution, ‘mandala’ technologique au sol, mais :
On ne peut qu’être fasciné par l’énorme sculpture de Poussière de Yuhsin U. Chang au Palais de Tokyo, qui semble se dégorger d’une fente dans le mur, tomber sur nous, menaçante, déferlante; je ne sais si la poussière a été soigneusement recueillie dans le bâtiment pendant des mois, mais j’en doute. Au-delà du spectaculaire, c’est aussi une évocation du corps, de la mort (au second plan de la photo, une pièce d’Oscar Tuazon) . Dommage que la pièce similaire au Musée ne surprenne plus, ensuite.
Beaucoup de sculptures de qualité aussi : les compositions de matériaux de récupération de Stéphanie Cherpin; l’empreinte de danse indienne de Julien Dubuisson, comme des traces de chaman (plus haut, Ghost Dance, avec un tableau de Farah Atassi au second plan); la sculpture en équilibre précaire et menaçant de Vincent Mauger, nids d’abeille ou décoration islamique, dont l’autre face est plate et militaire, le tout en casiers de bouteille en polystyrène, matériau pauvre ici ré-anobli (tout en haut, Sans titre); les moulages de volet de Masahide Otani, fermés, durs, énigmatiques, silencieux, comme des vestiges archéologiques, des empreintes judiciaires (ci-contre, Volets clos); les arcs tendus de Vincent Ganivet; la plaque obscure en chicane d’entrée et le tronc-joug d’Oscar Tuazon (voir la photo de ‘Poussière’ ci-dessus) sous lequel on doit passer pour entrer, deux obstacles, deux passages. J’ai moins été sensible au baroque de Théo Mercier et encore moins à l’assiette cassée de Camille Henrot, dont j’espérais mieux.
Mais j’ai découvert le travail d’Antoine Dorotte : au Musée, un escalier au mur, chaque marche en forme de tore, tordue, gravée d’écailles de serpent, leur progression en suite algébrique, et leurs ombres portées; récupération de tuyaux en zinc pour évacuer l’eau des gouttières (Suite d’O). Au Palais, un mur recouvert de plaques de zinc, toujours, gravées en aquatinte, comme l’explosion d’une étoile (Blow) : c’est de la gravure autant que de la sculpture, et c’est très réussi.
Enfin, les pièces sonores, que j’ai trouvées excellentes : si celles de Pierre-Laurent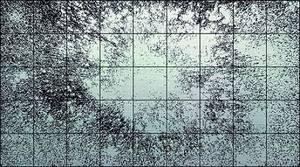
il faudra aller le voir et l’entendre ailleurs), on est par contre capté, dès l’entrée au Musée, par l’installation sonore sur les marches de Robin Meier et Ali Momeini : énorme cornet acoustique et hauts-parleurs, sons électroniques fascinants venant de l’espace au pied de la Fée Electricité (Imaginez maintenant). En face, la fascination est autre : captation scientifique du bourdonnement des moustiques amoureux (Truce: Strategies for post-apocalyptic Computation, ci-dessous).

Le titre est une citation du surréaliste belge Achille Chavée, Décoctions II.
Photos de l’auteur excepté Dorotte (Blow), Meier/Momeini (Truce), courtoisie du service de presse et Digne. Rebecca Digne étant représentée par l’ADAGP, son visuel sera ôté du blog à la fin de l’exposition.
