La réparation de Colombe Schneck (Litterature francaise) est plus qu’un roman, plus qu’un énième témoignage sur les victimes de la Shoah, plus qu’un devoir de mémoire envers sa famille. C’est un document vrai.
[tab name=’Critique du livre’]
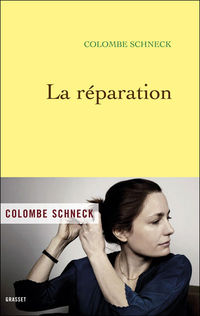
Un témoignage de plus s’ajoutant à tant d’autres, que La réparation? Sans hésiter, j’affirme que non, car les propos de l’auteur dépassent dans leur interrogation – pour les plus jeunes – le cadre strict du devoir de mémoire envers sa famille, pour mettre en lumière, avec une extrême pudeur et beaucoup de sensibilité, ce qui somme toute s’applique à tous les traumatismes de la guerre, qu’ils s’incarnent en Europe, en Arménie, en Palestine, en Algérie ou ailleurs. Qu’on ne s’y trompe pas: à l’inverse de L’incroyable Monsieur Schneck ou Val de Grâce – autres écrits de Colombe Schneck – La réparation n’est pas une oeuvre littéraire où se mêlent la réalité et l’imaginaire, mais bel et bien un document vrai.
Le récit de Colombe Schneck s’amorçe avec sa propre fille qui répond au joli nom de Salomé, une promesse faite à sa mère Hélène. Cela lui rappelle une autre enfant, Salomé Bernstein – cousine de sa mère, fille de Raya et soeur de sa grand-mère maternelle Ginda – morte à Auschwitz en 1943, dont il ne reste qu’une photo datée de 1939: Salomé est en culotte blanche, petits souliers et chaussettes assortis. Elle tient un sceau en fer-blanc à la main. De l’autre, elle s’est agrippée à un fauteuil d’enfant. Elle sourit sous le soleil, regardant sur le côté, une jambe légèrement en arrière, l’autre un peu en dedans.
Elle entreprend alors de remonter le temps, de sonder et éclairer la mémoire familiale, des Etats-Unis en Israël en passant par la Lituanie. Pour savoir, pour comprendre dans l’urgence tout ce qui lui a été caché, ce passé dont il ne reste rien et qui dans ses inquiétudes, rejoint le présent. Qu’est-ce qu’il y a de juif en moi? J’aime le hareng mariné et les cornichons à la russe. J’ai peur. J’ai tout le temps peur qu’il arrive quelque chose à mes enfants, je ne suis pas croyante mais tous les soirs je m’endors en priant, pitié qu’il ne leur arrive rien. (…) Et si mon enfant meurt, est-ce que je pourrai continuer à vivre?
Comme bon nombre d’autres écrivains, Colombe Schneck s’interroge sur le sens de sa démarche: Je me disais c’est trop facile, tu portes des sandales en chevreau mordoré, tu te complais dans des histoires d’amour impossibles, tu aimes les bains dans la Méditerranée et tu crois qu’une fille comme toi peut écrire sur la Shoah?

Un autre éclairage intéressant touche les rescapés – ceux qui ont eu de la chance – sur lesquels pèse la suspicion et peinent à se débarrasser de leur culpabilité, alors qu’il n’y a pas faute. Sur l’intégration, aussi: Eux sont dans cette illusion protectrice, ils se croient intégrés, alors qu’ils vivent en marge. (…) Ils vivent dans un pays où ils sont tolérés. Sans plus. Enfin, pour ceux qui n’ont pas lu Le livre noir de Ilya Ehrenbourg et Vassili Grossman, Colombe Schneck nous raconte la Lituanie, dont 95% des juifs ont été exterminés. Une page d’histoire complexe de domination soviétique et allemande, que nos jeunes – aux côtés d’autres tragédies plus contemporaines – doivent connaître. Pour comprendre, eux aussi. Et ne pas oublier.
Cité en introduction à La réparation, le dernier mot revient à David Grossman: On n’est plus victime de rien, même de l’arbitraire, du pire, de ce qui détruit la vie, quand on le décrit avec ses mots propres.
Une réparation qui vaut plus que le chèque que sa grand-mère a reçu d’Allemagne en réponse à sa détresse. Pour Salomé et tous les autres…
[/tab]
[tab name=’Extraits’]
Extraits :
« Quand le 1er février 2003, ma fille Salomé est née, Ginda avait quatre-vingt-dix-huit ans, elle était dans la détresse d’avoir perdu sa fille Hélène. Elle est venu embrasser son arrière-petite-fille. Salomé criait. Ginda ne semblait pas entendre. Elle la trouvait ravissante malgré ses pleurs. Je n’ai pas interrogé Ginda sur Salomé, la première Salomé, sur ses sœurs Raya et Macha. Ginda aurait peut-être été enfin prête, c’était le moment ou jamais, le moment de ce qui aurait pu ressembler à une réparation. Une nouvelle Salomé venait de naître, elle hurlait, elle était ravissante, elle était vivante. Ginda aurait pu me dire ce qu’elle avait appris quand elle était allée à Munich, en 1946, retrouver et entendre ses sœurs qui avaient survécu. Elle ne m’a rien dit. Je ne l’ai pas non plus questionnée. Comment dire la mort et le retour à la vie des survivants ? C’était, pour elle, indécent. Elle m’observait m’occuper de ma fille, la vêtir avec soin, l’admirer. Ginda semblait ravie de cette naissance. Le reste était inexplicable. » (page 19)
« Après la guerre, Ginda n’espère plus rien, ce qui est arrivé à ses soeurs Raya et Macha, à son frère Nahum ne laisse aucune place à quoi que ce soit d’heureux. Sa détresse est telle qu’elle la prive de mots. » (page 91)
« Macha et Ginda avaient toujours du mal à supporter ceux qui s’apitoyaient sur eux-même. Ne crois pas que ce soit de la dureté, on a facilement une bonne raison d’être malheureux, mais on a aussi la possibilité de construire. Elles étaient silencieuses sur les années de guerre, parlaient continuellement de l’avenir. Que faire ? Comment aider ? » (page 167)
« Et si mon enfant meurt, est-ce que je pourrai continuer à vivre ? » Toutes les mères se posent cette question, comme Macha, comme Raya. A Munich après la guerre, elle n’ont pas menti à leur sœur Ginda. Elles ont raconté la vérité, comment elles avaient toutes les deux choisi de vivre.
A Munich, Ginda ne commente pas, ne s’exclame pas, ne juge pas. Elle portera désormais la douleur de ses sœurs comme la sienne, espérant ainsi les soulager. Elle rentre à Paris au printemps 1946, retrouver son mari Simkha, sa fille de quatorze ans, Hélène, son fils de neuf ans, Pierre. Elle se tait. Ginda ne dit rien à son mari, elle a si peur que Simkha ne comprenne pas. Simkha sent que ce voyage a transformé sa femme, plus rien n’intéresse Ginda, ses enfants, même son fils Pierre, si drôle et si intelligent, ne l’amusent plus. Elle a renoncé à la sensualité, ce n’est qu’à la naissance de ses petits-enfants qu’elle pourra à nouveau ouvrir ses bras tendus. Elle ne peut plus.
La fin de la guerre apporte peu de consolations. En 1946, ma mère Hélène a quatorze ans, elle était allée petite fille, avant la guerre, en vacances en Lituanie, avait pris sa nouvelle cousine Salomé dans ses bras, l’avait chatouillée, embrassée. Ginda concède à Hélène : « Ta grand-mère, ta cousine et ton cousin on disparu. Tes tantes ont survécu. » Ginda n’ajoute rien.
Hélène est adolescente, elle ne comprend pas le silence de sa mère, pourquoi ne lui raconte-elle pas ce qu’elle sait, pourquoi ne lui parle-t-elle pas de sa cousine Salomé ? Est-ce que les adultes se fichent de ce qui est arrivé aux enfants pendant la guerre ? Elle garde en elle Salomé puisque personne n’en parle. Hélène ne sait pas que Ginda fait tant d’efforts pour cacher son désespoir. Ginda et Hélène se séparent ainsi sans comprendre qu’elles sont si proches dans ce qui les terrifie. Toute sa vie Hélène agira ainsi, cachant les choses, silencieuses, espérant qu’ainsi le malheur s’étouffera de lui-même. Hélène se croit seule avec cette douleur, la mort de cette petite fille unique. » (page 178)
« Car de ces femmes si vivantes, Hélène et Ginda ne pouvaient évoquer le souvenir sans rappeler cela, Raya et Macha, après la mort de Salomé et Kalman avaient choisi la vie et l’amour, quand elles, Hélène et Ginda, avaient par ces mêmes morts, renoncé, en partie, à la vie et à l’amour. » (page 209)
Avec ma mère, nous parlions de tout, je me confiais à elle, elle m’encourageait constamment mais nous n’avons jamais parlé du ghetto, de Kalman, de son premier mari Ulli, de la déportation, du camp en Estonie. J’avais dix- huit ans quand ma mère est morte et depuis il n’y a pas un jour où je ne pense pas à elle. Elle est mon modèle. Je me dis : “Comment aurait- elle agi à ma place ?” Elle était toujours gaie, généreuse, affectueuse, optimiste. Raya est morte en 1951. Elie a élevé seul Benny, le petit garçon né en 1948 à Munich, et il ne savait pas comment s’y prendre. C’était un savant qui s’emmêlait les pieds dans les fils de ses appareils, adoré par ses étudiants. Il gavait son fils de sucreries et ne savait pas préparer un repas. Alors, ma mère lui cuisinait des plats, s’occupait de Benny pendant les vacances. Quand ma mère est morte, j’avais dix- huit ans, cela a été au tour de ta grand- mère de s’occuper de nous. Mais elle vivait à Paris, nous à Herzliya. Nous nous sommes retrouvées seules au monde, comme toi quand tes parents sont morts beaucoup trop jeunes. Pour ta grand- mère, j’avais le sentiment que nous étions infiniment précieuses. Je devinais pourquoi. Elle assumait ainsi le choix de Raya et Macha, toujours choisir la vie, les enfants, l’avenir. Ginda nous écrivait toutes les semaines, comme elle l’avait fait toute sa vie avec ses sœurs. A elles, elle écrivait en russe et en yiddish, à nous en anglais et en hébreu. Elle a appris l’anglais et l’hébreu pour pouvoir correspondre avec nous. Elle venait nous voir deux fois par an. Elle m’a invitée à Paris chez elle dans son appartement du boulevard Saint- Michel, j’avais dix- neuf ans et elle m’a appris à bien vivre. Elle m’enseignait ses règles de vie : “Même quand tu es seule tu dois faire attention à toi. Quand tu prends un repas seule, mets une jolie nappe, des couverts, prépare un bon repas, sers- toi un verre de vin. N’allume pas la radio, écoute plutôt de la musique. Habille- toi toujours élégamment, parfume- toi, maquille- toi mais pas trop. Quand tu sors et que tu mets des bijoux, enlève toujours une broche, une bague, un bracelet. Moins est mieux que trop. Il faut toujours avoir des fleurs chez soi. Ne sois pas gênée d’aller seule prendre un verre en terrasse d’un café, d’aller au restaurant, au cinéma, au théâtre. Ne te lamente pas parce que tu es seule, profite du café bien chaud, de l’humour du film que tu vas voir, lis, et si tu en es capable écris, écris des lettres, écris des poèmes, si tu peux des livres, ne pense pas à ce que tu n’as pas.” Aujourd’hui alors que je suis mariée, mère de trois enfants, je respecte toujours ses conseils. Je fais attention que tout soit joli à la maison, j’écris des poèmes. Mais s’il te plaît, ma petite nièce si élégante de Paris, ne regarde pas mes ongles, je n’ai pas eu le temps de m’en occuper. Ta grand- mère Ginda m’a appris à bien vivre. Et toi, tu es si jolie, si élégante, une vraie petite Parisienne avec ses peines de cœur. Profite de chaque moment de ta vie. Nous sommes dans ce jardin, bois ton thé, profite, profite, ajoute du sucre si tu veux. Ecoute- moi ma petite cousine parisienne, tu es vivante, ne laisse aucun plaisir de côté. Ce garçon qui te plaît tant, appelle- le.
— J’ai peur de tout perdre à nouveau. Je n’ai même pas le courage de faire le voyage vers Poniwej et Kovno.
— N’y va pas. Je suis allée à Poniwej, je voulais voir la maison de notre famille. Un centre sportif très laid a été construit à la place. Rien dans cette petite ville ne rappelle qu’une communauté juive y a vécu pendant plusieurs siècles puis a été détruite. Comme Pierre, j’ai demandé, après la fin de l’empire soviétique, s’il était possible de récupérer cette maison, ainsi que celle de mon père, il m’a été répondu que cela était impossible car nous n’étions plus des citoyens lituaniens. Plus rien ne nous attend là- bas. »
Gila me parlait, je prenais des notes, sa voix était inchangée et je n’avais pas remarqué que des larmes coulaient sur son visage. Elle me dit : « Ce n’est rien », et elle s’essuie avec un mouchoir. Elle s’inquiète de la suite de mon voyage. Je vais visiter la Cisjordanie. « Tu vas vraiment dormir à Ramallah ? Tu vas leur dire que tu es juive ? »
Le lendemain soir, je lui téléphone de l’hôtel Movenpick de Ramallah, je lui raconte le dîner dans une pizzeria, le verre dans un café branché, les filles en minijupe, la gentillesse et la curiosité des Palestiniens à mon égard. Je ne lui raconte pas la visite au centre culturel Khalil Sakakini. Le directeur me fait visiter le bureau de Mahmoud Darwich. Il témoigne de la dernière Intifada, comment les soldats israéliens ont détruit les portes anciennes, ont jeté à terre les livres du poète et ont pissé dessus. (page 215)
[/tab]
[end_tabset]
Colombe Schneck, La réparation (Grasset, 2012)
Jorge Semprun, L’écriture ou la vie (coll. Folio/Gallimard, 2007)
Le livre noir, textes et témoignages – réunis par Ilya Ehrenbourg et Vassili Grossman (Solin/Actes Sud, 1995 et 2010)
- Chateaubriand dans les Alpes : Voyage au Mont Blanc et réflexions sur les paysages de montagnes - Juil 5, 2014
- La réparation de Colombe Schneck : plus qu’un devoir de mémoire familiale (Litterature francaise) - Juil 5, 2014
- Le fond de la jarre d’Abdellatif Laâbi ; beau récit autobiographique (Litterature marocaine) - Juil 5, 2014

