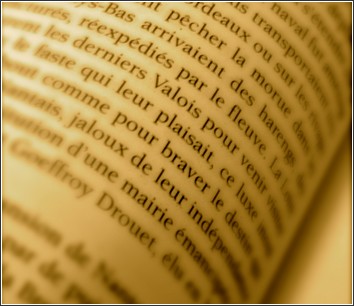Chapitre 1

Les jours où je me levais tôt, c’était un enchantement, en ouvrant mes volets, de découvrir la forêt, là tout près, qui s’éveillait elle aussi. En hiver un peu de brume flottait au-dessus de la cime des arbres dénudés, dont les branches étaient recouvertes de givre. En été, les premiers oiseaux chantaient, emplissant l’espace d’une harmonie enchanteresse. Curieusement leurs chants, si beaux, si équilibrés, renforçaient le silence environnant. Je veux dire que ce silence profond, propre aux grandes forêts, était en quelque sorte accentué par ces chants qui venaient l’interrompre un instant. Je m’accoudais à ma fenêtre et je regardais l’aube se lever. La lumière, d’abord bleutée, tournait à l’orange puis au jaune. Puis subitement le soleil apparaissait au-dessus du moutonnement des arbres et c’était un nouveau jour. Je ne me lassais jamais de ce spectacle et je me disais que la vie méritait d’être vécue, finalement.
Parfois, comme je lisais toute la soirée et jusqu’à une heure avancée de la nuit, il m’arrivait de me lever tard. En ouvrant mes volets, j’étais alors frappé par l’impression de paix qui régnait en ce lieu. Il était déjà dix heures du matin et pourtant tout était calme et silencieux. En ville j’aurais été accueilli par un concert de klaxons et de moteurs vrombissants. Ici, il n’y avait rien, rien que ce grand calme qui enveloppait toute chose, comme si j’avais atteint à une sorte d’éternité. Le soleil était déjà haut dans le ciel et le fait d’entrer ainsi dans une journée bien entamée me ravissait. C’était comme si tout m’était donné d’un coup, dans un geste gratuit. L’instant d’avant, j’étais dans la pénombre de ma chambre et subitement la vie était là, resplendissante et offerte. Il n’y avait qu’à la saisir.
C’est ce que je faisais, évidemment. Après un petit déjeuner rapide et frugal, je m’acheminais vers la forêt, que j’arpentais pendant des heures. Comme par enchantement, les soucis quotidiens ou professionnels s’évanouissaient au cours de ces longues marches. Mon esprit se vidait de tous ces tracas inutiles et finalement dérisoires qui empoisonnent notre vie de tous les jours. Petit à petit des idées plus sereines naissaient dans mon esprit et finalement je parvenais à relativiser tous les échecs que j’avais subis dans la vie. Puis ma lecture de la veille me traversait l’esprit et de fil en aiguille mon esprit vagabondait sur des thèmes littéraires. Il m’arrivait aussi de rêvasser à ma nouvelle compagne qui, la pauvre, avait dû rester dans la capitale pour son travail. Elle n’était jamais venue jusqu’ici et je me réjouissais déjà à l’idée de lui faire découvrir ces immenses forêts sans commencement ni fin qu’elle ne pourrait qu’apprécier. Je rêvassais donc comme cela, tout en marchant, et je croyais la voir à mes côtés, trottinant de son pas rapide et assuré. Pour un peu j’aurais écarté les branches qui obstruaient le chemin, afin qu’elle ne s’égratignât point le visage.
Quand je sortais de ma torpeur, il était plus de quatorze heures, je ne savais absolument pas où je me trouvais, et la faim commençait à me tirailler l’estomac. Le mieux était donc de rentrer. Oui, mais comment ? Généralement, j’étais complètement perdu. J’essayais bien de faire demi-tour et de m’y retrouver dans tous ces chemins, mais vous savez ce que c’est : les petits détails qu’on a enregistrés malgré soi (une flaque d’eau, un arbre tortueux, un rocher qui fait saillie) ne sont d’aucun secours quand on marche dans l’autre sens. J’errais donc souvent pendant des heures et quand enfin je me retrouvais dans des lieux connus de moi, j’étais à huit ou dix kilomètres de mon point de départ. Ces randonnées n’étaient pas pour me déplaire, je dois dire. D’abord parce que j’adore la marche et que ce n’étaient pas dix petits kilomètres en plus qui allaient me faire peur, mais surtout parce que l’idée de me perdre dans ces grands bois m’enchantait. C’était un peu comme si j’avais été coupé du monde. Tel un Dédale moderne, j’errais dans une sorte de labyrinthe dont il semblait tout d’abord illusoire de pouvoir sortir. Ce labyrinthe ressemblait finalement à la vie, où il n’est jamais très facile non plus de s’y retrouver. Pourtant, certains semblent avoir reçu des plans et des cartes d’état major à la naissance, car après avoir gravi rapidement tous les échelons de l’échelle sociale, ils en atteignent les sommets après un parcours sans faute. D’autres, comme moi, tâtonnent davantage et après avoir hésité beaucoup sur la route à suivre, finissent toujours par se tromper de chemin. Mais bon… Je me moquais bien d’avoir une grosse villa avec piscine et une Porche garée devant l’entrée. Mon bonheur n’était pas là, mais plutôt, justement, dans cette errance sans but précis, qui me permettait de mieux goûter à ce que le hasard de l’existence m’octroyait.
Je tournais donc en rond pendant des heures dans ma forêt et finissait par me prendre pour Robinson. Dernier homme sur la terre ou du moins seul homme à arpenter ces contrées sauvages, il me semblait atteindre un point de non retour. J’allais me perdre définitivement et on n’entendrait plus jamais parler de moi. Comme j’ai une imagination débordante, je me demandais ce qu’il allait advenir de mon petit appartement. Il me semblait voir les voisins s’interroger et se poser des questions sur mon absence. « Voilà quatre semaines qu’on ne l’a plus revu ! » « Il est peut-être en vacances ? » « Impossible, il me donne toujours ses clefs pour arroser les plantes du salon ». Puis on prévenait la police, qui finissait par convoquer un serrurier. On trouvait l’appartement vide et rien n’indiquait où j’avais bien pu aller. Alors on menait une enquête dans le département puis finalement dans tout le pays et après deux ou trois années j’étais déclaré mort. L’appartement était mis en vente et les voisins s’empressaient de faire la connaissance du nouveau propriétaire, surtout si c’était une jeune dame d’allure sportive, toute mince et bien bronzée. Pouvais-je leur en vouloir ?
Ou alors j’imaginais que pour une fois ma compagne était avec moi. Elle avait enfin pu se libérer de son travail pour trois jours et elle était venue me rejoindre ici, à la campagne. D’abord émerveillée par ma petite maison à moitié en ruine, qu’elle trouvait charmante, elle avait ensuite voulu faire une grande promenade dans la forêt. Et voilà qu’on s’était perdus. Comme nous étions deux, nous n’avions plus trop envie de retrouver notre chemin. Nous avions bien erré quelques heures, cherchant vaguement à nous repérer, mais nous n’avions fait que nous enfoncer davantage dans la profondeur des bois. Le soir venu, nous avions dormi enlacés sur un lit de fougères. Le lendemain, mieux reposés que dans une chambre d’hôtel, nous avions décidé de ne plus revenir vers la civilisation et de rester là, à arpenter sans fin ces bois merveilleux. Nous avions alors construit une petite cabane avec des troncs d’arbres et des branchages et nous avions vécu là tout l’été, coupés du monde, disparus pour tous.
Voila le genre de rêves un peu fous que je faisais tout en me promenant. La cause d’un tel délire, il fallait sans doute la chercher dans les livres. J’avais dû trop lire Jean-Jacques Rousseau et son mythe du bon sauvage avait dû éveiller en moi un désir de retour naïf à la nature. Bien sûr, je savais comme tout le monde qu’il n’y a rien de plus cruel que cette nature et que l’injustice y règne en maîtresse absolue, chaque espèce essayant de survire au détriment des autres. Mais bon, les livres, je vous dis, avaient faussé mon jugement et j’avais toujours en moi ce rêve de vivre coupé du monde, au cœur de la grande forêt primitive.
Bref, ce jour-là, donc, il était quasi vingt-et-une heures quand je suis enfin rentré chez moi, fourbu mais content. Je me suis préparé à manger, car je mourais de faim, puis, n’ayant pas trop envie de lire, je me suis aventuré, je ne sais trop pourquoi, vers le grenier, où je n’avais quasi jamais mis les pieds.
Chapitre 2

Au hasard, j’ai un peu regardé ce qui traînait là, sur le plancher. Une barate pour faire du beurre, des seaux métalliques troués, un hérisson destiné à ramoner les cheminées, tout couvert encore de suie. Un vieux porte-manteau auquel pendaient des vestes démodées, attaquées par les mites. Un cadre en bois, dont l’aquarelle avait été retirée, un miroir brisé, dont des éclats jonchaient encore le sol, des boîtes en cartons remplies dont ne savait trop quels objets désormais inutiles. Dans un coin, une garde-robe bancale attira mon attention. Quand je voulus l’ouvrir, je m’aperçus qu’elle était fermée et que la clef avait disparu. Elle conserverait donc à jamais ses secrets et c’était peut-être mieux ainsi. A quoi bon, en effet, remuer le passé et faire revivre les souvenirs de personnes que je n’avais jamais connues ? Ce qu’elles avaient vécu leur appartenait en propre. Des rêves et des illusions, elles en avaient sans doute eus comme chacun d’entre nous et comme nous en avaient concrétisé bien peu. Devenues vieilles, elles s’étaient remémoré, le soir au coin du feu, le peu qu’elles avaient finalement réalisé et qu’elles enjolivaient et amplifiaient à dessein afin de ne pas sombrer dans le désespoir le plus noir. Comme cela, s’inventant des exploits auxquels elles avaient fini par croire, elles avaient atteint un âge avancé avant de finalement s’éteindre et de disparaître à jamais, ne laissant de leur passage que cette armoire fermée à clef que plus personne n’ouvrirait jamais.
Dans un autre coin, des jouets d’enfant étaient entassés les uns sur les autres. Un petit vélo à trois roues, des poupées aux cheveux clairsemés, un cheval en bois à qui il manquait une patte, des patins à roulettes sans roulettes, une ferme en bois, avec une vache et un mouton dessinés sur le mur, une roue de bicyclette tordue, des gants de boxe troués et, plus insolite, un collier de chien avec sa laisse.
Qu’étaient devenus les enfants qui avaient joué avec tout cela ? Vivaient-ils encore seulement ? Pourtant ils avaient été heureux ici, enfin je crois. J’essayais d’imaginer de jeunes garçons faisant des courses de vitesse avec leurs patins à roulettes, sur la petite route devant la maison. Assise près de la porte d’entrée, leur sœur coiffait inlassablement la même poupée pendant des heures. De l’écurie, une autre fille, déjà adolescente, sortait en tenant un jeune chien en laisse. L’animal était fou de joie à l’idée de partir en promenade et il aboyait de contentement. Toute la scène était là devant mes yeux, nette et précise. Qu’étaient-ils tous devenus ? Quand j’avais acheté la maison, celle-ci était déjà presque en ruine, ce qui fait remonter la naissance de ces enfants très loin dans le temps. Ils devaient être nés, si mes calculs étaient bons, entre 1870 et 1890. Leurs parents avaient connu l’époque de Napoléon III et la défaite de Sedan. Ils devaient en parler, le soir au coin du feu et le grand-père, s’il était encore vivant, évoquait lui l’époque glorieuse de l’autre Empereur, le vrai, celui d’Austerlitz, de Marengo et d’Iéna. Celui aussi, hélas, de Waterloo. Et les enfants écoutaient tous ces récits et petit à petit ils les incorporaient à leur mémoire. Plus tard, à leur tour, ils en reparleraient avec leurs propres enfants, déformant sans le vouloir la vérité première, qui avait de toute façon déjà été déformée par ceux qui l’avaient racontée.
Où étaient-ils, aujourd’hui ces enfants ? Tous étendus au cimetière, bien entendu. A supposer que l’un d’entre eux eût survécu jusqu’à cent ans, ce qui était pour le moins improbable, il serait mort de toute façon depuis au moins vingt ans, si pas trente. Et en pensant à cela, je regardais cette pile de jouets qui les avaient rendus heureux un certain temps, avant qu’ils ne s’en détachent pour entrer dans la vie adulte. Alors, ils avaient travaillé, ils avaient aimé et puis ils étaient morts. Voilà. Ca se résume à peu de choses, finalement, la vie des hommes.
Un peu nostalgique et déprimé, je suis allé inspecter l’autre coin du grenier. Tout en tâtonnant dans la demi-obscurité, je pensais à ma relation avec ma compagne, qui m’apportait tant. Et pourtant un jour on parlerait de nous au passé et tout ce que nous aurions vécu resterait à jamais inconnu ou apparaîtrait comme vain et dérisoire. On ne pouvait rien y changer…
Arrivé enfin dans le coin le plus obscur, j’ai dû me pencher pour voir ce qui se cachait tout au fond, contre les tuiles. C’était un coffre ! Un gros coffre en chêne brut, comme on en voyait encore au XVII° ou XVIII° siècle. Je l’ai tiré comme vers moi comme j’ai pu, afin de le contempler plus à loisir. Qu’est-ce qu’il était lourd ! J’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois avant de pouvoir en ouvrir le couvercle qui, heureusement, n’était pas verrouillé. Devinez ce qu’il y avait à l’intérieur ? Un gros livre et une clef. J’ai d’bord cru que cette clef ouvrait la garde-robe, vers laquelle je me suis aussitôt précipité, mais non. Cette clef n’ouvrait rien du tout. Je me retrouvais donc avec une armoire hermétiquement close qui garderait à jamais ses secrets et une clef inutile, qui n’ouvrirait plus jamais rien. Déçu, je suis revenu vers le coffre et me suis emparé du livre. C’était un gros volume relié en cuir, couvert de poussière. A la lumière pâlotte de l’ampoule, je suis quand même parvenu à en lire le titre, après avoir essuyé la couverture avec ma main : « Nouvelles impossibles ».
Chapitre 3

Une fois au salon, je me suis servi une bière spéciale, brassée par des moines trappistes (enfin, c’est ce que l’on dit sur l’étiquette), je me suis installé dans un fauteuil, et j’ai ouvert le fameux livre. Comme son titre l’indiquait, c’était un recueil de nouvelles, toutes écrites par des auteurs différents. Une sorte d’anthologie, en quelque sorte. L’éditeur, « Les Cahiers du Sud », m‘était complètement inconnu et la date de publication, 1903, me plongeait déjà dans une autre époque. L’auteur du premier texte, un certain Marin Rivière, m’était tout aussi inconnu. Enfin, on verrait bien… Et c’est ainsi que j’ai lu d’une traite cette longue nouvelle qui comportait plus de cinquante pages :
« Il était une fois, dans un village reculé d’Albanie, une famille pauvre qui avait trois enfants, trois garçons forts et robustes. Ils étaient encore jeunes, mais déjà ils aidaient le père au travail des champs, surtout le deux plus âgés. C’est alors que la mère tomba enceinte une quatrième fois. Quatre enfants ! Quatre grands gaillards pour conduire les bœufs au labour ou rentrer le foin dans le fenil ! C’est les voisins qui allaient être jaloux ! Avec une telle main-d’œuvre gratuite, la ferme allait s’étendre, c’était certain.
Les mois ont commencé à passer et l’hiver est venu. La mère restait souvent près de la fenêtre à regarder la neige tomber sur la forêt toute proche. Elle ne disait rien, mais posait parfois une main sur son ventre pour tenter d’entrer en contact avec le petit être qui était en elle. Mais il était trop tôt encore, l’enfant était trop petit et elle ne sentait rien. Rien qu’une impression étrange, inhabituelle, comme si cet être avait été plus fragile que les trois autres qu’elle avait déjà portés. Elle garda pour elle ce secret et ne dit rien aux hommes, qui ne comprennent de toute façon rien à ces choses-là.
Deux mois passèrent encore et un matin qu’elle était venue comme toujours s’asseoir à sa fenêtre, elle vit des primevères et des jonquilles qui pointaient leur tête dans le pré près de la maison. Le printemps arrivait et elle en fut heureuse. Machinalement, elle posa la main sur son ventre, comme elle en avait pris l’habitude et là, ô surprise, elle sentit l’enfant qui bougeait ! Quelle joie ! Il naîtrait au tout début de l’été, en pleine fenaison, quand les hommes seraient partis faucher dans les grandes prairies à l’entrée du bois, celles qui sont arrosées par la rivière et qui donnent cette herbe si tendre et si verte dont les vaches raffolent.
Un soir, au dîner, le père prit la parole. Tout en coupant une tranche de pain (ce bon pain préparé avec la farine de froment de la ferme, que sa femme, ce matin-même, avait cuit dans le four en pierres qui jouxtait la maison) il s’exclama, en contemplant le ventre de son épouse : « C’est pas tout cela, comment est-ce qu’on va l’appeler notre petit gars ? C’est qu’il faudrait bien lui trouver un nom ! Le temps presse, il sera bientôt là. Comment est-ce qu’on va l’appeler ? Drajash ? Ermir ? Prekatar ? »
Alors, la mère, un peu craintive tout de même, lui répondit : «Ne te tracasse pas pour le prénom, tu auras le choix. » « Et comment cela, j’aurai le choix? » rugit le père. « C’est que cette fois ce n’est pas un garçon que je porte », murmura la mère. « Comment cela, ce n’est pas un gars ? C’est quoi alors ? » « C’est une fille », répondit la mère, toute tremblante, avec pourtant comme un petit sourire de satisfaction au coin des lèvres. Une fille ? Ils se regardèrent tous. Ben ça alors, personne n’avait jamais pensé à cela… Une fille… Dans leurs yeux, la mère vit passer comme une sorte de tendresse. C’était gagné. La petite était déjà acceptée. Une présence féminine dans la maison, après tout, cela ne ferait pas de mal ! Un peu de douceur, un peu de tendresse… On n’y était pas trop habitués, à vrai dire, mais pourquoi pas, finalement, cela ne devait pas être désagréable… Ils se regardèrent tous les quatre, le père et les trois fils, puis éclatèrent d’un grand rire franc. Une fille ! Ca alors !
« Et comment sais-tu que c’est bien une fille ? » demanda le père à sa femme. « Je le sais, je le sens, c’est tout. » « Comment ça, tu le sens ? » « Oui, je le sens. La grossesse est différente des autres fois et le bébé est bien plus petit, bien plus fragile. Il faudra être gentil avec lui quand il sera né, hein ! » Elle regarda tous ses hommes à tour de rôle et elle vit qu’elle pouvait avoir confiance. Ils étaient enchantés et la petite serait la reine de la maison.
En juin, comme elle l’avait prévu, la mère donna donc le jour à une petite Alasina, qui devint vite le centre d’intérêts de toute la famille. Quand ils revenaient des champs les garçons allaient l’embrasser dans son berceau et le père n’était pas le dernier à la prendre dans ses bras et à la cajoler.
Les années passèrent. Le bébé était devenu une enfant joueuse et câline. A la maison, l’atmosphère avait changé. Les voisins, qui venaient souvent rendre une petite visite de courtoisie, l’avaient remarqué eux aussi. L’espèce de rusticité qui avait régné dans ce foyer pendant des années avait disparu comme par enchantement. Maintenant, on ne criait plus, on parlait ; on ne se fâchait plus, on dialoguait ; on ne disait plus de gros mots ou en tout cas on en disait beaucoup moins ; on ne mettait plus les pieds sur la table en fumant sa cigarette mais on se tenait dignement, les jambes croisées. Bref, en un mot la petite fée qu’était Alasina était parvenue sans le savoir à transformer ces âmes rustres de paysans. Bien sûr les garçons l’avaient initiée aux jeux de balles et aux courses dans les bois. Bien sûr il arrivait encore que les frères réglassent leurs comptes à grands coups de poings derrière la grange, pour rétablir par la force quelque vérité contestée. Bien sûr si, dans la cour, le coq se mettait en travers du chemin de quelqu’un, il se retrouvait immédiatement sur le tas de fumier, projeté là par un grand coup de pied… Mais enfin, d’une manière générale, on pouvait dire que la vie s’était comme adoucie depuis la naissance d’Alasina. L’ambiance générale restait un peu rustre, mais les angles étaient maintenant arrondis.
La mère était heureuse comme jamais elle ne l’avait été. Certes elle était bien fière de ses garçons et elle aurait donné sa vie pour eux, mais la présence de cette fille qui avait bouleversé son quotidien l’enchantait. Malgré la différence d’âge, elles se confiaient de petits secrets, des secrets de femmes, même, bien que la petite n’eût encore que dix ans. Il est vrai qu’on était à la campagne et qu’on vivait fort proches des animaux. Le secret des origines de la vie n’en était plus un depuis fort longtemps pour Alasina. C’est qu’elle avait vu des dizaines de fois l’étalon monter la jument et la chienne Sarah se sauver de l’écurie pour courir après tous les mâles quand elle était en chasse. Elle savait donc comment on faisait les bébés et elle savait aussi que les filles, parfois, perdent du sang, mais qu’il ne fallait pas s’inquiéter avec cela. L’amour, le désir et le sang faisaient partie des choses naturelles et si on ne pouvait pas en parler devant les garçons, on pouvait le faire entre femmes. Car Alasina se voyait déjà comme une petite femme. Et elle n’avait pas tort car elle était très éveillée et à onze ans elle eut ses premières règles.
Avec sa mère, il n’y avait pas de honte à évoquer ces sujets et elle fut bientôt au courant de tous les petits secrets du village. Pendant que les hommes étaient aux champs ou occupés à traire les vaches, elles papotaient à deux pendant des heures, tout en préparant le repas du soir. Elle apprit ainsi que Drenusha, la voisine, avait trompé son mari avec le garçon de ferme. On ne pouvait pas lui jeter la pierre car le mari rentrait ivre quasiment tous les soirs, tandis que le garçon de ferme était un beau gars bien robuste et d’une tendresse à faire craquer toutes les filles. Elle avait appris aussi, Alasina, que l’autre voisine, Fortiana, avait avorté car le bébé qu’elle portait n’était pas de son mari. Quant à la jeune Gjethina, elle avait avorté aussi car à quatorze ans sa mère n’avait pas voulu qu’elle gardât l’enfant qui poussait dans son ventre. Il est vrai qu’on ne savait pas trop si le père était le garde-chasse de Monsieur ou Monsieur lui-même et que dans tous les cas jamais Gjethina ne serait admise dans le château comtal, qui se dressait sur la falaise surplombant le grand fleuve. Mieux valait donc faire partir l’enfant et oublier cette histoire.
Et le temps passa encore un peu. Alasina eut seize ans, puis dix-sept et enfin elle eut vingt ans. Vingt ans ! C’est un âge qui fait rêver. C’est un âge en tout cas où on tombe facilement amoureuse et c’est ce qui arriva, évidemment, car Alasina était belle, fort bien faite et d’un naturel agréable. La première fois qu’elle alla au bal au village voisin, elle rencontra donc l’amour. C’était dans la nature des choses. Fort bien sauf qu’elle alla s’enamourer de Bukuran, le seul des fils Hoxha qui n’était pas encore marié. Enfin, il y avait au moins cinquante gars dans les environs, dont la moitié au moins lui avait fait la cour durant ce bal et voilà que c’est le fils Hoxha qu’elle était allée choisir !
Chapitre 4

Voilà qui était dit et bien dit et on n’en aurait plus reparlé si la semaine suivante on n’avait pas aperçu Alasina qui parlait avec Bukuran derrière la haie de l’église. Ca c’était trop. On lui refit la morale et on durcit un peu le ton. Rien n’y fit car quinze jours plus tard un voisin la vit embrasser son amoureux au cimetière, derrière une tombe ! En plus, c’était le caveau des Hoxha ! Est-ce qu’elle croyait déjà faire partie de leur famille pour aller se recueillir ainsi au cimetière sur leurs ancêtres ? Qu’elle arrête tout de suite, aucun mariage n’était possible avec ces gens-là et si jamais l’envie lui en prenait, il était clair que les noces finiraient dans un bain de sang.
Le lendemain de cette altercation, la mère prit sa fille à l’écart et tenta de lui expliquer ce qu’on pouvait tolérer et ce qu’on ne pouvait pas. On pouvait pardonner l’amour, on pouvait pardonner le désir, mais pas avec un Hoxha. A la limite, si elle tombait enceinte d’un autre, un brave gars du pays qui l’épouserait aussitôt, hé bien on ne lui en voudrait pas trop. Mais fréquenter Bukuran, là c’était impossible. « Mais maman, je l’aime ! » hurla Alasina. « Je sais, ma fille, je sais, j’ai connu la force de l’amour avant toi, mais pourtant il va bien falloir changer de cible. On ne te demande pas de ne pas aimer, on te demande d’en aimer un autre. » « Mais c’est impossible ! C’est lui que j’aime, lui, rien que lui ! » La mère ne dit plus rien mais tout en épluchant des carottes pour la soupe, elle versa quelques larmes silencieuses, les premières qu’elle versait, peut-être, depuis que sa fille était née. C’est qu’elle savait que la situation était inextricable. Elle connaissait bien la demoiselle et elle savait que celle-ci ne céderait jamais. Mais le père et les frères non plus ne céderaient pas. L’auraient-ils même voulu qu’ils ne le pouvaient pas. Il y avait eu trop de différends avec les Hoxha et tout le village avait les yeux braqués sur eux. Laisser traîner les choses, ne pas les arrêter tout de suite, c’était déjà une faute. Les gens y verraient une manière d’accepter tacitement cet amour, ce qui en d’autres termes revenait à faire la paix et donc à capituler devant les Hoxha. Certains, plus méchants, diraient même que dans leur famille sans honneur on n’hésitait pas à vendre les enfants pour sceller une paix honteuse. En un mot, on reconnaissait ses torts et pour se faire pardonner on offrait en pâture la chair tendre d’une jeune fille de vingt ans. Voilà assurément ce qu’on allait dire dans le village, si cette histoire sentimentale ne s’arrêtait pas bientôt.
Mais que faire ? Puisqu’il semblait impossible de convaincre Alasina de renoncer à cet amour coupable, il ne restait plus que deux solutions : ou bien lui faire quitter le village et l’emmener bien loin, à l’autre bout du pays, ou bien l’enfermer purement et simplement ici à la ferme. Dans ce dernier cas, cela revenait à la cloîtrer dans l’écurie, comme la chienne Sarah quand celle-ci était en chasse. La mère revoyait l’image de la pauvre bête qui ne pensait qu’à s’échapper et qui devait rester là, couchée sur sa paillasse tachée de sang. Un jour, elle avait profité d’une seconde d’inattention et s’était enfuie par la porte entr’ouverte. En fait d’amour, on l’avait retrouvée dix jours plus tard dans un fossé, tuée d’une balle en pleine poitrine. Encore un coup des Hoxha, probablement ! Alors, à l’idée d’enfermer sa propre fille, la mère en avait des sueurs froides car elle savait qu’elle aussi ferait tout pour s’échapper. Et Dieu seul savait comment tout cela finirait.
Le soir à table, le ton monta, c’était inévitable. A la fin, Alasina, accablée de reproches, quitta la pièce précipitamment et se refugia dans sa chambre, effondrée et en larmes. La mère voulut aller lui parler, mais elle s’était enfermée à clef. « Laisse-la donc » hurla le père. « Qu’elle boude dans son coin, cela lui donnera le temps de réfléchir et elle finira peut-être par comprendre que ce ne sont pas les gars qui manquent au pays. Qu’est-ce que tu veux, c’est son premier amour, elle est butée, mais avec le temps ça lui passera. Laisse-la là-haut quelques jours et tu verras qu’elle deviendra plus raisonnable. Dans une semaine, elle l’aura oublié son Bukuran. »
La mère fit oui de la tête, mais elle savait au fond d’elle-même que jamais sa fille ne céderait. Avait-elle cédé, elle, quand elle avait voulu épouser son mari contre la volonté de ses parents ? Bien sûr que non, et ils avaient dû finir par s’incliner. Bon, il est vrai que les deux familles n’étaient pas en guerre, tandis qu’ici, la situation semblait vraiment sans issue…
Alasina resta enfermée trois jours et trois nuits. Pendant tout ce temps, sa mère déposa plusieurs fois un peu de potage et une grosse miche de pain devant la porte de sa chambre. Elle le faisait de nuit, quand les hommes dormaient, afin qu’ils ne remarquassent rien. A l’aube, quand elle repassait devant la porte, tout avait disparu. Au moins la petite ne se laissait pas mourir de faim, c’était déjà bon signe.
Et en effet, au matin du troisième jour, elle réapparut au petit-déjeuner. Malheureusement, ses frères, au lieu de ne rien dire, se crurent intelligents en ironisant : « Tiens, le faim fait sortir le loup du bois ? », dit le premier. « Oh, mais tu as bonne mine, tu aurais pu t’enfermer beaucoup plus longtemps, finalement » ricana le second. « Pas trop longtemps quand même » susurra le troisième, « sinon elle serait devenue tellement maigre que même le fils Hoxha ne voudrait plus d’elle ! » Alasina les regarda sans rien dire puis sans toucher au bon pain chaud qui sortait du four, elle se dirigea vers la porte. « Où est-ce que tu vas ? » hurla aussitôt le père. « Je vais chez mon amoureux, lui au moins il me donnera à manger ! » répondit-elle la tête haute.
La gifle retentit aussitôt comme un coup de fusil. C’était bien la première fois, en vingt ans, que le père giflait sa fille. Mais quelle tête de mule, aussi ! A son âge elle devait comprendre que l’honneur et le sens de la famille passaient avant tout. Sur ce, les hommes partirent travailler dans les champs, laissant sur la table les bonnes tranches de pain qu’ils n’avaient même pas terminées.
Alasina pleurait, appuyée contre le mur de la maison. Sa mère essaya bien de lui parler, mais elle ne l’écouta pas et alla de nouveau s’enfermer dans sa chambre. Le double tour de clef retentit dans la maison avec un bruit sec. Cette fois la guerre était déclarée pour de bon au sein de cette famille autrefois si unie.
Tout en vaquant à ses occupations ménagères, la mère repensait à tout ce qui s’était passé au cours de ces années. Elle revoyait sa vie autrefois, auprès des garçons encore enfants. Puis la naissance de la petite et la manière touchante dont elle avait été accueillie, rien que parce que c’était une fille. Il lui semblait encore les voir tous jouer ensemble, quand ses garçons devenus de grands adolescents se bousculaient pour pouvoir porter Alasina sur leurs épaules. Et voilà que toute cette complicité, tout cet amour, était gâchés à cause de ce fils Hoxha. Comme toujours le malheur devait venir de ce côté-là, il fallait croire que c’était écrit dans les cieux.
Ce malheur, elle le gardait tellement en elle qu’il finit par l’étouffer. En plus, elle était désespérée en voyant que sa fille refusait désormais la nourriture déposée devant sa porte. Alors, elle alla consulter quelques voisines. Toutes regrettaient que la situation se fût envenimée à ce point, mais en gros toutes donnaient tort à Alasina. Une fille se doit d’obéir à son père, justement parce que c’est une fille. Si ce père avait décidé que ce n’était pas là un bon mariage, il fallait obéir et rompre la relation amoureuse sur-le-champ. Et c’était d’autant plus nécessaire que le différend qui opposait les deux familles remontait à l’aube des temps. Il fallait choisir son camp. Si Alasina choisissait celui des Hoxha, elle serait répudiée par les siens, c’était logique. Quand la mère entendit tous ces propos, qu’elle n’avait vraiment pas envie d’entendre, elle prit peur pour de bon. Elle voyait déjà sa fille perdue pour toujours si jamais elle choisissait l’autre parti.
Les commères, se rendant compte qu’elles y étaient allées un peu fort, proposèrent d’aller prier Dieu. Ce n’était pas toujours très efficace, mais cela n’avait jamais fait de tort à personne. Les unes iraient se recueillir à la mosquée, tandis que les autres, en bonne chrétiennes orthodoxes qu’elles étaient, iraient prier dans la petite église qui se trouvait à l’entrée du village et dont la porte peinte en bleu semblait être le reflet du ciel de ce début d’été.
Chapitre 5

On le vit redescendre de l’étage avec le corps de sa fille dans les bras. La mère poussa un hurlement et faillit se trouver mal, mais un des fils fit remarquer que la jeune fille était seulement évanouie. On la coucha sur la table de la cuisine et on fit couler dans sa gorge une eau de vie forte et puissante, capable de réveiller un mort. Er en effet, Alasina se mit bientôt à tousser, tant ce breuvage était alcoolisé. Plus elle toussait, plus elle s’étranglait, mais au moins elle était revenue à elle et était bien vivante. On l’installa ensuite confortablement dans l’unique fauteuil de la pièce et la mère prit la relève. Elle lui donna à manger une espèce de bouillon de poule dans lequel elle avait jeté des tranches de pain. Cela formait une sorte de bouillie épaisse et nourrissante, que la malade avalait par petites gorgées. Quand elle sentait qu’elle allait trop vite, la mère arrêtait et se mettait à parler à sa fille, tout en lui caressant les cheveux. Les hommes sortirent, préférant les laisser ensemble.
Quand elle eut repris un peu de forces, au bout de quelques jours, tout le monde essaya à tour de rôle de dialoguer avec elle. Si son père lui expliqua ce qu’était l’honneur de la famille, ses frères, eux, mirent en avant la situation embarrassante où elle les mettait. En effet, si elle continuait comme elle le faisait, ils seraient quasi obligés de tirer en direction des Hoxha avec le gros fusil à sangliers. Qu’il y ait quelques morts de ce côté-là ne les tracassait pas outre mesure, il y avait déjà bien assez de vermines comme cela sur la terre, mais enfin pour la justice ce serait considéré comme un meurtre, ce qui voulait dire qu’ils seraient obligés d’abandonner la ferme et de partir se cacher dans les montagnes. C’était cela qu’elle voulait pour ses frères ? En faire des parias, des vagabonds, des bandits sans foi ni toit ? Elle devait donc bien réfléchir avant de s’engager dans cette voie car c’est toute la famille qu’elle allait faire voler en éclats.
La mère, de son côté, tenta de lui expliquer qu’elle ne connaîtrait jamais le bonheur avec un homme tel que ce Bukuran. Même si c’était un gentil garçon, ce qui restait à prouver car il appartenait tout de même à ce clan maudit, dont la réputation n’était plus à faire, même s’il était gentil donc, elle serait obligée, elle, de vivre enfermée du matin au soir dans leur grande maison sombre. En effet, il ne fallait pas s’imaginer qu’elle pourrait encore parcourir les rues du village comme elle l’avait fait jusqu’à présent. De peur de représailles à son encontre, les Hoxha allaient la séquestrer et elle perdrait jusqu’à la joie de vivre. En effet, en été, elle verrait tout le monde partir pour les champs et elle, elle devrait rester cloitrée en compagnie d’une vielle grand-mère gâteuse (car on disait que l’aïeule commençait à perdre la raison). Et le samedi, quand les hommes iraient boire un verre sur la place du village et que les filles iraient au bal, elle serait toujours là, dans cette grande maison sombre, à écouter les sornettes de l’ancêtre. C’est cela qu’elle voulait comme vie ? Alors oui, Bukaran était peut-être un gentil gars, mais après une année de ce régime-là, elle serait la première à demander le divorce. Or chez les Hoxha, on ne divorce pas, qu’elle se le tienne pour dit. Ces gens-là sont ce qu’ils sont, mais pour ce qui est de respecter les sacrements du mariage, il faut leur laisser cela, ils sont intransigeants. « Réfléchis bien, ma fille », continuait la mère. Sans compter qu’un jour ou l’autre tout cela allait finir dans le sang. Et qui retrouverait-on dans la poussière du chemin, une balle entre les deux yeux ? Son mari ou son frère, à moins que ce ne soit son père… Comment ferait-elle, par après, pour vivre avec cela sur la conscience ?
Alasina écoutait, mais ne répondait jamais rien. Elle restait prostrée, muette, et passait des heures à regarder par la fenêtre, le regard vague. Elle n’avait plus rien de la jeune fille alerte et joviale que tout le monde avait connue et si un étranger était entré dans la maison, il l’aurait prise à coup sûr pour une retardée mentale, tant son manque d’énergie, son immobilisme et son regard fixe et triste semblaient faire partie intégrante de sa personnalité. Mais non, la pauvre Alasina était simplement malade. Malade d’amour à en mourir. Ce n’était pas nécessaire de lui interdire de sortir, elle n’y pensait même plus, ayant intériorisé cette défense qui lui était faite de rencontrer Bukaran. Mais quelle tristesse dans ses yeux ! Elle qui était la gaieté même et comme l’âme de la maison, il n’émanait plus d’elle qu’un désespoir terrible, qui petit à petit se communiqua aux autres membres de la famille. Les repas étaient devenus moroses, personne ne parlait plus et c’est à peine si on osait encore manger. Tout le monde se regardait par en-dessous et la gêne était bien palpable. Une fois la dernière bouchée avalée, les hommes se levaient et quittaient précipitamment la table, tout heureux de s’en aller bien loin dans les champs et de quitter cette maison où tout était maintenant morbide.
Une semaine entière se passa ainsi quand au matin du septième jour un étranger, dont le visage était caché par un grand chapeau, fut signalé sur la petite route qui montait vers la ferme. Le frère aîné prit aussitôt son fusil et attendit l’inconnu sur le pas de la porte. Quand le visiteur fut à deux cents mètres, il lui demanda ce qu’il voulait. L’autre releva la tête et on reconnut Bukaran. Il venait prendre des nouvelles d’Alasina. Il voulait savoir si elle était malade, ne l’ayant plus rencontrée depuis quelque temps. Pour toute réponse, un coup de feu fut tiré en l’air. L’écho s’en répercuta jusqu’aux bois qui couvraient les collines et le silence qui suivit fut impressionnant. Les deux hommes se regardèrent. La lutte n’était pas égale. L’un était chez lui et armé, l’autre avait les mains nues et n’était pas sur ses terres. Il ne pouvait donc que partir et c’est ce qu’il fit, non sans avoir signalé auparavant qu’au village une rumeur courait et qu’on disait qu’Alasina était séquestrée, qu’elle ne pouvait plus sortir. « Sache que ma sœur peut sortir librement » lui lança le frère, « mais toi par contre tu ne peux pas rentrer ici. Ce n’est pas ma faute si elle n’est plus amoureuse de toi. Retourne d’où tu viens et ne remets jamais plus les pieds dans le coin. Cela pourrait mal finir pour toi. » « Je ne te crois pas », lui répondit l’autre. « Pourquoi me menacerais-tu ainsi, si ta sœur n’était plus amoureuse de moi ? La vérité c’est que tu as peur qu’elle ne me suive. » Pour toute réponse, le frère tira dans sa direction, faisant bien attention quand même à ne pas le toucher, car il ne faudrait pas que cet animal aille mourir ici, à deux pas de la ferme. La balle effleura les cailloux du chemin et là où elle était passée, on vit un petit nuage de poussière qui se dissipa aussitôt dans la grande lumière de l’été. Bukuran fit demi-tour sans se presser et tout en marchant, il dit qu’il reviendrait. Quand il entendit qu’on armait de nouveau le fusil, il ajouta : «Et ne va pas tirer sur un homme désarmé qui te tourne le dos. Tout le déshonneur en serait pour toi. » Le frère baissa son arme et rentra à l’intérieur, non sans avoir ajouté à l’intention du fils Hoxha que la prochaine fois, il tirerait, que l’adversaire soit de face ou de dos.
Dans la cuisine, son regard rencontra celui d’Alasina et il faillit avoir peur, tant il y vit de détermination, presque de la haine. Elle qui vivotait depuis des jours et des jours, voilà qu’elle se tenait là, dressée et bien droite, prête à riposter à la moindre attaque verbale. Son frère passa devant elle en haussant les épaules, mais sans oser proférer un seul mot. Il venait de comprendre que le véritable ennemi n’était pas Bukuran, mais sa propre sœur. Entre hommes, on pouvait se comprendre, et même si on réglait ses différends à coups de fusil, on parlait le même langage. L’un disait blanc et l’autre noir, c’était tout, mais en-dehors de cela, les mots utilisés avaient la même signification. Avec Alasina, c’était plus compliqué. L’adversaire était plus sournois puisqu’il habitait à l’intérieur de la maison. La cohésion du clan familial s’en trouvait ébranlée. Au lieu de faire bloc tous ensemble, il fallait au contraire se méfier d’un des membres du groupe. De plus, le discours que tenait ce membre était complètement irrationnel puisqu’il relevait de l’amour. Croire à l’amour ! Il n’y avait que les filles pour se monter la tête comme cela ! Certes, on pouvait éprouver de l’affection pour une personne de l’autre sexe, mais enfin, il fallait savoir garder les pieds sur terre et assurer d’abord ses moyens d’existence. Pour chacun des trois frères, la bonne tenue de la ferme passait avant les aventures sentimentales, ce qui ne voulait pas dire qu’ils n’avaient pas déjà troussé quelques filles en plein champ, derrière une haie, mais bon, ce n’était pas pour cela qu’ils avaient perdu la tête.
Ce soir-là, autour de la table, l’ambiance fut différente. Alors que les autres jours on était plutôt dans la morosité, cette fois-ci l’atmosphère était surtout électrique et tendue. Chacun s’observait et on se demandait qui allait commencer les hostilités. L’orage couvait, les nuages s’amoncelaient, l’air devenait étouffant, mais rien ne se passait. On savait qu’à la moindre remarque Alasina allait sauter à la gorge de son frère. La mère essayait de cacher sa peur en s’affairant comme elle pouvait avec les plats et les casseroles, tandis que le père serrait les dents tout en triturant de plus en plus vite la cuillère avec laquelle il était supposé manger sa soupe.
C’est à peine si on toucha au repas. Tout le monde se leva de table en même temps et chacun alla vaquer à ses occupations. Alasina, elle, tournait littéralement en rond, comme un fauve prêt à bondir. A la fin, elle finit par aller s’enfermer une nouvelle fois dans sa chambre. Ce fut un soulagement car on avait peur qu’elle prenne la décision de traverser tout le village pour aller se rendre chez les Hoxha. Ce n’était plus possible, il fallait trouver une solution et vite encore bien.
Chapitre 6

Le lendemain à l’aube, qui était un dimanche, les gens qui s’étaient levés tôt aperçurent Alasina et son père qui s’en allaient avec le cheval et la carriole. On les vit se diriger vers le pont et donc vers le fleuve, ce qui laissait supposer qu’ils s’en allaient vers la plaine et non vers les montagnes. Mais en dehors de cela, personne ne savait où ils allaient exactement, ce qui n’empêcha pas les commères de chuchoter que ce départ était lié avec les coups de feu qu’on avait entendus la veille. Les unes approuvèrent cette sagesse : mieux valait mettre la jeune fille à l’abri, elle qui était l’objet de la convoitise du fils Hoxha, avant que le village ne soit à feu et à sang. D’autres au contraire prenaient un malin plaisir à mettre de l’huile sur le feu, décrivant ce départ précipité aux petites heures comme une fuite honteuse. La vérité, c’était que Bukuran allait de toute façon venir chercher sa fiancée un jour ou l’autre et qu’il n’y en avait pas un, du père ou des trois frères, pour oser s’y opposer. Ces deux idées contradictoires furent bientôt débattues par le village tout entier et à midi, autour du repas dominical (généralement du goulasch ou de l’agneau au yoghourt), on ne parlait plus que de cela. Avec le vin, les conversations s’animèrent et vers dix-sept heures divers clans s’affrontaient verbalement sur la place du village. Plus on parlait, plus on avait soif, et le raki rrushi coula à flot, même chez les musulmans, qui se laissèrent gagner par l’animation générale. Bref, à vingt heures on en serait venu aux mains si les épouses n’étaient pas venues chercher leurs vauriens de maris en leur rappelant qu’il fallait encore traire les vaches et soigner les cochons.
Il était bien tard quand la carriole revint, trainée par un cheval à moitié endormi qui ne semblait avancer que par la force de l’habitude. Sur le siège, le père tenait les rênes distraitement et son regard était aussi vague que celui du cheval. On n’aurait pas pu dire s’il était triste, résigné ou tout simplement complètement saoul à cause de tous les verres qu’il avait dû boire là-bas, de l’autre côté du fleuve. Par contre, ce qui était bien clair, c’était l’absence d’Alasina. On l’avait donc bien emmenée quelque part pour éviter les problèmes. Quant à savoir où elle pouvait bien être, cela resta un mystère qu’on ne parvint jamais à élucider puisque personne ne connaissait l’existence du brave boulanger.
Car brave, il l’était, le bougre. Quand il avait vu la carriole arriver devant chez lui, aux alentours de midi, il était aussitôt sorti pour accueillir son frère et sa nièce. Mais qu’est-ce qu’elle avait grandi ! La petite fille avec des tresses s’était métamorphosée en femme accomplie. Et elle était belle à croquer avec cela… « La beauté du diable, oui ! » s’était alors exclamé le père. Le boulanger comprit aussitôt qu’il y avait un problème. Après le déjeuner, pendant que la « petite » allait ranger ses affaires dans sa chambre, avec l’aide de sa tante, les deux hommes discutèrent sur la terrasse, à l’ombre d’un gros olivier deux fois centenaire. La situation était délicate. Garder Alasina, ce n’était pas un souci en soi. On trouverait bien de quoi l’occuper à la boulangerie. Elle pourrait tenir le magasin ou faire les tournées dans les fermes isolées. Pendant qu’elle travaillerait, elle ne penserait pas à ses amours. Par contre, exiger qu’elle renonce pour toujours à son Bukuran, cela semblait une autre affaire. « Et pourquoi donc ? » l’interrompit le père. Le boulanger expliqua longuement son point de vue. Pour lui, Alasina n’était plus une enfant, cela sautait aux yeux. Dès lors, cela allait être très difficile de lui dicter sa conduite. Si elle aimait ce garçon d’un amour profond, on ne parviendrait jamais à la faire changer d’avis. Tout ce qu’on risquait, c’était de la perdre. Ou bien elle allait se suicider par désespoir, ou bien elle allait rompre avec sa famille pour toujours et elle irait rejoindre le fils Hoxha. Pour le boulanger, le mieux était donc de laisser faire et d’oublier ces vieilles querelles de village qui remontaient aux siècles passés. Après tout les Hoxha en valaient bien d’autres et en plus ils n’étaient pas sans rien. En entendant cela, le père grogna. Il était venu, lui, non seulement pour mettre sa fille à l’écart de toute tentation, mais surtout pour que le vieil oncle persuadât sa nièce que l’honneur de la famille passait avant une amourette. « Amourette, amourette… », répondit celui-ci. Si ce n’était que cela, personne ne s’inquiéterait. Il fallait donc que cela soit beaucoup plus sérieux. Et si c’était plus sérieux, de quel droit empêcherait-on cette jeune fille de faire sa vie avec celui qu’elle aime ?
Bref, la discussion dura jusqu’au repas du soir et aucun accord ne fut trouvé. Le père persistait dans son refus de fréquenter les Hoxha, en raison des différends qu’il y avait eus dans le passé et il insistait sur la nécessité de sauvegarder la réputation de la famille. Son frère, lui, qui n’habitait plus au village depuis longtemps, trouvait ces vieilles querelles ridicules et il misait sur l’avenir, autrement dit sur l’amour que les jeunes gens se portaient. C’est donc avec une colère sourde au ventre que le père remonta sur sa carriole, quand vingt heures venaient juste de sonner à l’horloge du monastère orthodoxe.
Tout le long de la route il n’arrêta pas de fulminer contre tous, à commencer contre sa fille, qui lui causait bien des soucis. Mais son frère à lui ne valait pas mieux et on voyait bien qu’il n’avait aucun sens de l’honneur pour avoir parlé comme il l’avait fait, faisant passer les amours d’une gamine avant le respect du clan. Pour se donner du courage, avec toute cette route à faire, il but plusieurs rasades de raki. Plus il en buvait, plus il trouvait que finalement la situation n’était pas si catastrophique que cela. Après tout sa fille était en sécurité, les Hoxha ne viendraient pas l’enlever de force et elle, de son côté, ne risquait plus de quitter le domicile familial pour s’enfuir avec ce damné Bukuran. La vie allait pouvoir reprendre son cours normal. Quant à son frère, ce n’était qu’un idiot qui n’avait jamais rien compris à rien, mais après tout c’était un idiot utile, puisqu’il avait accepté de s’occuper de la « petite ». A la fin, content de l’avenir qui s’ouvrait devant lui, le père se laissa guider en toute confiance par le cheval et s’endormit. Ce n’est que lorsque la carriole roula sur les gros pavés du bourg qu’il se réveilla, et c’est dans cet état que quelques habitants le virent, tout imprégné encore de l’alcool qu’il avait bu.
Pendant quelques jours, la situation redevint paisible. La tension était retombée dans le village et chacun vaquait à ses occupations sans trop se poser de questions. Encore une semaine et on aurait complètement oublié l’histoire d’Alasina. Sauf qu’un beau matin, alors que le soleil se levait à peine et que les montagnes, à l’horizon, restaient noyées dans la brume, on vit une jeune fille traverser la place de l’église. Elle semblait fatiguée et s’appuyait sur un bâton. C’était Alasina.
Ca, pour une surprise, c’était une surprise ! La mère enlaça sa fille en fondant en larmes tandis que le père bougonnait dans son coin. Quant aux frères, ils se regardaient sans rien dire, comprenant bien que des moments difficiles venaient de commencer. La « petite » expliqua qu’elle était partie la veille au soir et qu’elle avait marché toute la nuit. L’oncle, bien entendu n’était pas au courant, sinon il ne l’aurait pas laissée s’enfuir comme cela. Elle avait évité la grande route et avait emprunté des chemins de traverse, qu’elle ne connaissait pas. Dans l’obscurité, elle s’était perdue une ou deux fois et avait quand même eu très peur. Surtout qu’en traversant un petit bois elle avait entendu des hurlements. Ce n’étaient peut-être que des chiens errants, mais cela pouvait tout aussi bien être des loups. Elle avait été effrayée et s’était mise à courir. C’est alors que son pied avait heurté une racine et qu’elle était tombée, se foulant la cheville. Mais il fallait bien continuer et elle s’était aidée d’un bâton pour tenir le coup, chaque pas lui causant une vive douleur.
« Ce n’est pas raisonnable, ma petite », dit la mère. « Tu ne te plaisais pas chez ton oncle ? » Bien sûr que non, qu’elle ne s’y plaisait. C’était pourtant le plus brave des hommes, mais elle était trop malheureuse là-bas. Elle n’aurait pas pu rester un jour de plus. Alors elle avait décidé de revenir et de revoir Bukuran. Elle ne regrettait rien et si c’était à refaire, elle referait les quarante kilomètres, même si elle devait se traîner sur les genoux.
Un grand silence suivit ses paroles. Le malaise était palpable dans la pièce. Ils étaient là, tous les six, à se regarder du coin de l’œil sans oser parler. Il fallait parler pourtant, on ne pouvait pas tolérer ce qui venait d’être dit sans réagir. Mais chacun savait que dès qu’une parole serait prononcée, la guerre serait déclarée et qu’elle n’aurait plus jamais de fin. Le père se taisait, étouffant sa colère comme il pouvait. Il n’avait qu’une peur, c’était de s’emporter et d’en venir aux coups. Il savait que s’il parlait il allait s’enflammer et qu’ensuite il ne tolérerait aucune réplique de la part de sa fille. Or il la connaissait et il avait vu la détermination qu’il y avait au fond de son regard. Il hésitait donc à ouvrir le premier les hostilités.
Dans la chambre d’à côté, on entendait le tic-tac régulier d’un gros réveil. Le silence devenait intolérable. Alasina, elle, appuyée contre un mur, les cheveux défaits mais les yeux étincelants, attendait sans broncher. La tête bien droite, elle observait tout le monde, se demandant qui allait commencer le premier. C’est le frère aîné qui prit la parole.
Chapitre 7
« Ecoute », lui dit-il, « ce n’est pas qu’on n’est pas contents de te revoir, bien au contraire, mais enfin si tu reviens j’espère que ce n’est pas pour nous causer un tas d’ennuis. Tu es ici chez toi, certes, et tu peux y rester autant que tu voudras. Mais qu’on se comprenne bien. Chez toi, justement, c’est ici et pas là-bas. Autrement dit, puisque tu vis avec nous, tu passes tes journées dans notre maison et pas ailleurs. Pas par exemple à courir les rues pour tenter de rencontrer ce dégénéré de Bukuran. On t’a dit cent fois que votre relation n’était pas possible. Il n’y a pas à revenir là-dessus. On ne va quand même pas te le répéter une cent unième fois ! Je crois d’ailleurs que tu l’as très bien compris. C’est un fait acquis. On ne veut pas plus voir cet idiot dans notre famille, qu’on ne veut te voir toi dans la sienne. On n’a rien à dire à ces gens-là, qui nous ont causé tellement de soucis depuis deux siècles, alors ce n’est pas aujourd’hui qu’on va se mettre à leur parler. Pour être encore plus clair, dans le cas fort improbable où tu ne nous aurais pas encore compris, il vaudrait mieux pour la santé de ton Bukuran qu’on ne le trouve pas en ta compagnie. Si tu l’aimes autant que tu le dis, évite-le le plus possible, ce serait lui rendre un grand service. »
Là-dessus, le frère aîné s’assit et, assez fier de son discours, il toisa l’assemblée. Il s’attendait sans doute à des remerciements ou à quelques éloges et ceux-ci allaient peut-être venir quand Alasina prit à son tour la parole. D’une voix calme et posée, elle prononça juste une phrase : « Ne t’en fais pas, tu ne me trouveras pas en présence du fils Hoxha. Nous serons assez intelligents pour ne pas attirer l’attention de gens bornés comme vous. » Et là-dessus elle prit la direction de sa chambre.
Décidément cette fille donnait bien du fil à retordre à tout le monde. On se regarda sans rien dire d’un air consterné, mais quand on repartit travailler dans les champs, chacun, sans rien dire, prit un fusil avant de sortir.
Une semaine se passa sans que rien d’anormal ne vint troubler les esprits. Alasina restait le plus souvent auprès de sa mère et l’aidait dans ses tâches ménagères. Elle semblait souriante et pour un peu on se serait cru revenu aux temps anciens du bonheur, aux temps d’avant l’amour. Elle sortait peu et c’était toujours pour aller s’asseoir sur la margelle du puits, au centre du village, où elle parlait gentiment avec quelques amies. Cela se faisait publiquement et à la vue de tous. Jamais on n’avait vu l’ombre de Bukuran rôder dans les environs, ce qui se serait su aussitôt de toute façon. En effet, le village entier était aux aguets, comme on le pense bien. Mais non, il n’y avait rien d’anormal à signaler. A la fin on aurait fini par croire qu’elle avait renoncé à son amoureux, mais le calme qu’elle montrait et le sourire qu’elle arborait inquiétaient sa mère. Une telle attitude n’était pas normale, surtout de la part d’une personne comme elle, si obstinée dans ses idées d’habitude. Cela sentait le piège. Peut-être essayait-elle d’endormir tout le monde avec une attitude irréprochable afin de mieux s’échapper par la suite ? Ou peut-être même parvenait-elle à voir son « fiancé » en cachette ? On demanda à quelques voisines d’exercer une surveillance discrète, demande par ailleurs bien inutile puisque cette surveillance, elles l’exerçaient depuis quelque temps déjà de leur propre initiative. Mais non, malgré leur vigilance, on ne remarqua rien d’anormal. Alasina restait vraiment chez elle ou allait parler avec ses amies sur la place du village. Aucun jeune homme ne l’approchait et encore moins le fils Hoxha, dont on disait qu’il était occupé avec les siens à moissonner les champs qu’ils possédaient là-bas bien loin, sur les contreforts des montagnes.
Petit à petit le père se détendit et il se mit à espérer que la crise était passée et qu’un peu de bon sens était revenu dans la tête de sa fille. Mais la mère, elle, restait inquiète et ne relâchait pas sa vigilance. Elle ne croyait pas que tout pût finir aussi facilement. Elle s’en ouvrit même à son mari, qui ironisa sur ses craintes, celles-ci semblant en effet sans fondement. Pourtant, elle n’en démordait pas. Elle sentait un danger et derrière tout ce calme il lui semblait déjà percevoir l’odeur du sang.
« Ce n’est pas possible », disait-elle, « elle est trop calme, trop heureuse. Je suis persuadée qu’elle est parvenue à entrer en contact avec le fils Hoxha d’une manière ou d’une autre. Je ne sais ni où ni comment, mais je suis certaine qu’ils s’envoient des messages. Tu verras qu’un jour ou l’autre ce jeune homme va réapparaître et qu’elle s’en ira avec lui. » Mais le père continuait à nier l’évidence. Même s’il doutait un peu lui-même de ce qu’il avançait, il soutenait que sa fille avait enfin compris où était son devoir et que jamais elle ne déshonorerait sa famille.
Une chose pourtant l’inquiétait, mais il se garda bien d’en parler avec son épouse. Et cette chose qui le tracassait, c’était l’attitude qu’avait adoptée son frère le boulanger. Il lui avait quand même confié sa fille et il en avait donc la garde. Or il l’avait laissée partir de chez lui sans réagir et il n’était même pas venu voir ce qu’elle était devenue. C’était là tout de même un comportement étrange. Il fallait donc en déduire qu’il savait d’avance ce qui allait se passer. N’avait-il pas suffisamment laissé entendre qu’Alasina avait le droit d’aimer qui elle voulait ? Si cela se trouvait, il était prêt à servir d’intermédiaire entre les amoureux… Sans aller jusque là, en ne réagissant pas au départ de sa nièce, c’était un peu comme s’il lui donnait carte blanche et approuvait son attitude.
Une semaine se passa encore ainsi, sans aucun incident majeur, quand un lundi, vers les quatre heures de l’après-midi, Alasina qui venait de voir ses amies près du puits, rentra précipitamment et monta directement dans sa chambre où on l’entendit farfouiller dans ses affaires. Deux minutes plus tard elle redescendait avec un sac. Elle embrassa sa mère et lui dit, comme si c’était la chose la plus naturelle du monde, qu’elle s’en allait et qu’elle ne reviendrait plus jamais. La pauvre femme n’eut même pas le temps de répondre que déjà sa fille était sortie en courant. Pendant quelques instants, on entendit ses pas sur les pavés de la rue puis se fut le silence. Un silence impressionnant, insupportable. Ah, s’il n’y avait pas eu ce silence, peut-être n’aurait-elle pas réagi et n’aurait-elle rien fait ! Le soir, les hommes seraient revenus de champs, et tout en leur servant le potage, elle se serait contentée de dire « Alasina est partie.» Et eux n’auraient rien dit, sachant en effet qu’on ne pouvait rien y faire, que c’était dans la nature des choses. Et puis la vie aurait continué comme s’il ne s’était jamais rien passé. Un jour, beaucoup plus tard, Alasina serait revenue, un enfant dans les bras, et elle aurait dit au père « voici ton petit-fils ». Alors il aurait pris le bébé avec ses grosses mains, l’aurait regardé, lui aurait souri, et aurait dit à sa fille : « tu es la bienvenue, tu es ici chez toi, ne l’oublie pas. Et lui aussi est le bienvenu. » Et tout aurait été arrangé, car c’était en effet dans la nature des choses.
Oui mais voilà, en écoutant ce silence terrible qui avait suivi le bruit des pas dans la rue, la mère n’avait pu rester tranquille, car une mère qui voit son enfant lui échapper tente toujours de le retenir. Ce fut là son erreur, une faute horrible dont elle se repentirait toute sa vie.
Chapitre 8
En effet, Alasina avait à peine disparu que déjà la mère se précipitait vers les champs, là où les hommes étaient occupés à faucher. Si au moins elle avait rencontré son mari sur le chemin, il aurait peut-être su ce qu’il fallait faire ou même il n’aurait rien fait du tout, laissant aux amoureux le temps de se sauver. Mais non, il avait fallu qu’elle tombe sur son fils aîné, qui s’en revenait justement des champs, avec en bandoulière le fusil qui ne le quittait plus depuis quelques temps et dont il assurait qu’il était toujours chargé.
Alors, en pleurs, elle lui avait tout expliqué : la fuite d’Alasina, son dernier baiser, son adieu définitif. Lui, impulsif comme il était, serra les dents en voyant les larmes de sa mère. Il comprit qu’elle pleurait à cause du déshonneur de la famille et qu’elle lui demandait de remettre de l’ordre dans tout cela pendant qu’il en était encore temps. C’est plus tard, bien trop tard, qu’il comprendrait que ses larmes étaient simplement ceux d’une mère qui se voyait abandonnée par son enfant, mais sur le moment il ne comprit rien de tout cela. Il arma son fusil et, sans réfléchir, il se mit à courir sur la route en direction du village, avec la ferme intention d’empêcher Bukuran de s’approcher de sa sœur. Soudain, il eut l’idée de couper à travers la forêt, afin de rejoindre au plus vite le chemin par lequel le fils Hoxha devait logiquement arriver. Il courut donc à travers les massifs de fougères et s’écorcha même les jambes et les bras en passant dans les ronciers. Une fois parvenu sur la route en contrebas, ce n’est pas avec Bukaran qu’il tomba quasi nez à nez, mais avec sa sœur. En effet, celle-ci avait pris un peu de retard car elle était allée dire au-revoir à ses amies, près du puits.
L’altercation fut violente. Toute la colère qui grondait en lui, il la retourna contre elle. Il cria, il hurla et la traita de tous les noms. On dit qu’il la compara même à la chienne Sarah, qui s’enfuyait quand elle était en chasse pour aller retrouver tous les chiens mâles des environs, quelle que soit leur race. Car c’était cela, justement, qu’elle ne comprenait pas, qu’elle n’était pas de la même race que ces Hoxha, ces bandits, ces vauriens, qui n’avaient fait que leur causer du tort depuis la création du monde !
Elle, fermement, le repoussa pour passer, mais il la retint, l’empoignant énergiquement par le bras. Alors c’était elle qui s’était mise à hurler, si on en croit les témoins qui avaient commencé à approcher. Elle lui dit qu’il ne comprenait rien à la beauté de l’amour, que c’était une force extraordinaire et certainement la plus belle chose de la vie. Mais lui n’y comprenait rien car il ne savait pas ce que c’était, il n’avait jamais aimé, du moins ce qu’on appelait aimer. Tout ce qu’il connaissait, c’étaient uniquement ces accouplements bestiaux, à la sauvette, au coin d’un champ, comme les chiens dont il parlait tout à l’heure, justement. Il n’était qu’un chien, et de la pire race encore ! S’il avait ne serait-ce qu’entrevu ce qu’était vraiment l’amour, il ne parlerait pas comme il le faisait. Elle, elle savait ce que c’était ! Alors ces histoires de querelles archaïques n’avaient aucune importance, le lien qui l’unissait à Bukuran était plus fort que tout. Il était si fort, ce lien, qu’il était capable justement d’aller au-delà de la haine qui déchirait les deux familles depuis des siècles. C’était cela qui était beau ! Savoir dépasser tout le mal qui avait été fait de part et d’autre et tomber dans les bras de celui qui aurait dû être son ennemi et qui était devenu son meilleur allié.
« Tu es folle, complètement folle », lui lança-t-il. Mais Alasina s’était déjà mise en route et ne l’écoutait plus. « Arrête où je tire » hurla-t-il. Elle se retourna d’un bond, souleva sa chemise et montra sa poitrine nue. « Tire », dit-elle, « tire sur une femme, si tu l’oses. Mon cœur est là, vise bien. Mais n’oublie quand même pas que c’est le cœur de ta sœur. » Et en disant cela elle fixait sur lui son regard de braise. Lui se tut et hésita une seconde. Il contemplait ces deux seins tout blancs qu’il n’avait jamais vus et il ne savait plus que faire. Alors elle rabaissa sa chemise, tourna le dos à son frère et se mit à marcher d’un pas décidé en direction de la ferme des Hoxha. « Arrête » hurla-t-il aussitôt. Mais elle continua à avancer. « Arrête », répéta-t-il, « ou je tire.» Elle ne broncha pas plus que la première fois et poursuivit sa marche. « Arrête, cette fois », hurla-t-il encore plus fort. « Si tu nous trahis pour les Hoxha tu n’appartiens plus à notre famille, tu n’es plus ma sœur ! » Mais Alasina continuait toujours d’avancer sans se retourner. Alors, fou de rage, il épaula son fusil et tira trois coups successifs. L’écho s’en répercuta jusque dans les montagnes, puis il y eut un silence impressionnant. Les témoins qui étaient là dirent que la jeune fille n’avait pas bougé. Elle était toujours debout, immobile, quand déjà le silence avait emplit toute la vallée. Puis on la vit s’affaisser lentement, très lentement, comme au ralenti. Enfin elle s’effondra sur le sol. Il y eut un moment de stupeur, puis tout le monde se précipita dans sa direction. Son frère, lui, ne bougea pas. Il resta là, avec son fusil en main, comme s’il ne parvenait pas à comprendre ce qui s’était passé.
Les premiers qui arrivèrent virent le sang sur la chemise. Une large tache qui s’agrandissait à vue d’œil et qui déjà coulait dans la poussière du chemin. On souleva Alasina, on la retourna et on la déposa un peu plus loin dans l’herbe. Elle avait encore les yeux ouverts et le regard qu’elle lança, presqu’éteint, montrait une souffrance indicible. C’était moins la douleur physique qu’elle ressentait qui s’exprimait là que le désespoir de n’avoir pu rejoindre Bukuran. « Dites-lui », murmura-t-elle, « dites-lui que je l’aimais. » Puis elle se tut et n’ouvrit plus la bouche. Lentement, très lentement, on sentit qu’elle s’en allait. A la fin, un filet de sang coula de la bouche et on sut que c’était terminé.
« Il faut avertir les gendarmes » dit quelqu’un. Alors on se retourna et on vit que le frère d’Alasina avait disparu. Il s’était enfui avec son fusil, son fusil de malheur. Du village, déjà, tout le monde accourait, hommes et femmes, jeunes et vieux. On voulait savoir, savoir qui avait tiré et sur qui. Mais quand ils se retrouvèrent devant le corps d’Alasina, tous se turent. Il se fit de nouveau un grand silence. Les hommes ôtèrent leur casquette et les femmes se signèrent, du moins les orthodoxes car les musulmanes, elles, se mirent à se lamenter en émettant des cris stridents, selon leur coutume.
Un bon mois après ces événements on retrouva le frère d’Alasina dans la montagne. C’est à ses vêtements qu’on le reconnut car il était complètement défiguré. Visiblement, il avait reçu une charge de chevrotine en plein visage. On sut alors que Bukuran s’était vengé. C’est qu’on ne plaisante pas avec ces choses-là, chez les Hoxha, et on sait défendre ceux de son clan !
Chapitre 9
J’ai refermé le livre et je suis resté un long moment abasourdi. Cette histoire d’amour, de violence et de sang me laissait pantois. J’avais l’air de quoi, moi, avec mon amoureuse que je rencontrais certes le plus souvent possible et avec grand plaisir, mais avec qui j’entretenais finalement une relation fort policée ? Rien de commun, chez ma compagne, avec la passion dont faisait preuve la bouillante Alasina. J’en étais à me demander si cette histoire était une pure fiction ou si au contraire elle relatait un fait réel. Difficile à dire, tant les écrivains ont l’art de vous entraîner dans des pays imaginaires qui ressemblent à s’y méprendre aux nôtres, en plus beaux ou en plus horribles. Et ici, cette Albanie encore un peu sauvage me semblait en effet à la fois plus belle et plus terrible que nos contrées de l’extrême Occident. Pour un peu j’aurais voulu connaître Alasina « en vrai » et être celui dont elle était amoureuse. Certes, l’histoire finirait forcément mal, je venais d’ailleurs d’en lire la relation, mais est-ce que recevoir un amour aussi passionné ne méritait pas quelques désagréments ? Que vaut la vie, si elle ne vous procure pas des sensations fortes, vous permettant, pour un instant au moins, d’exister pleinement ?
Je regardai mon verre. Il était vide. Mauvais présage. Comme il fallait s’y attendre je me mis à réfléchir à ce que j’avais bien pu faire d’intéressant dans mon existence depuis que j’étais né. A vrai dire, je ne trouvais rien de vraiment marquant. J’aurais pu n’avoir jamais existé, le cours de l’univers n’en aurait pas été ébranlé le moins du monde. Alors ? Alors il me semblait subitement que la vie si courte d’Alasina avait finalement eu plus de sens que la mienne. Je travaillais dans une grande ville, je m’y ennuyais assez bien, pour me divertir je venais passer quelques jours ici, dans cette campagne boisée, et puis ? Et puis plus rien. Le cercle se refermait sur le vide. De ma vie, il n’y avait rien à dire et nul écrivain n’aurait pu broder sur elle. C’était à désespérer.
Quant à ma compagne du moment, je me rendais bien compte que je ne tenais pas énormément à elle, en fin de compte. J’étais content de la voir, on passait de bons moments ensemble, mais est-ce que ma vie était bouleversée quand elle apparaissait ? Est-ce que le cours de mon existence s’en trouvait modifié ? Non, pas le moins du monde. Alors une sorte de cafard s’empara de moi, une de ces tristesses bien solides qui ne vous lâchent pas de si tôt.
Pour tenter de me secouer, je suis allé à la cave chercher une deuxième bière. Je l’ai ouverte sans même m’en rendre compte et je me suis mis à boire en tentant de savoir ce qu’était vraiment l’amour. Alasina aimait, elle savait ce qu’aimer voulait dire, il n’y avait pas à en douter. Mais quelque part, était-elle vraiment elle-même dans le paroxysme de sa passion ? Elle ne vivait plus pour elle, mais pour l’Autre, cet autre avec qui elle aspirait de partager sa vie. Paradoxalement donc, pour que l’existence de la jeune fille prît un sens, il avait fallu qu’elle sortît d’elle-même, qu’elle sacrifiât tout ce qu’elle était pour le donner comme un présent à l’être aimé. Et dans son cas ce don de soi était allé jusqu’à la mort. La vie ne valait donc quelque chose que si on était disposé à la sacrifier. Il me semblait que Malraux, dans « La Condition humaine » avait dû dire quelque chose d’approchant. Il faudrait à l’occasion que je recherche la citation précise. En d’autres termes, cela revenait à se demander s’il valait mieux mener sagement une existence longue et tranquille ou au contraire vivre intensément quelques instants privilégiés en prenant le risque de tout perdre.
J’ai continué à boire ma bière en réfléchissant à tout cela. A la fin j’ai dû m’endormir car quand j’ai ouvert les yeux l’aube filtrait déjà à travers les fentes des volets. Quant à moi, j’étais affalé dans mon fauteuil, avec un mal de tête pas possible. J’avais trop bu, c’était clair. Il faut dire que j’en avais complètement perdu l’habitude. Du coup, les folles années de ma jeunesse me revinrent en mémoire et le poids des ans me parut d’autant plus lourd à supporter. Des images se mirent à défiler devant mes yeux, à un rythme de plus en plus rapide. Des paysages de montagne : les Alpes, les Pyrénées, l’Aubrac, la Margeride, les Cévennes… Puis des plages immenses, celles de l’Atlantique, ravagées par les tempêtes d’équinoxe ; un village de Provence, écrasé de soleil ; les forêts du nord-est, ténébreuses et mystérieuses ; les falaises de Bretagne et leur granit rose ; une petite église romane, perdue quelque part en Auvergne… Les images s’accéléraient et plus elles allaient vite, plus ma tête tournait. Maintenant je voyais des visages. Des amis étudiants, perdus de vue depuis si longtemps ; une jeune fille juive, que j’avais aimée à vingt ans ; une femme jeune encore, qui me souriait dans un train… Puis soudain tout s’arrêta, comme si la pellicule s’était cassée. Seule la bobine continuait à tourner à vide, actionnée par le moteur du projecteur.
La vacuité de mon existence actuelle me saisit d’effroi. Tous ces gens que j’avais connus, qu’étaient-ils devenus ? Je n’en savais strictement rien. Ils avaient compté, pourtant, dans mon existence. J’avais épousé leurs idées ou je m’y étais opposé, peu importe, mais ils avaient contribué à faire, sans doute sans le vouloir, celui que j’étais devenu. Un à un ils avaient quitté la scène de ma vie. Certains étaient partis à l’étranger, d’autres s’étaient mariés et avaient disparu, d’autres encore étaient déjà passés de l’autre côté du rideau, celui qu’on ne franchit qu’une fois. Quant à moi, je me retrouvais seul, assis ou plutôt couché dans ce fauteuil, contemplant d’un œil étonné l’aube qui se levait, une aube aussi improbable que tout le reste.
Je poussai un soupir. Mon regard se posa sur le livre de nouvelles, qui était tombé à terre. J’enviais la force d’Alasina, la manière dont elle avait aimé Bukuran. Je l’enviais lui aussi, d’avoir été aimé de la sorte. Puis je me dis que la littérature avait quand même l’art de condenser en quelques pages tout ce qu’il y avait d’important dans une vie. Alors j’ai tendu la main pour reprendre le livre et j’ai lu le titre de la deuxième nouvelle.
Chapitre 10
« Délire de persécution » par Pierre d’Autrecourt de Pomency.
Puisqu’on me laissait la liberté de me promener dans les couloirs, je n’allais pas m’en priver. Voilà déjà deux bonnes heures que l’infirmière m’avait installé dans ma chambre et je commençais à m’ennuyer. A part un peu de linge dans ma petite valise et une brosse à dents, je n’avais vraiment pas eu grand-chose à ranger. J’avais bien regardé par la fenêtre, mais on ne voyait que des toits de zinc sur lesquels la pluie tombait doucement, avec une tristesse infinie qui me donnait le cafard. J’ai fait un effort, pourtant, pour m’intéresser à ce spectacle et j’ai essayé de compter le nombre de gouttes de pluie qui devaient tomber en même temps sur toute la surface du toit. J’ai donc d’abord dû évaluer la surface de cette toiture, ce qui ne fut pas aisé, étant donné qu’il y avait des aspérités et des rebords. Pourtant, après de nombreux calculs, je suis arrivé à un chiffre approximatif dont je dus bien me contenter. Pour avoir le chiffre exact, j’aurais dû m’armer d’un mètre et arpenter le toit. Cela n’aurait pas été impossible, puisqu’il était plat. Il aurait suffi de faire passer une échelle par la fenêtre de ma chambre, de lui donner la bonne inclinaison et puis de descendre pour mesurer. Mais vous me voyez demander une échelle aux médecins pour aller mesurer un toit sous la pluie ? Ils allaient encore trouver que j’avais des idées bizarres, ce qui est leur manière à eux de dire que je suis fou.
Et puis, une fois sur le toit, je n’aurais pas été sauvé. Il aurait fallu compter les gouttes de pluie qui tombent sur une surface d’un centimètre carré. Cela n’a l’air de rien, mais c’est un exercice assez difficile. Je m’y suis essayé souvent sans jamais vraiment y parvenir. La difficulté tient au fait que la pluie est transparente et donc peu visible et au fait qu’elle est liquide et donc fuyante. A peine tombée sur le toit humide, elle disparait aussitôt pour se mêler aux autres gouttes qui l’ont précédée. Et à supposer que j’arrive quand même à déterminer le nombre de gouttes (en acceptant qu’il soit approximatif, ce qui est tout de même dérangeant pour l’esprit cartésien que je suis) il me faudrait encore multiplier ce chiffre par le nombre de centimètres carrés de la toiture. N’ayant pas de calculatrice à ma disposition dans cet hôpital (ils ont sans doute peur qu’on ne l’ingurgite par inadvertance), il me faudrait effectuer l’opération mentalement, ce qui augmenterait encore le risque d’erreur. Au final, je me retrouverais avec un chiffre qui ne serait qu’une pure hypothèse puisque la surface, le nombre de gouttes et le calcul mathématique sont tous très approximatifs. Il me faudrait recommencer l’opération une bonne dizaine de fois et effectuer une moyenne pour enfin proposer un chiffre qui, selon toute vraisemblance, se rapprocherait de la réalité. Pourtant, une nouvelle fois, si je proposais ce chiffre au médecin venu m’examiner, il dirait que je suis fou de me préoccuper de telles sottises. Il aurait tort, cependant. En effet, lui qui se dit si savant, il serait bien incapable de me donner le moindre chiffre puisqu’il ne s’est même jamais posé la question de savoir combien de gouttes d’eau tombaient en même temps sur un toit. Je vois là un manque de curiosité manifeste. De la part de quelqu’un qui prétend raisonner scientifiquement, je trouve cela désolant.
Enfin passons. Quand j’en ai eu assez de tous mes calculs et quand je me suis rendu compte une nouvelle fois que je n’atteindrais jamais la vérité, je suis sorti de ma chambre. Il fallait quand même bien que je fasse connaissance avec ma nouvelle résidence. Surtout qu’on m’avait fait comprendre que je risquais d’y rester fort longtemps. J’avais bien essayé de savoir si on comptait me libérer définitivement un jour, mais tout le monde était resté très évasif sur ce sujet pourtant crucial. On a parlé de sorties provisoires, de sorties sous surveillance, de promenades réglementées, mais jamais vraiment de sortie pure et simple. C’est regrettable car ils se trompent lourdement. J’ai déjà essayé de leur expliquer que ma logique et ma manière de raisonner dépassent de loin la leur, mais ils ne veulent rien entendre. Ils disent que je souffre d’un délire de persécution et qu’à cause des idées que je me mets en tête, je pourrais être dangereux pour autrui. Quelle folie ! Si j’avais peur de quelqu’un, je m’enfuirais aussitôt et je ne m’avancerais pas vers lui pour le tuer. Cela tombe sous le sens, mais ils ne veulent rien comprendre. Par contre, à force de me répéter à tort que je souffre d’un délire de persécution, ils vont finir par le provoquer, ce délire. Car petit à petit, oui, je me sens méprisé par tous ces médecins qui croient détenir le savoir et qui ne détiennent rien du tout. La preuve, ils ne pourraient même pas vous dire combien de gouttes d’eau sont tombées sur le toit tout à l’heure.
J’ai continué à me promener un peu partout. Les infirmières que je croisais me regardaient d’un air étrange, sans doute parce qu’elles ne me connaissaient pas. Peut-être même me prenaient-elles pour un simple visiteur, mais bon, de toute façon je n’aime pas cette manière suspicieuse qu’ont certaines personnes de me dévisager. J’ai toujours l’impression qu’on me reproche quelque chose et qu’on va m’attaquer au moment où je m’y attends le moins. J’ai déjà expliqué tout cela aux médecins, mais ils y ont vu une preuve de ma « maladie », alors qu’à l’évidence c’est le contraire : c’est le monde qui est agressif à mon égard. Enfin, passons…
Après avoir erré pas mal de temps dans le bâtiment et après m’être perdu plusieurs fois, je suis finalement arrivé au bout d’un long corridor. Après, il n’y avait plus rien, sauf une fenêtre qui donnait sur le vide. Au loin, on distinguait une forêt, mais elle était si loin qu’on aurait dit un rêve inaccessible. Par contre, le gouffre à mes pieds, on le voyait bien, lui. Il aurait suffit de pas grand-chose pour que tout s’arrêtât là et pour que mes problèmes prissent fin. Peut-être alors comprendraient-ils enfin que je n’étais pas plus fou qu’eux et que c’est par désespoir que j’en étais arrivé à cette extrémité, à cause de leur regard accusateur, en quelque sorte. Mais je les connaissais trop bien. Ils verraient encore dans mon désir de quitter la vie une preuve supplémentaire de ma folie. Pourtant, cette vie, ils la quitteraient eux aussi un jour. Un peu plus tôt, un peu plus tard, qu’est-ce que cela changerait, finalement ? En quoi serait-ce une preuve de folie de vouloir s’en aller en pleine santé ? Ne serait-ce pas mieux que de s’accrocher désespérément à l’existence à quatre-vingt-dix-neuf ans alors qu’on souffre de partout ? Et tous ces médecins n’auraient-ils pas, eux aussi, la tentation d’en finir si on leur annonçait qu’ils étaient atteints d’une maladie incurable et très douloureuse ? Pourtant c’est le cas. Nous sommes tous concernés et dès notre naissance notre fin est déjà programmée. Enfin, laissons cela, chaque fois que j’ai voulu leur expliquer mon point de vue, ils n’ont rien trouvé de mieux à faire que d’augmenter ma dose de médicaments. Et puis de toute façon, les fenêtres ne s’ouvrent pas dans cet hôpital, je viens de vérifier.
Bref, j’allais regagner ma chambre quand j’ai aperçu une porte entrebâillée. Et c’est alors que je l’ai vue. La petite Sarah ! On était à l’école primaire ensemble. Elle avait toujours été folle, elle, ça se voyait à son regard et c’est bien parce qu’on était dans un petit village que l’instituteur l’avait acceptée avec les autres élèves. En ville, elle aurait été enfermée tout de suite. D’ailleurs à douze ans elle ne savait toujours pas lire et elle n’avait jamais dépassé le CE1. La retrouver ici était donc normal et à vrai dire c’est plutôt le contraire qui aurait été étonnant. Elle était attachée sur sa chaise avec une espèce de ficelle en tissu. Elle m‘a regardé d’un air vague, manifestement sans me reconnaître. Dans le fond, je préférais cela, je n’avais pas trop envie d’engager une conversation qui n’aurait débouché sur rien. Qu’est-ce qu’on aurait bien pu se dire ?
– Tiens, Sarah, c’est toi ?
– Oui, c’est moi.
– Ca va ?
– Oui ça va et toi ?
– Moi ça va aussi. Qu’est-ce que tu fais ici ?
– Ben la même chose que toi…
Et là, à cette idée, mon estomac s’est serré. Car en effet, je me retrouvais dans le même hôpital qu’elle. Ce n’était même pas un hôpital, mais carrément un asile, n’ayons pas peur des mots. La différence entre Sarah et moi, c’est qu’elle était folle depuis l’école, depuis toujours même. Sa présence en ces lieux se justifiait. Elle aurait même dû y naître et si sa mère avait eu un peu de jugeote c’est ici qu’elle serait venue accoucher. Mais moi ? Moi si brillant en CM2 et plus tard au lycée, moi qui remportais tous les prix ? Était-ce logique qu’on m‘ait enfermé ici, avec cette idiote qui n’avait même jamais pu écrire son nom et encore moins déchiffrer le moindre livre ? C’était non seulement injuste, mais même révoltant.
Pendant que je raisonnais ainsi, l’idiote me fixait de ses yeux globuleux et vides. On aurait dit qu’elle cherchait une image dans le fond de sa mémoire, une image oubliée, qui remontait à loin. Je l’ai regardée méchamment, car je savais déjà ce qui allait se passer. Et en effet, après quelques secondes, j’ai vu son visage s’éclairer d’un semblant d’intelligence tandis que d’une voix balbutiante elle essayait de prononcer mon prénom. Là c’était trop, beaucoup plus que je ne pouvais en supporter, en tout cas. Il faut me comprendre. Me retrouver dans le même établissement que cette fille dont nous nous étions tous moqué quand nous étions enfants, ce n’était déjà pas gai, mais qu’elle se permette de faire comme si elle me connaissait, là c’était vraiment trop. Bientôt elle engagerait un semblant de conversation en utilisant les trois seuls mots qu’elle avait jamais pu retenir et ce serait pour évoquer notre enfance commune et souligner tout ce qui nous rapprochait. Non, je ne pouvais pas tolérer cela. Si je la laissais faire, on allait me croire aussi fou qu’elle. Car je devinais son intention. Elle avait le fond méchant, c’était certain et elle allait essayer de me mettre sur le même pied qu’elle, pour m’humilier au maximum.
Alors je suis entré dans sa chambre, j’ai délié une des ficelles qui l’attachaient et au moment où elle me faisait un grand sourire, croyant que j’allais la délier complètement, j’ai passé la ficelle autour de son cou et j’ai serré le plus fort possible.
Quand je suis parti, elle avait toujours le même regard vague, mais encore plus fixe que d’habitude. Quant à sa langue, elle sortait de sa bouche comme un serpent hideux et tout visqueux. Comme cela, elle avait vraiment une tête de folle et c’était à faire peur. Je me suis enfui et j’ai regagné ma chambre. Le problème, c’est que depuis cet incident ils m’ont enfermé à clef. Ils sont à deux doigts de me prendre pour un fou dangereux. Quand je disais que tout le monde m’en voulait…
 Chapitre 11
Chapitre 11
Il était maintenant dix heures du matin. J’ai ouvert les volets et le soleil m’a aussitôt ébloui. La ligne bleue de la forêt occupait tout l’horizon. Le contraste était saisissant entre le salon, où je lisais, plongé dans une quasi-obscurité, et cette nature écrasée de lumière. J’ai d’abord cligné des yeux, puis j’ai de nouveau regardé. A mes pieds, le village vivait sa petite vie tranquille. Le facteur était occupé à relever le courrier, un vieux monsieur sortait de la boulangerie, un pain sous le bras, et plus loin un chien flânait, profitant de la douce chaleur. N’étais-je pas un peu fou, de rester ainsi enfermé dans le noir, penché sur un vieux livre, alors que la vie était là, à portée de ma main, si simple, finalement ?
Mais la nouvelle que je venais de lire me trottait en tête. N’avions-nous pas tous un grain de folie caché au fond de nous ? Moi, par exemple, qui appréhendais l’existence par le biais des livres, avais-je raison d’agir ainsi ? Et ce facteur qui depuis vingt ans au moins apportait des lettres aux mêmes personnes, cela avait-il plus de sens ? Il répétait le même acte par habitude, ce qui lui évitait de penser à sa destinée et à la mort qui l’attendait au bout du chemin. Et le vieux monsieur, qu’espérait-il en allant acheter son pain ? Que la vie continuerait ainsi éternellement ? Oui, elle continuerait, en effet, mais bientôt ce serait sans lui. Alors, cela avait-il un sens de faire comme si de rien n’était ? Quant au chien, c’était peut-être encore le plus sage de tous. Il ne travaillait pas, se faisait nourrir par des maîtres affectueux et passait sa journée à flâner où bon lui semblait, jouissant de la vie…
Puis je me suis mis à réfléchir. Tous ces gens qui ne pensaient qu’à s’enrichir, par tous les moyens… Quel sens cela avait-il ? Aucun, évidemment. Ils ne parlaient que de compétitivité, de travail, de performance. Ils écrasaient les autres, mettaient la pression sur leurs ouvriers et leurs employés, puis les licenciaient éventuellement sans le moindre remords. Et tout cela pourquoi ? Pour le plaisir d’être toujours plus riches. La véritable folie n’était-elle pas là, plutôt que derrière les grilles d’un asile ? Quant aux dirigeants politiques, ils ne valaient pas mieux. Assoiffés de pouvoir, ils ne pensaient qu’à atteindre le sommet, pour le plaisir de diriger et de se sentir craints et respectés par tous les citoyens. N’était-ce pas complètement ridicule ? La vie n’était-elle que cela ? Non bien sûr, la vie elle était là, devant moi, avec cette grande forêt et ce soleil éclatant.
Puis l’histoire d’Alasina m’a de nouveau traversé l’esprit. Voilà quelqu’un qui avait vraiment voulu goûter à l’existence et vivre pleinement sa vie. Mais finalement, en privilégiant l’amour et en négligeant les règles absurdes des hommes, elle avait certes fait le seul choix valable, mais elle en était morte. Fallait-il donc considérer qu’elle aussi était atteinte de folie ? Est-ce que vouloir aller jusqu’au bout de ses passions est trop demander ? N’est-ce pas déjà vouloir l’impossible et donc une preuve de folie ?
Je ne savais plus, je me perdais dans mes raisonnements. J’ai refermé les volets et je suis allé m’étendre. J’ai dû dormir longtemps, car quand je me suis réveillé la nuit était tombée. Ca m’a fait une drôle d’impression, en ouvrant la fenêtre, de voir qu’il faisait complètement noir. Une fraction de seconde j’ai même cru que j’étais devenu aveugle pendant mon sommeil. Mais non, ce n’était que la nuit qui avait englouti le monde. Alors je suis retourné vers mon livre et j’ai commencé à lire la troisième nouvelle.
Chapitre 12
De cette nouvelle, je ne pourrais donner ni le titre ni l’auteur, car deux feuillets avaient été arrachés au livre, ce qui m’a fort contrarié je dois dire quand j’ai découvert cela. Connaître le nom de l’auteur, je m’en moquais bien, dans le fond, et quant au titre, ce n’était pas tellement important, mais les quatre pages de texte perdues, cela ça me dérangeait considérablement. Les premières lignes que j’ai pu lire parlaient d’un homme jeune encore qui remontait le fleuve Congo. Comment s’était-il retrouvé là et dans quel but ? Cela resterait à jamais un mystère pour moi. Il me fallut bien admettre que je ne connaîtrais jamais les débuts de cette histoire. Pour me consoler, je me suis dit que lorsqu’on rencontre une femme, on ne sait rien non plus de sa vie antérieure, mais pourtant cela n’empêche pas de faire sa connaissance et d’essayer de construire quelque chose avec elle. Eh bien, pour cette nouvelle, ce serait la même chose. D’ailleurs le peu que j’en avais lu me plaisait déjà et j’avais hâte de connaître la suite.
Un homme jeune donc, d’une bonne trentaine d’années, remontait le fleuve Congo sur une pirogue. Casque colonial blanc, pagayeurs indigènes, de nombreux bagages entassés à l’arrière de l’embarcation… On devait être au milieu ou à la fin du XIX° siècle, à une époque où ces contrées de l’Afrique équatoriale étaient encore quasi inexplorées. On progresse lentement car le courant est fort et puissant. Impossible d’ailleurs d’espérer rester au milieu du fleuve, il faut longer les berges si on veut avancer. Mais les hommes sont fatigués, on le voit à la lenteur avec laquelle les pagaies frappent l’eau. Les mouvements ne sont même plus synchronisés et bientôt la pirogue va se mettre de travers et sera emportée irrémédiablement dans l’autre sens. Inutile de retourner d’où l’on vient, aussi l’homme blanc donne-t-il l’ordre de mettre pied à terre et de dresser le camp. Il est vrai que le soir tombe vite dans ces contrées. Il ne s’y fera jamais tout à fait. L’instant d’avant le soleil vous écrase de ses rayons et subitement c’est la nuit noire, la terrible nuit équatoriale, impénétrable et remplie de milliers de cris mystérieux. Bref, il est plus que temps de s’arrêter si on veut monter la tente et installer la moustiquaire. Le plus âgé des Noirs désigne du doigt une petite plage sablonneuse. C’est l’endroit rêvé, il n’y a pas à dire. Ces hommes qu’on dit sauvages ont tout de même un sens pratique contre lequel aucun Blanc ne pourrait rivaliser. Notre jeune explorateur le sait et il ne serait pas arrivé jusqu’ici s’il avait dû se fier à son seul instinct. Loin de mépriser ses compagnons de couleur, comme il a vu de nombreux colons le faire, il a plutôt pour son équipe le respect qu’impose le danger omniprésent. Dans un tel contexte, au milieu d’une nature si hostile, il n’y a que les autochtones pour vous sortir de tous les mauvais pas où vous vous êtes fourré.
Pendant qu’on montait sa tente, il s’assit sur un tronc d’arbre et regarda devant lui. Là-bas, loin, très loin, on devinait l’autre rive, perdue dans une sorte de brouillard de chaleur. A quelle distance devait-elle être ? Huit cents mètres, un kilomètre ? Il aurait tendance à dire davantage encore, mais la prudence l’empêche d’avancer un chiffre totalement déraisonnable. Il se souvient de l’estuaire de la Gironde, chez lui à Bordeaux, entre la pointe du Grave et Royan. C’est à peu près la même chose, sauf qu’ici il ne s’agit pas d’un bras de mer qui s’avance dans les terres, mais d’un fleuve, le fleuve le plus grand et le plus puissant d’Afrique centrale. Il en reste tout pensif. Comme l’Europe lui semble lointaine et ridiculement petite. Rien d’étonnant à ce qu’il ait voulu la quitter. Enfant déjà, il se sentait à l’étroit dans son milieu familial de province et il rêvait d’aventures et de grands espaces. Pour ce qui était de ces grands espaces, il était servi, maintenant, il n’y avait pas à dire. Le dépaysement était total. La nature, ici, était encore vierge et devait ressembler à ce qu’elle avait été lors de la création du monde. Enfin, pour ceux qui croient à ces sornettes radotées par les curés… Lui, il arborait fièrement son athéisme et son esprit libre, ce qui avait maintes fois scandalisé ses tantes lors des déjeuners dominicaux. Il prenait d’ailleurs un malin plaisir à les heurter de front et quand il voyait leur air apeuré de poules découvrant le renard dans le poulailler, il quittait la table en riant sous cape. Aussi, le jour où il annonça à toute la famille qu’il comptait s’embarquer pour l‘Afrique, ce fut un soulagement pour tout le monde, à commencer par son père qui ne supportait plus son refus systématique de se plier aux règles de la bienséance.
Il embarqua donc un beau matin à Marseille pour l’Algérie. De là, il gagna les Açores, puis, sur un vieux rafiot portugais, il se mit à longer la côté du continent noir, allant de port en port, mais toujours en direction du sud. Le peu qu’il voyait de l‘intérieur des terres le fascinait, mais en même temps il était bien le seul Blanc à raisonner de la sorte. Les marins, sur le bateau, ne s’intéressaient qu’à la navigation et quant à ceux qui l’avaient affrété ce bateau, ils ne pensaient qu’à faire du commerce et à s’enrichir. Les denrées étaient acheminées vers la côte à dos de chameaux ou bien elles arrivaient par les fleuves sur d’immenses radeaux. Ce qui importait, c’était de mettre la main sur toutes ces marchandises, de les charger sur le rafiot le plus vite possible, puis de rentrer en Europe pour les revendre, en empochant un bénéfice absolument scandaleux.
Mais lui, le jeune homme, il s’en moquait bien de ces tractations commerciales. Ce qui l’intéressait, c’était le cœur de ce continent inconnu. Il fit tant et si bien qu’il se retrouva un beau matin en train de remonter le fleuve Congo depuis son embouchure. Voilà maintenant vingt jours qu’il s’enfonce en plein mystère dans une terre vierge où l’homme blanc n’a pratiquement jamais mis le pied. Ce qu’il voit, loin de le décourager, l’incite à poursuivre son voyage le plus loin possible, comme si là-bas, tout au bout, il allait enfin trouver ce qu’il avait toujours cherché : un sens à sa vie. Lassé de son existence bourgeoise dans la France de province, il lui semblait qu’au terme de ses aventures, quand il atteindrait enfin le bout du monde, une sorte de vérité se ferait jour. Sans trop savoir d’ailleurs si cette vérité se trouvait dans un endroit géographique bien déterminé ou si au contraire elle était dans le voyage même et dans les dangers qu’il devait surmonter pour atteindre ces terres aussi vierges qu’inconnues. En effet, n’était-ce pas plutôt un combat contre lui-même qu’il était en train de livrer, afin de se prouver qu’il était capable de surmonter sa peur ? Ou alors, qui sait, ces pays inexplorés où nul n’avait jamais pénétré représentaient peut-être un espoir. Là-bas, la civilisation n’avait encore fait aucun ravage et l’homme devait y être libre. C’est du moins ce qu’il imaginait et c’était bien pour cela bien qu’il luttait contre la chaleur, l’humidité et les moustiques sans se plaindre : il voulait savoir ce qu’il y avait « au-delà ». Il ne mettait donc pas son salut, comme certains, dans un futur temporel aussi incertain qu’improbable (il ne croyait d’ailleurs à aucun paradis et se moquait sarcastiquement des religions, on l’a déjà dit). Non, pour lui, cette vie rêvée autant qu’espérée devait se trouver quelque part, dans un lieu inconnu et donc forcément éloigné de tout.
En attendant, il regardait le fleuve qui coulait à ses pieds. Celui-ci était d’un incroyable jaune-rouge et charriait des dizaines de troncs d’arbre. Il avait dû pleuvoir abondamment en amont. Finalement, cette région mystérieuse et fabuleuse qui constituait le centre de l’Afrique n’était peut-être qu’un immense marécage, battu par des pluies incessantes et où les maladies et les épidémies rendaient toute vie humaine impossible. Ou bien au contraire il y avait là d’immenses montagnes verdoyantes, où une végétation luxuriante proliférait grâce à l’action conjuguée de la chaleur et de l’humidité. Allons, encore deux ou trois semaines de navigation et il serait fixé. Il saurait enfin si son rêve tenait de l’enfer ou du paradis.
Il était donc là sur la berge, rêvassant et ne faisant rien. Il s’aperçut que sa tente était déjà montée et il alla aider les Noirs à décharger le reste des bagages. Ils n’avaient pas terminé que déjà la nuit était tombée. On fit un grand feu pour cuire la nourriture (du riz apporté de la côte avec la viande d’un singe abattu dans la journée). Tout le monde se taisait en regardant les flammes qui dansaient. Les indigènes étaient exténués d’avoir ramé toute la journée à contre-courant et quant au chef de l’expédition, il revoyait défiler devant ses yeux les images de tous les paysages qu’il avait traversés.
C’est alors que le plus âgé des Noirs commença à raconter une histoire. Ce devait être un conte, mais il était difficile d’en saisir le sens exact car le vieil homme s’exprimait en bantou, langue que notre héros connaissait à peine pour ne pas dire pas du tout. Il parvint pourtant à saisir quelques mots et comprit qu’il s’agissait d’un léopard qui était tombé amoureux de la fille d’un roi. Il voulait l’épouser à tout prix, mais le conseil des sages avait refusé sa demande, prétextant qu’il n’était qu’un animal. Ensuite, il y avait quelques péripéties assez obscures et à la fin le léopard enlevait la princesse, qui se transformait aussitôt en femelle léopard. Le roi ne put donc jamais retrouver sa fille, malgré toutes les recherches qu’il entreprit. Ce jour-là, les animaux remportèrent une grande victoire sur les humains, car le Grand Esprit de la forêt et de la savane les protégeait.
Sur cette morale inquiétante, tout le monde alla dormir, le Blanc dans sa tente et les Noirs à même le sol, près de ce qui restait du feu, où charbonnaient encore quelques braises.
Chapitre 13
Le lendemain, on partit à l’aube. Impossible d’ailleurs de rester une heure de plus en cet endroit. La nuit, les insectes n’avaient pas arrêté de tourner autour de la moustiquaire et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur obstination avait été payante. Certains avaient fini par trouver les rares trous minuscules disséminés sur la surface de la toile. Une bonne dizaine d’énormes moustiques avaient donc fait connaissance avec l’homme blanc endormi, lequel s’aperçut très vite de leur présence. Mais à part se gratter à sang, il ne put pas faire grand-chose, même pas se rendormir. C’était impossible, car il entendait le vrombissement strident de toutes ces bestioles et au moment où il donnait un coup à gauche, croyant en exterminer l’une ou l’autre, il se faisait cruellement piquer du côté droit. Tout cela dans une nuit d’encre qui empêchait de voir l’ennemi, cela n’avait rien de réjouissant et il y avait de quoi perdre patience. Quand enfin, vers quatre heures du matin, il finit par s’assoupir d’épuisement, il fut aussitôt réveillé par les oiseaux de la forêt, qui se mirent à siffler tous ensemble en un concert impressionnant.
Quand il sortit de sa tente, les Noirs dormaient encore près du feu éteint. A première vue les moustiques ne les empêchaient pas de dormir, eux ! Au regard incrédule qu’ils lui jetèrent, il comprit qu’il était quasi défiguré par les piqûres d’insectes. Tant pis, à la guerre comme à la guerre ! Une terre inconnue l’attendait aux sources du fleuve et il y arriverait. Ce n’était quand même pas trois bestioles minuscules qui allaient l’empêcher d’atteindre son but. On replia la tente, on remit tous les bagages dans la pirogue et on déjeuna sur le pouce de deux bananes. Le vieil indigène, celui qui avait raconté l’histoire du léopard, mangeait même la peau épaisse et jaune de ce fruit exotique. Il la mâchait lentement et consciencieusement, assurant à chaque fois qu’on l’interrogeait que la force de la banane était là, dans cette peau à première vue indigeste, mais qui lui permettait, lui, de ramer toute une journée malgré son grand âge et cela sans plus absorber la moindre nourriture avant la nuit.
On poussa la pirogue dans l’eau et on se mit à pagayer. Le courant était plus fort encore que la veille et on fit comprendre au grand chef blanc que si cela continuait ainsi, si le fleuve persistait à montrer sa colère, il faudrait se résoudre à attendre qu’il se calmât. Car le fleuve était un dieu, lui expliqua-t-on et il n’est jamais bon d’aller contre ses volontés. S’il a décidé de nous empêcher de remonter jusqu’à sa source, il ne faut pas s’opposer à son désir. Son esprit est partout et si vous désobéissez, il vous retrouvera où que vous soyez. Mais l’idée de rester inactif pendant deux bonnes semaines ne plaisait pas à l’explorateur occidental, qui était animé par l’énergie propre à sa race et qui ne comprenait pas qu’on pût vivre au rythme de la nature en se pliant à ses caprices. « Si on ne peut plus ramer, nous continuerons à pied. » Les Noirs le regardèrent, incrédules. Un Blanc, à pied ? On n’avait jamais vu cela !
Pourtant, vers midi, il devint évident pour tout le monde qu’on ne pouvait plus continuer ainsi. On avait beau ramer et ramer, pagayer en cadence et en chantant, rien n’y faisait : le bateau n’avançait pas. Parfois, même, il reculait après avoir pivoté sur lui-même et on avait alors toutes les peines du monde à le remettre dans le bon sens. Bref, si on avait progressé d’un petit kilomètre depuis l’aube, c’était le maximum. On tira la pirogue sur le rivage et comme tous les bagages étaient à l‘intérieur, ainsi que tous les vivres, il fut décidé qu’on la porterait. Cela permettrait de l’utiliser de nouveau dans quelques semaines, quand la force du courant serait devenue plus raisonnable. On se mit donc en route. Deux hommes ouvraient la voie, tranchant sans pitié la végétation luxuriante afin d’ouvrir un passage. Puis six Noirs suivaient, portant la pirogue et tout son chargement. Enfin les deux derniers fermaient la marche, tenant chacun le côté d’une planche sur laquelle était assis l’homme blanc. Celui-ci encourageait son équipe en criant sans arrêt et en exhortant tout le monde à avancer.
Pour ce qui était d’avancer, on avançait, plus vite assurément que sur le fleuve en crue, mais à ce rythme-là, il était clair qu’on ne ferait pas cinq kilomètres sur la journée. La plus grosse difficulté, c’était pour les hommes qui portaient l’explorateur. Comment voulez-vous avancer tout en tenant latéralement une planche de bois pesant soixante-quinze kilos avec son fardeau ? C’était impossible ! Déjà ils étaient obligés de se pencher car la planche était basse, mais en plus ils devaient incliner le corps sur le côté, ce qui fait que leur démarche ressemblait à celle des crabes.
On fit un arrêt et on changea de méthode. L’homme blanc se retrouva assis dans la pirogue, toujours portée par les six Noirs, tandis que les deux autres derrière croulaient littéralement sous les bagages. Ils en avaient sur le dos, sur les épaules, en équilibre sur la tête et ils en portaient encore dans leurs bras. C’est bien simple, on ne les voyait plus sous cet amas hétéroclite, qui faisait un bruit métallique à chaque pas à cause des piquets de tente qui s’entrechoquaient. Tout ce qu’on apercevait, c’était leurs yeux apeurés, car ils craignaient de trébucher contre une racine et de tout faire tomber.
Après un kilomètre, tout le monde était exténué, même le Blanc dans sa pirogue, qui avait tellement crié pour guider son petit monde qu’il n’avait presque plus de voix. On changea encore de tactique. Cette fois, quatre hommes portèrent la pirogue vide pendant que trois se chargeaient des bagages, que deux ouvraient la route à coups de machette et que le dernier portait l’explorateur sur son dos. Juché comme il l’était en hauteur, il dominait la situation et donnait ses instructions à qui voulait l’entendre. En réalité, plus personne ne l’écoutait et tout le monde marchait machinalement sans penser à rien dans la chaleur étouffante. Il fallait être attentifs à ne pas se couper aux feuilles de fougères géantes qui, à peine tranchées, retombaient devant les pieds des marcheurs. Il fallait faire attention aux nuages d’insectes qui vous enveloppaient de leur masse bourdonnante ainsi qu’aux serpents qui, eux, trainaient dans les branchages et risquaient de vous tomber dessus à tout moment. Il fallait enfin éviter de marcher sur les araignées qui pullulaient au sol et dont la moindre morsure pouvait être fatale. Alors si en plus de tout cela il avait fallu écouter l’homme blanc, qui vociférait dans une langue que les pauvres Nègres entendaient à peine, c’est sûr qu’on allait encore avancer moins vite.
Vers dix-sept heures on s’arrêta pour dresser la tente. Tout le monde était exténué. On mangea le reste du singe, qui était maintenant légèrement faisandé, accompagné d’un riz blanc et collant, le même que la veille et qui était toujours aussi insipide. Il n’y eut pas de conte ce soir-là et à peine le repas terminé, tout le monde s’endormit.
Le lendemain à l’aube, la petite troupe fut réveillée par une dizaine de singes qui s’étaient mis en tête d’inspecter le campement. Certains étaient déjà en train de puiser dans la réserve de riz quand l’alerte fut donnée. L’homme blanc sortit précipitamment de sa tente et en deux coups de fusil il rétablit la situation. Deux cadavres restèrent à terre, tandis que les autres singes s’enfuyaient vers la cime des arbres en criant. Le dîner du jour était déjà assuré. Voilà une journée qui commençait bien. L’explorateur en profita pour dire qu’il fallait rattraper le temps perdu la veille et qu’il espérait bien faire quinze kilomètres aujourd’hui. Le plus vieux des Noirs le regarda et il dit simplement : « Alors toi aussi ti marches et toi aussi ti portes bagages. » Les deux hommes se dévisagèrent. Ce qui venait d’être dit était très pertinent et chacun le savait. Comme ils savaient que ce qui était en jeu maintenant, c’était de savoir qui allait diriger la suite des opérations. D’un côté un Blanc qui avait la pouvoir théorique mais qui ne connaissait rien à la forêt équatoriale, de l’autre un Noir habitué à voyager à travers bois et qui connaissait son pays à fond. Si on voulait avancer et si on voulait que l’expédition fût un succès, il allait bien falloir redescendre de son piédestal et accepter de se faire commander par un indigène. C’était le bon sens même. Et comme notre explorateur n’était pas venu ici pour diriger mais pour découvrir des terres inconnues et vivre une expérience extraordinaire, il accepta les nouvelles conditions sans rien dire.
Le nouveau chef donna quelques ordres et on repartit. Il y a avait toujours deux hommes en tête, pour se frayer un passage dans la végétation, mais cette fois il n’y en avait plus que trois pour porter la pirogue vide. Du coup, les cinq derniers étaient suffisants pour porter les bagages. Quant à l’homme blanc, pour lui donner l’illusion qu’il commandait encore un peu, on ne lui fit rien porter, sauf les deux carabines, symboles par excellence de l’autorité aux yeux des Noirs.
En procédant de la sorte, on fit quinze kilomètres ce jour-là et même vingt les jours suivants. Vers midi on s’arrêtait pour manger un peu de ce riz infâme et quelques fruits cueillis dans la matinée. Le soir, on faisait un feu pour éloigner les moustiques, puis le chef racontait une histoire. Il était souvent question d’animaux dans ces contes, d’animaux qui se comportaient comme les hommes. On sentait que les Noirs les craignaient et que les véritables maîtres de l’Afrique, c’étaient eux. Le léopard occupait une place de choix dans tous ces récits, mais les oiseaux de proie également, ainsi que les lions et les éléphants. Ces derniers incarnaient non pas la force, comme on aurait pu le croire, mais l’intelligence et la mémoire. A cause des fameux cimetières où ces pachydermes ont l’habitude de venir se recueillir devant les ossements de leurs congénères morts, la mythologie primitive leur a attribué un rôle à part dans le monde animal, celui de conserver le souvenir des choses disparues. Ainsi, si une femme perdait un enfant en bas âge (ce qui, dans ces contrées sauvages, arrivait tous les jours), elle partait à la recherche d’un troupeau d’éléphants. Lorsqu’elle en avait trouvé un, elle se mettait à réciter des paroles rituelles puis exprimait sa peine par des sanglots. Pour mieux pleurer, elle se lacérait les seins à coups de lianes, puis elle tombait à genoux et attendait. On dit que si les éléphants s’approchaient d’elle, sa peine s’envolait aussitôt car elle savait alors que le souvenir de son enfant allait se perpétuer chez les dieux. Si par contre les éléphants lui tournaient le dos, l’âme du petit défunt allait hanter la forêt et se transformer en esprit méchant. Parfois, il rentrait dans le corps d’un serpent et se vengeait des vivants en leur causant des blessures mortelles.
Chaque soir, quand le vieillard avait fini son récit, on voyait que le regard des hommes exprimait une peur viscérale. L’Afrique profonde était là, autour de ce feu, au milieu de cette forêt impénétrable et le long de ce fleuve bouillonnant. La vie, ici, n’était pas seulement vécue, elle était aussi rêvée et un autre monde semblait exister à côté du monde réel, un monde de fantômes et de nuit, un monde aussi noir que la couleur de la peau des indigènes.
Chapitre 14
Ils marchèrent des jours et des jours dans une chaleur étouffante et sous une pluie soutenue. A côté du petit groupe, le fleuve n’en finissait plus de charrier ses eaux boueuses, de plus en plus jaunes, de plus en plus tumultueuses. On approchait des rapides, c’était certain. Les indigènes commençaient à montrer des mines inquiètes et même s’ils ne disaient rien on sentait la panique les gagner. Insensiblement, le vieux chef se mit à emprunter des chemins qui s’éloignaient de ce fleuve redoutable. D’abord, il prit prétexte d’une grande courbe pour prendre un raccourci, puis il évoqua des collines pentues, qu’il valait mieux éviter, ce qui lui permit de s’engager davantage encore à l’intérieur de la grande forêt. A la fin, il parla de falaises abruptes et même de gouffres infranchissables. Il fit tant et si bien qu’après une semaine on avait complètement perdu le Congo de vue. La petite troupe semblait absolument confiante, sauf l’explorateur blanc qui se demandait où on le conduisait et même si on le conduisait quelque part. En attendant, on marchait. On marchait et il pleuvait. Il n’y avait rien d’autre à faire que d’écouter la musique des gouttes d’eau qui tombaient sur les feuilles de toutes ces plantes équatoriales aussi étranges qu’insolites. Il y en avait d’impressionnantes, qui faisaient bien un mètre cinquante de long, d’autres dont les bords ressemblaient à des dents, d’autres encore qui étaient sombres comme la nuit. Il y avait celles, couvertes de glu, qui prenaient les oiseaux au piège et qui se refermaient lentement pour mieux digérer leur proie tout à leur aise ; il y en avait d’autres dont la pointe aiguë faisait penser au dard d’un frelon gigantesque ; certaines, complètement transparentes, ressemblaient à s’y méprendre à des toiles d’araignées et on avait toujours peur, en les frôlant, d’être dévoré par quelque arachnide issu de la préhistoire.
Mais le vieux chef, lui, continuait, sans se soucier de rien. Alors qu’il semblait de plus en plus évident qu’on était complètement perdus, il poursuivait sa route, imperturbable. Les Noirs eux-mêmes commençaient à se poser des questions, mais ils n’avaient pas d’autre choix que de le suivre et il fallait bien lui faire confiance. On le disait un peu sorcier, ce qui était à la fois inquiétant et rassurant. Sans doute finirait-il toujours par sauver le petit groupe, grâce à ses pouvoirs magiques, mais en attendant tous se demandaient vers quelles terres inconnues et étranges il les conduisait.
A un certain moment, le petit groupe arriva devant un immense marécage. Le grand chef noir donna clairement ses instructions. Il allait falloir marcher sans s’arrêter. Impossible de dormir en cet endroit sans prendre le risque d’être attaqué par les serpents, qui infestaient cette zone et qui chassaient principalement la nuit. Un moment d’inattention, et c’était la mort assurée. De plus, les chemins étaient mal tracés dans cette zone humide, dont la géographie se redessinait sans arrêt en fonction de la montée ou de la descente des eaux. Ici, c’est comme au bord de la mer, expliqua-t-il : il y a des marées. S’il pleut abondamment en amont, alors les eaux montent et le marécage s’enfonce. Si au contraire on est en période sèche, le niveau descend et il laisse alors au grand jour des milliers d’hectares de boue séchée. De toute façon, que l’on progresse sur cette terre émergée ou qu’on patauge avec de l’eau jusqu’aux genoux, le résultat est le même : l’air que l’on respire ici est malsain et putride et les maladies innombrables, à commencer par la malaria et la maladie du sommeil. Mais il en existe bien d’autres, véhiculées par les milliards de moustiques qui infestent la zone. La lèpre, qui fait tomber les membres, la maladie de la nuit, qui vous rend aveugle en trois jours, le biribiri, qui décolore votre peau ou le tangana, qui rend les hommes impuissants. Quant aux femmes, il était impensable de les faire traverser un tel cloaque. Les quelques-unes qui avaient essayé en étaient mortes, car pendant qu’elles marchaient dans la boue les sangsues s’étaient fixées sur leurs cuisses et avaient bu tout leur sang, tandis que de minuscules serpents s’étaient agglutinés dans leur ventre, après s’être introduits par leur sexe, et ils les avaient littéralement dévorées de l’intérieur.
Tout ce qu’il disait là, le grand chef, ne rassurait personne et même si les hommes savaient qu’il mentait un peu, comme le font toujours les sorciers, il n’en restait pas moins qu’il devait y avoir là un fond de vérité. Ils se mirent donc en route en soupirant, non sans avoir au préalable fait passer autour de leur cou tous les grigris dont ils disposaient. Seul l’homme blanc, sceptique et même un peu ironique, refusa les talismans qu’on lui proposa. Il se dit qu’habillé comme il l’était, il ne risquait pas grand-chose avec les sangsues et quant aux serpents… Hé bien on verrait ! Après tout, n’étant pas une femme, il courait déjà moins de risques. Pourtant, la petite troupe s’était à peine avancée de cinq cents mètres, qu’il avait déjà compris que ses vêtements constituaient un danger évident. En effet, gorgés d’eau saumâtre, ils étaient vite devenus incroyablement pesants, aussi marchait-il avec difficulté, retardant la progression du groupe. Par trois fois, il s’était étalé de tout son long dans l’eau fangeuse. Ne trouvant rien de solide où s’appuyer dans cet univers liquide, il avait commencé à s’enfoncer. Plus il se débattait, plus il s’enfonçait et plus l’eau saumâtre lui entrait dans le gosier. A vrai dire, c’est de justesse qu’il avait été sauvé, grâce à la rapidité des indigènes. Le vieux chef noir le regarda sans rien dire, mais avec au coin des lèvres un petit sourire qui en disait long. Bon, on était en Afrique ici, pas au milieu des Champs Elysées ! Après tout, la manière de vivre de tous ces Noirs, qu’il avait pris pour des sauvages, correspondait mieux au climat et aux dangers du pays. Sans un mot, il enleva ses vêtements trempés, qu’il rassembla comme il put dans son sac à dos et il se remit en route, aussi nu que les Noirs qui le précédaient.
On marcha ainsi trois jours et trois nuits, sans jamais s’arrêter. En effet, il aurait été impossible de trouver un coin sec où pouvoir s’étendre et se reposer. A perte de vue, ce n’était qu’une immense étendue herbeuse, entrecoupée de petits canaux fangeux. Il n’y avait aucun chemin de tracé et si on avançait, c’était grâce à l’expérience du vieux chef Noir, que les autres appelaient maintenant « Le Vieux » avec une sorte de respect mêlé de crainte. Il faut dire qu’il parvenait, Dieu sait comment, à choisir les rares touffes de gazon sur lesquelles on pouvait poser le pied sans prendre trop de risques. Sans lui, tous se seraient retrouvés enfoncés jusqu’aux genoux ou même carrément jusqu’à la taille. Il progressait lentement, tâtant le sol devant lui au moyen d’une grande perche sur laquelle il avait fixé la tête du dernier singe qui avait été mangé. Il avait aussi collé quelques plumes d’oiseaux le long du bois. Muni de cet instrument magique, véritable talisman, il ne se trompait jamais. Quand il voyait que le sol, autour de lui, était trop marécageux et qu’il était impossible d’avancer, alors il revenait en arrière et cherchait un autre passage. Ce n’était pas facile. Parfois, la petite troupe tâtonnait ainsi trois ou quatre fois, faisant des allées et venues épuisantes, mais toujours le vieux sage finissait pas trouver un semblant de chemin dans cette végétation aquatique.
A certains endroits, l’herbe était si haute qu’on ne voyait plus rien du tout. Puisant sa force dans cette eau abondante et riche en éléments organiques en décomposition, elle atteignait facilement les trois mètres de hauteur. Il fallait alors se frayer un passage à l’aveuglette, sans savoir si la direction prise était la bonne. Le pire, c’est quand il fallait rebrousser chemin. Les herbes à travers lesquelles on venait de passer s’étaient couchées et c’est un inextricable fouillis végétal qu’on avait alors devant soi. Il fallait enjamber ces tiges brisées, aux arrêtes coupantes, ou bien ramper en-dessous, mais gare alors au marécage. Un mètre trop à gauche ou trop à droite et c’était l’enlisement assuré, sans parler des serpents et des sangsues. Avec cela, il régnait dans cet enfer une chaleur moite et étouffante, qui vous oppressait la poitrine. Les visages étaient ruisselants de sueur, les torses couverts d’une boue jaunâtre et nauséabonde.
Et pourtant on avançait. A un certain moment, on quitta la région herbeuse et on pénétra dans une forêt très sombre. Ce n’est pas pour cela qu’on quitta le marécage. Non, les arbres aux troncs noirs et lisses sortaient directement de l’eau. On se serait cru dans la crypte d’une cathédrale qui aurait été inondée. C’est du moins ce que se dit l’explorateur, dont la peau blanche avait pris des reflets phosphorescents dans cette obscurité de cave. Quant aux indigènes, c’est à peine si on devinait leur présence. Ils n’étaient plus que de vagues formes mouvantes qui s’agitaient entre les arbres, des esprits de la forêt avec laquelle ils semblaient faire corps. Parfois l’un d’entre eux marchait sur une branche brisée et pointue. On entendait alors un cri qui perçait le silence angoissant de ce lieu, un cri qui disait qu’il y avait là-bas un être vivant. Savoir qu’il souffrait n’avait aucune espèce d’importance, seul comptait le fait que la vie existait toujours tout près de vous. C’était cela qui était rassurant : savoir que vous n’étiez pas le dernier représentant d’une espèce disparue à errer dans ces solitudes.
On marche donc ainsi trois jours et trois nuits, sans manger et sans prendre le moindre repos.
Chapitre 15
Enfin, un beau matin, par une aube rougeoyante, la petite troupe parvint devant une colline herbeuse qu’elle gravit avec plaisir, tout épuisée et exténuée qu’elle était. Quel soulagement ! On était enfin sorti du marécage ! Une fois arrivés au sommet, les hommes restèrent stupéfiés, tant la vue qui s’étendait devant eux était extraordinaire. Le fleuve était là, en contrebas, encerclant la colline sur trois côtés. Majestueux, calme, imposant, il roulait ses eaux jaunes avec détermination, sûr de sa force et indifférent à la présence des humains. On sentait qu’il en avait toujours été ainsi, depuis que le monde était monde, et on devinait qu’il en serait toujours ainsi, jusqu’à la fin des temps. Ce fleuve était un dieu, le dieu de l’Afrique équatoriale et rien ni personne ne pourrait jamais lui contester ce droit. Devant, par-delà le fleuve, la forêt vierge s’étendait à l’infini, jusqu’à la ligne d’horizon où elle semblait rejoindre le ciel, là où une brume de chaleur rendait les choses incertaines.
Qu’est-ce qu’il y avait là-bas, derrière cette ligne ? Voilà la question que se posait l’explorateur. C’était pour cela qu’il était venu ici, pour tenter de percer ce mystère et être le premier à comprendre l’énigme du continent noir. Mais déjà il savait qu’il ne découvrirait aucune réponse car même s’il parvenait à rejoindre cet horizon, dans ce lointain indéfinissable, il y aurait toujours derrière d’autres terres, d’autres paysages, lesquels laisseraient la place à des terres inconnues encore plus lointaines. ça n’en finirait jamais et toujours l’essence de cette terre sauvage lui échapperait. Il en récolterait des bribes et des morceaux, mais sa vérité profonde, jamais il ne l’atteindrait. Et à supposer qu’il eût le courage de parcourir ces milliers de kilomètres qu’il devinait devant lui, il finirait un beau jour par se retrouver devant l’Océan éternel, à savoir l’Océan Indien, qui baignait la côte orientale de l’Afrique. Il n’y avait pas de vérité, ou alors elle était insaisissable et indéfinissable. La vie elle-même n’était finalement pas autre chose. On naissait, on grandissait, on avançait en âge, on croyait devenir plus sage et mieux comprendre le monde, mais en réalité on ne comprenait rien, ne maîtrisait rien. La vie resterait un mystère insondable et jamais on ne saurait ce qu’on était venu faire sur cette terre ni même à quoi celle-ci ressemblait vraiment.
L’homme blanc soupira. En se retournant, il aperçut derrière lui l’immense marécage qu’il venait de traverser et il se sentit perdu et impuissant, encerclé par le fleuve d’un côté et par ce bourbier innommable de l’autre. Que pouvait-il encore faire à présent pour tenter de donner un semblant de sens à sa vie ? C’est alors qu’il vit que les porteurs noirs s’étaient rassemblés autour du « Vieux ». Celui-ci avait commencé à déballer un paquet qu’il était allé chercher dans les bagages. Il en sortit différents ustensiles étranges. Ensuite, il prit dans une outre en peau de chèvre une poudre blanche qui ressemblait à de la craie et qui en effet devait probablement être de la pierre calcaire pilée. Il en traça un large cercle autour de lui. Ensuite, d’une autre outre, il se mit à extraire une autre poudre, rouge celle-là, avec laquelle il dessina un deuxième cercle plus petit, à l’intérieur du premier. Enfin, il fit de même avec une poudre noire, qui ressemblait à de la cendre. Il se retrouva donc au centre de trois cercles. De là, il rejeta au loin les trois outres, histoire de bien faire comprendre à l’assemblée qu’il lui était interdit de sortir de ces cercles, qui constituaient donc des sortes de remparts magiques, au milieu desquels il se trouvait.
Coupé de la collectivité et pour ainsi dire coupé du monde, il se mit à psalmodier un chant étrange dans une langue tout à fait inconnue pour notre explorateur. Les porteurs noirs ne semblaient pas comprendre davantage le sens de ses paroles, à en juger par leur air étonné et craintif. Plus le sorcier chantait, plus ils ouvraient de grands yeux ébahis. Après un bon moment, le Vieux se mit à tourner sur lui-même, tout en continuant à psalmodier son chant étrange et énigmatique. Il tourna d’abord lentement, puis plus vite, puis de plus en plus vite, pour finir par entrer dans un mouvement giratoire extraordinaire. On n’aurait jamais cru qu’un homme pût ainsi pivoter sur lui-même aussi rapidement. Cela vous donnait le tournis. Dans l’assistance, la plupart des hommes se cachaient les yeux, autant pour échapper à ce tourbillon qui rendait fou que pour ne pas voir ce qu’il était interdit de voir. Car l’homme qui dansait au centre des trois cercles n’était plus un être ordinaire : il était entré dans une sorte de transe mystique et s’apparentait aux dieux.
A un certain moment, il cessa de chanter tout en continuant sa ronde folle. Il écarta les bras comme s’il allait prendre son envol, tel un grand oiseau de la nuit. Sa peau noire luisait de sueur et ses yeux hallucinés semblaient voir une réalité étrange et inconnue de tous. A la fin, il poussa un grand cri et s’abattit au centre des trois cercles. Les Noirs sortirent alors de leur torpeur et regardèrent, étonnés, cet être qui gisait là, demi-dieu foudroyé ou homme ordinaire vaincu pour avoir osé s’approcher des mystères sacrés. Il y eut un long silence, rempli d’angoisse, puis l’un des Noirs se mit à chantonner doucement, d’une voix grave, une mélodie étrange. Bientôt, il fut rejoint par un deuxième, puis par un troisième. A la fin, toute l’assemblée chantait, les yeux fixés sur le Vieux qui ne se relevait toujours pas, mais dont les membres commençaient à trembler d’une manière inquiétante. C’était un chant calme et puissant, qui apportait de l’apaisement et qui semblait sortir non pas de la bouche de tous ces hommes, mais du cœur même de la forêt. Sans en comprendre le sens, l’explorateur distinguait cependant une dizaine de mots qui revenaient sans arrêt comme un refrain lancinant et obsédant. Plus le chant continuait, plus il sentait monter en lui un calme et un bien-être inconnus. Il se trouvait bien, là, au milieu de cette nature, coupé du monde et encerclé par le fleuve et le marécage. Pour la première fois de son existence, il lui semblait comprendre le sens de sa vie. Ce qu’il comprenait, c’était qu’il faisait partie d’un tout, qui était l’univers, et que sa présence dans ce tout n’était pas gratuite. Il contribuait, lui et les autres autour de lui, à former cet univers dont il était un des éléments. Un peu comme une maison qui est constituée de briques. Prise en elle-même, une brique seule n’a pas beaucoup d’importance, mais pour ce qui est de l’édification et de la solidité de l’habitation, chaque brique est essentielle.
Pendant qu’il se faisait ces réflexions (mais c’était moins des réflexions qu’une conscience intuitive de sa place dans le monde) le Vieux, lui, s’était mis à gigoter de plus en plus fort. Les Noirs, cependant, continuaient leur chant sans s’inquiéter le moins du monde de ce qui lui arrivait. Il fallait croire qu’ils étaient habitués à ce genre de transes et que celles-ci faisaient partie des rites de sorcellerie. En attendant, celui qui gisait là, au milieu des trois cercles, était maintenant agité de soubresauts insolites et ses jambes et ses bras se tendaient dans toutes les directions. A la fin, c’est tout son corps qui se raidit, avant d’entrer dans des convulsions incroyables. Le chant du chœur, qui avait été jusque là calme et apaisant, se mit à monter d’une octave tandis que son rythme s’accélérait imperceptiblement. On aurait dit que plus l’homme à terre s’agitait, plus la mélodie du groupe tentait de le rejoindre dans sa transe. A un moment donné, le chant atteignit son point culminant, en une sorte d’apogée fascinante. Alors il s’arrêta net. Au même instant, au sol, le sorcier cessa de s’agiter et il resta plongé dans une sorte de torpeur proche du coma.
Un silence impressionnant succéda à toute cette agitation, un silence profond, proche de celui qui avait dû régner à l’origine du monde. Plusieurs minutes se passèrent ainsi. La rumeur du fleuve, en contrebas, venait parfois frapper l’oreille et rappeler que les dieux sauvages étaient là, tout proches. L’instant semblait magique. Puis soudain, dans le lointain, on entendit le son d’un tam-tam. D’abord timide et incertain, il prit bientôt de l’assurance. C’était un son grave et régulier, une sorte de rythme obsédant et lancinant. Puis un autre lui répondit, sur la droite, puis encore un autre, sur la gauche cette fois, puis d’autres encore, bien loin, issus du cœur même de la forêt. C’étaient les villages qui communiquaient. Comme s’ils avaient pu entendre le chant des hommes, ici, sur cette colline, comme s’ils avaient pressenti la mort du grand sorcier, ils s’étaient mis à dialoguer entre eux, à s’interroger, à se répondre. Et cette forêt sauvage qu’on croyait déserte ou simplement peuplée de bêtes sauvages, voilà qu’on se rendait compte qu’elle était habitée et que des dizaines de villages avaient trouvé refuge en son sein.
Les tam-tams parlaient toujours quand le chœur des hommes reprit un chant envoûtant. On aurait dit que ce chant synthétisait, sur cette colline sacrée, ce que les tambours tentaient d’exprimer dans la vallée, en contrebas. C’est alors que le vieux sorcier se redressa. Lui qu’on croyait définitivement perdu, voilà qu’il était maintenant debout et qu’il étendait les deux bras à l’horizontale, puis qu’il les levait vers le ciel, tel un oiseau qui va prendre son envol. Alors, subitement, au moment où on s’y attendait le moins, il bondit hors des trois cercles et se retrouva dans l’assistance. Il se pencha, prit quelque chose dans ses bagages, et s’approcha de l’homme blanc. Arrivé à un mètre de lui il s’arrêta et lui tendit un objet étrange. C’était une patte de léopard desséchée et comme momifiée. « Prends », lui dit-il en français, « toi aussi tu es un dieu, comme le léopard du conte ».
Chapitre 16
L’homme blanc prit donc la patte de léopard sous les applaudissements de toute l’assemblée, puis on se mit en route, non sans avoir au préalable piétiné les trois cercles magiques, comme pour signifier que le contact avec les forces occultes était maintenant rompu. Ce contact n’était plus nécessaire puisque le pouvoir surnaturel était maintenant ici, parmi les humains, représenté par un des animaux les plus dangereux, le léopard. Et encore, seule la patte de ce félin était présente, symbole de vitesse, de souplesse et de capacité à tuer. Tout en marchant, l’explorateur considérait d’ailleurs avec respect les griffes puissantes qui dépassaient des poils et il imaginait sans peine les blessures que celles-ci pouvaient infliger.
On descendit la colline en direction du fleuve et quand on fut arrivé tout en bas, on se trouva devant un village qui était resté invisible jusque là, collé comme il était aux contreforts de la montagne. En voyant arriver le sorcier, tous les habitants sortirent de leur case pour lui souhaiter la bienvenue. On n’aurait jamais cru qu’un village aussi petit pût comporter autant d’habitants. Il en sortait de partout et certains accouraient même de la forêt toute proche. Quand on se retrouva sur la place, il y avait bien deux cents personnes qui acclamaient les arrivants avec des cris étranges. Tout le monde s’attroupait autour de l’explorateur, surtout les enfants, car ils n’avaient jamais vu d’homme blanc.
On se mit à chanter et à danser. Puis on prépara un immense festin qui dura jusqu’au soir. Quand la lune fut levée, on alluma un grand feu au centre de la place et la fête commença. Les hommes étaient d’un côté et les femmes de l’autre, par groupes d’une dizaine de danseurs. On s’approchait du groupe du sexe opposé en mimant la démarche précautionneuse du léopard ou au contraire en se contorsionnant dans tous les sens. Une fois qu’on était à deux doigts de se toucher, on s’évitait de justesse et on repartait vers l’arrière avec des cris sauvages. Puis deux autres groupes entraient en scène et tout recommençait. Cela dura comme cela pendant des heures. L’explorateur, à qui on servait copieusement une boisson fermentée à base de banane, regardait tout cela d’un œil de plus en plus trouble. Il se sentait bien. Etrangement bien. Lui qui depuis le début de son expédition cherchait l’impossible et ne le trouvait pas ; lui qui espérait découvrir un sens à toute chose et en était réduit à marcher de plus en plus loin, jusqu’à faire reculer l’horizon ; lui qui n’en finissait plus de voyager pour tenter de saisir l’essence de cette terre sauvage et vierge qu’était l’Afrique et qui voyait toujours de nouveaux paysages s’ouvrir devant lui, voilà que pour une fois il se sentait apaisé. Car la vérité de ce continent se trouvait ici, sur cette place, dans ce village, au milieu de ces hommes et de ces femmes qui dansaient, superbement heureux.
Il regardait cette joie de vivre avec étonnement et satisfaction. Le rythme endiablé de toutes ces rondes frénétiques le séduisait, tout comme la nudité des femmes, lesquelles ne portaient généralement qu’un simple pagne. C’était fascinant de voir ceux-ci se soulever en cadence, laissant deviner ce qu’ils cachaient plus ou moins bien par ailleurs. L’explorateur n’en revenait pas devant une telle impudeur naturelle. Ces sauvages, finalement, avaient conservé une manière de vivre plus proche de la nature et ils ne s’embarrassaient pas de toutes les conventions et de toutes les lois stupides des hommes civilisés. Et ils semblaient heureux, tellement heureux… Son regard d’homme s’attarda longuement sur les seins nus qui s’agitaient érotiquement quand les danseuses sautillaient sur place. C’était beau. Tous ces corps noirs dévêtus, brillant à la clarté de la lune et à la lumière du feu. L’Afrique était ici, cette Afrique à laquelle il rêvait depuis son adolescence à Bordeaux.
Il revoyait les déjeuners dominicaux dans la grande salle à manger familiale, avec ses tantes outrées et qui prenaient un regard désapprobateur quand il affichait clairement son athéisme. Qu’est-ce qu’il avait étouffé dans cette atmosphère bourgeoise et bien pensante ! Combien de fois n’avait-il pas rêvé de la beauté du monde qui se trouvait forcément ailleurs que dans cette salle à manger de Gironde… Alors il était parti et il l’avait cherchée pendant des années. Mais il avait eu beau s’aventurer au cœur de l’Afrique et être le premier Blanc à pénétrer jusqu’ici, il n’était jamais parvenu à l’atteindre totalement. Cette beauté se dérobait toujours, du moins en partie, et elle fuyait devant lui, se retrouvant toujours plus loin, derrière l’horizon. Alors il avait remonté le fleuve, mais cela avait été pareil. Ce qu’il cherchait n’était jamais là où il était lui, mais un peu plus en amont… Or voilà que pour la première fois il lui semblait être parvenu à rejoindre ce qu’il cherchait. La vie était là, toute simple, dans ce village perdu dans une boucle du grand fleuve, inconnu de tous, sauf de lui. Il écoutait le tam-tam et ses sons effrénés, il regardait les danses et leur rythme endiablé, il observait les femmes et leur poitrine provocante. Alors il sut qu’il avait trouvé et qu’il ne repartirait plus.
Vers deux heures du matin, quand la fête toucha à sa fin, le chef du village, accompagné du sorcier, s’avança vers lui, tenant par la main une jeune fille souriante. Il sourit aussi et sans un mot il la suivit. Ils traversèrent la place principale, s’engagèrent dans les ruelles entre les habitations et finalement pénétrèrent dans une case. Il referma sommairement la porte de bambous et là, dans la nuit équatoriale, il connut enfin le bonheur et l’apaisement.
Le long du fleuve, dans la chaleur étouffante, les grenouilles-buffles croassaient à qui mieux mieux, les yeux tournés vers les étoiles.
Fin de la nouvelle.
La mère grand ; histoire de famille
On rendait assez souvent visite à la grand-mère. Après avoir roulé longtemps sur les voies rapides et les nationales, on se retrouvait sur de petites départementales avant de finir notre voyage sur des routes communales particulièrement étroites. Celles-ci n’avaient de routes que le nom, tant elles étaient sinueuses et dans un état pitoyable. A vrai dire, c’étaient plutôt de simples chemins qui escaladaient les collines comme ils pouvaient, franchissaient les rivières sur des ponts d’un autre âge et pénétraient dans des forêts qui semblaient n’avoir jamais de fin. Quand, après deux bonnes heures, on arrivait dans le village, au bout du monde, il fallait encore le traverser de part en part pour atteindre la maison de l’aïeule, en pleine nature, à l’entrée du bois.
La mère-grand était née à la charnière des siècles et elle avait connu toutes les guerres. Elle en parlait toujours comme si cela avait été hier. Nous, nous l’écoutions, à la fois fascinés et incrédules. Elle racontait comment en 1914 les Allemands avaient rassemblé sur la place tous les hommes du village et en avaient fusillé une vingtaine au hasard, pour l’exemple, à cause d’un officier teuton qu’on avait retrouvé dans un champ de blé, une balle de fusil de chasse entre les deux yeux. Elle racontait sa peur à elle, dans son ventre de fille, quand elle croisait dans la campagne un groupe de soldats. Ils s’arrêtaient, la dévisageaient en riant, puis lui tenaient des propos étranges dans une langue qu’elle ne comprenait pas. Alors elle s‘enfuyait comme elle pouvait, sous l’hilarité générale. Elle avait quatorze ans. Elle nous racontait aussi les fermes incendiées par représailles, les femmes forcées et les cadavres des hommes qu’on retrouvait mutilés.
Plus tard, la paix revenue, elle s’était mariée avec un paysan que je n’avais jamais connu, mais qui portait le même nom que moi puisque c’était mon grand-père. Sa photo trônait dans la chambre à coucher, au dessus du lit. Jeune, la moustache fière, un peu engoncé dans le costume neuf acheté pour ses noces, il avait des airs de guérillero mexicain et on avait du mal à imaginer la vie simple qu’il avait menée ici, vivotant de sa petite exploitation agricole. Le jeune ménage n’était pas riche, ça non, mais cela n’avait pas empêché les enfants de naître les uns après les autres. Il y en avait sept quand une autre guerre éclata. Les mêmes soldats au parler étrange arrivèrent par les mêmes routes. La différence, c’est que cette fois ils étaient motorisés. Ils foncèrent sur Paris, qu’ils atteignirent en quelques semaines. Pour le reste, au village, on recommença avec les privations bien connues. La mère-grand me racontait qu’elle avait couru après un soldat allemand qui lui avait volé sa dernière poule. Malgré ses vociférations, celui-ci resta de marbre. « C’est la guerre », se contenta-t-il de dire dans un français approximatif, et pour couper court à la discussion, il coupa le cou du volatile devant mon aïeule médusée, qui hurla de plus belle. Pourtant, le soir, le même soldat vint apporter un peu de bouillon « pour les enfants » et la famille se consola en dégustant ce qu’il restait de sa poule.
Quand elle avait bien raconté, quand elle nous avait bien captivés et qu’elle voyait que nous allions passer la nuit à l’écouter, la grand-mère levait la séance et allait se coucher. Souvent je restais seul dans la cuisine, à lire un peu (dans les chambres sans chauffage, il faisait trop froid). Je m’installais auprès du poêle à bois, les pieds généralement posés sur une bûche car le carrelage était glacial. J’écoutais le silence. On n’entendait rien, absolument rien, dans cette campagne reculée. Aux alentours, c’était la nature à l’état pur. Si on entrouvrait la porte et qu’on risquait un pas dehors, on tombait dans la nuit absolue, une nuit d’encre semblable à celle des origines du monde. Au mieux, en prêtant l’oreille, pouvait –on entendre le cri de quelque bête sauvage, dans un endroit indéterminé de la forêt : probablement un renard qui glapissait ou alors une horde de sangliers qui fouinaient le sol. Mieux valait refermer la porte que de s’aventurer dans cette obscurité hostile. Je reprenais mon livre, mais le silence environnant était tel que je relevais bientôt les yeux, attentif au moindre bruit qui m’aurait indiqué que la vie continuait malgré tout. Mais non. Le renard s’était tu et les sangliers devaient être partis ailleurs. Je restais seul au monde, avec cette impression étrange que plus rien n’existait sauf moi-même. Quand il pleuvait, on entendait juste le gargouillis de l’eau qui tombait de la gouttière. C’était un bruit monotone et apaisant, qui me permettait de me situer dans le temps et dans l’espace.
Plus tard, bien plus tard, quand le feu dans le poêle s’était éteint et qu’il ne subsistait que quelques braises qui ne dégageaient plus la moindre chaleur, j’éteignais tout et montais me coucher. C’était une vieille maison et pour atteindre ma chambre il fallait d’abord traverser celle de la grand-mère. Je ne voulais pas la réveiller, c’est pourquoi je n’allumais pas la lampe. Je gravissais les marches à tâtons, essayant d’éviter tout bruit. Parfois, une marche craquait sous mes pas et toute la nuit semblait alors résonner comme si quelque cataclysme s’était produit .
- Cheminement : Les cheminsque l’on emprunte ne mènent jamais nulle part - Juil 5, 2014
- Promenade en forêt ; un moment merveilleux - Juil 5, 2014
- Une maison à la campagne - Juil 5, 2014