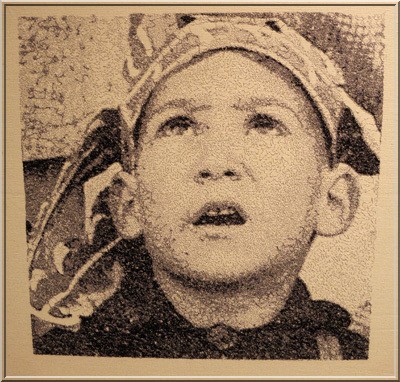[tab name=’Histoire de ride’]
Histoire de ride
Le monde s’organise en vaste casino dont le manche, à la triple cerise, invente le vainqueur, accable le vaincu. Tout, peu à peu, s’enrobe d’une gelée rosie qui aseptise la différence. Regarde, mon enfant, regarde la misère marquée au sourire résigné. Observe la détresse dans la pupille morte. Passer dans la rue, accroché à l’autre qui parle dans un combiné. Absence à la foule, à peine touchée par celui qui chancelle sur le trottoir. Une torche brûle jusqu’à la dernière parcelle d’humanité, au nom d’une incroyable escroquerie : l’information, que d’aucuns rebaptisent communication. Mais, communiquer, c’est mettre en commun. C’est partager. Et le monde, inculte, qui a oublié, croit qu’aller butiner des potins, est festin partagé. Un voile diaphane, vaporeux, endort peu à peu les consciences. Je voudrais me souvenir : apprendre à voir, au-delà du regard.
Mourir, peu à peu, de maladie quotidienne. Le temps d’avant ressemble à une nébuleuse glauque. Et le temps à venir se dissout, vide, impalpable. Il n’est que fumeuse illusion. Mourir d’être. Au matin, alors que le regard s’étonne d’un ciel, le cœur se navre de battre encore. Monte l’incoercible douleur des larmes contenues. Il va falloir sourire, alors que saigne l’âme. Il va falloir dire, alors que les mots refluent. Il va falloir jouer, alors qu’un cercueil serait refuge. Mourir d’être soi. Comme cendre qui achève de se dissoudre. La braise rougeoie à peine, à peine de chaleur exhalée, un dernier souffle. Et les minutes se prennent pour des heures, qui ne passent pas. Et le monde bouscule, qui crie et qui s’agite quand la solitude reste le havre salvateur. Assourdi des jugements, lapidaires, indifférents, qui blessent, le cœur cherche à s’arrêter. Mais le corps est solide. L’insoutenable légèreté du quotidien écrase la lumière qui vacille dans la nuit. Epuisé, on se pose la question : à quoi sert de vivre encore. A rien. Mourir.
[/tab]
[tab name=’Amour mort’]
Nostalgie : ma mémoire et moi – Lettre à un amour mort
Moi, je vous aimais… comme ça, pour vous, sans rien attendre de plus qu’un sourire, de temps en temps. Avec, juste, l’envie de vous entendre, aussi. Quand les « r », dans votre bouche roulaient, tantôt sonnant, tantôt vrombissant, je fondais telle une midinette à son premier soleil.
Je vous aimais laid au matin, les yeux battus par vos frasques et l’haleine chargée des bulles champagnisées de la veille. Votre anatomie mal foutue, toute en membres, déséquilibrée entre l’étroitesse de la carrure et la lourdeur du plus bas, m’attendrissait. Je trouvais une harmonie douce à votre allure déglinguée.
Je vous aimais amant égoïste, si peu préoccupé de mon corps et de mes désirs. Vous étiez l’envahisseur de mon ventre-réceptacle, agrippé à votre jouissance, indifférent à la mienne. Pas du genre que les dames adoubent « bon amant ». Vous ne connaissez pas les femmes, ni même la sensualité de la peau, l’ardeur du regard ou l’abandon dont elles sont capables. Vous êtes, à l’instar de nombre de vos congénères, un consommateur à peine averti. Qui déballe le paquet sans prendre le temps d’en humer le contenu, sans offrir la grâce de caresses savantes, l’audace de baisers aventureux.
Je vous aimais ne parlant que de vous et de vos rêves, pliant chacun des êtres de votre entourage à vos ambitions artistiques, ou à vos envies de reconnaissance, ou à vos arrivismes sociaux… Je vous aimais dans votre suffisance et cette incroyable certitude de valoir mieux, de valoir plus.
Je vous aimais fantasque et incertain, vous mentant même à vous-même et, par là, me bernant aussi. Je vous aimais pour vos promesses non tenues qui témoignaient, aussi, d’une poésie naïve. Que votre regard noir se pose sur une fleur, qu’il s’égare au gré de quelques mélodies guimauves, et je vous aimais.
Je vous aimais alors même que vous n’évoquiez QUE ce que vous attendiez de moi. De petits gestes, si quotidiens, qui ne seraient dédiés qu’à vous entourer d’une douceur attendrie. Jamais une fois, vous ne m’avez offert un peu de votre temps. J’entends par là le fait de me presser deux oranges. Vous étiez celui qui exige et qui ne donne pas.
Je vous ai aimé longtemps, et longtemps je vous ai attendu. Parfois, je vous croise allant votre chemin, acceptant une adulation de pacotille, vous émerveillant de mauvaises photos que vos fans bricolent.
Ah ! Bel amour d’une année, vous sombrez dans la médiocrité, dans le tout venant, dans l’alambiqué. Vous vous perdez sur des chemins faciles. Vous êtes déjà perdu.
Vous êtes, comme tant d’hommes, égoïste. Et je ne vous aime plus.
[/tab]
[tab name=’Jour de marché’]
Mignardises et macarons : jour de marché

Elle, elle garde un éternel sourire bien qu’ayant parfaitement conscience de n’être qu’un meuble parmi d’autres. C’est qu’elle se fabrique une vie personnelle, un jardin des délices cultivé avec art…
Chaque vendredi est jour de marché. Et chaque vendredi, elle part en trottinant, tirant son chariot à légumes, pour faire ses emplettes. A neuf heures pétantes, elle déambule entre les étals, posant son œil expert sur les petites merveilles qu’offrent les empilements colorés. Elle salive à l’avance. Elle imagine la cuisine toute personnelle qu’elle mitonnera, et des frissons délicieux lui parcourent les reins. Elle laisse négligemment courir sa main sur les concombres luisants, sur les carottes alignées, sur les tomates rebondies…
Et ce jour là, ce sont les bananes qui atterrissent dans son panier. Des petites mûres et gouteuses, de jolies bananes des Antilles encore fermes mais sucrées, de solides plantains, savoureuses en gratins exotiques. Elle achète encore quelques victuailles et vers la fin de la matinée, elle rejoint ses pénates. Elle étale ses provisions sur la table et lustre chacun des fruits avec délicatesse. Elle sirote un petit muscat ambré et liquoreux pendant qu’elle s’affaire tranquillement. Lorsque tout est bien rangé, elle boucle la maison, la plonge dans la pénombre, coupe la sonnerie du téléphone. Elle se réfugie dans la salle de bains.
Elle est délicate, elle n’aime que les odeurs sucrées. Elle plonge dans un bain dont le subtil parfum épice sa peau laiteuse de pêche et d’orange. Chacun de ses gestes est mesuré, ses mains effleurent ses seins lourds jusqu’à ce que la mousse les gaine. Elles savonnent son joli minou frisoté. Et là, ma foi, ce qui se tricote entre les bananes dorées et l’intimité de la belle restera à l’ombre des volets clos…
Comme chaque vendredi, son homme rentrera, dégageant une odeur de femelle trop parfumée. Il sera de joyeuse humeur parce que son patron vient souper, et qu’il compte sur les talents de cuisinière de son épouse. Sa carrière s’étoffe gentiment. La dodue n’apprécie pas ce monde d’hommes dont le pouvoir est la seule passion. Mais, d’égale humeur, le sourire toujours accroché à son minois de chat, elle composera un repas fin…
Ce sera un colombo de porc accompagné d’un gratin de plantains, et bananes flambées pour le dessert, se dit-elle, en contemplant, comblée, les fruits dont la peau s’éclaire légèrement, humide, au seul rayon de soleil qui transperce les persiennes.
[/tab]
[tab name=’Manque du désert’]
Le manque du désert
Le désert manque quand il a capturé le cœur ondoyant de celle qui sommeille. D’un soleil impitoyable il chauffe le sable sous le pied. Il évapore l’eau qui survit encore dans l’été, et qui ouvre une fraîcheur au sein de l’oasis. Il marque au fer la chair et l’âme, de ses ombres dorées, de ses calmes bleutés.
Au désert, le regard se perd dans une immense étendue d’ocre et de blanc. Au désert, l’ouïe erre de silence apaisé jusqu’au souffle léger d’un vent tiède. Au désert, l’esprit se perd dans les méandres arrondis de dunes dansantes. Celle qui sommeille rêve. Elle se rêve dissoute. Elle se rêve errante, marcheuse essoufflée. Un bout de vie arénicole. Elle oubliera ses chagrins épuisés, qui ne savent plus pourquoi ils pleurent. Elle lavera à chaque grain de silice chaque souvenir trop porté. Elle abandonnera jusqu’à sa pulpe aux morsures des rayons d’un astre cruel, comme un fruit qui mûrit. Celle qui rêve repose. Et dans son repos, elle apprivoise l’absence. A jamais touchée, éprise jusqu’au plus profond de ses os d’un désert qui manque, elle attend que revienne le temps. Et son cœur ondoyant sommeille, amoureux claquemuré.
Ma très chère Amina,
Mardi, était cette expo dont tu avais tant envie de voir les photos… Alors voilà, j’ai fabriqué un petit album où se trouvent quelques-unes de ces photos, et non pas toute la collection, hélas ! Si Christine me les transmet, je les rajouterai, promis juré !
Depuis un an, nous entretenons, toi, qui pourrais être ma fille, et moi, un dialogue, commencé dans une voiture et que nous n’avons pas cessé de nourrir, depuis. C’est le miracle de l’internet que de pouvoir, par-delà la mer, faire que les mots vivent. Et que les amitiés se tissent.
J’ai aimé ton pays, je sais que je peux revenir demain et que l’accueil sera, comme la première fois, tout choyé de rires et de confidences. De ce que j’ai pu en vivre, lors de mes voyages, que ce soit chez toi, en Algérie, au Maroc ou encore en Egypte, ce peuple, le peuple sémite sait souvent, bien mieux qu’un occident prosterné au pied du dieu « profit », accueillir le promeneur curieux, comme moi.
Il est rafraichissant de voir que nous pouvons, bien au-delà des religions, des avis politiques, des couleurs de peau, peu à peu nous apprendre, et cet apprentissage est l’avenir de l’humanité.
Cette exposition « Traverser sans la voir », Christine l’a voulue comme un retour aux temps de son enfance, elle qui a grandi dans ton beau pays, et qui en est partie lorsque cette guerre terrible a fini par emporter dans les vents de l’Histoire, des histoires de vie… Elle est revenue aux sources familiales, aux archives et aux mots, pour bâtir ce moment de pur bonheur qu’est ce récit de toile. Des broderies monumentales dont une partie est exposée au Consulat d’Algérie, ici, chez moi. Une exposition qui a été montrée à Québec et qui partira à Oran. Je souhaite qu’elle puisse voyager dans ton pays, cette exposition, parce qu’elle consacre ce que les politiques ont bien du mal à faire, la réconciliation silencieuse que portent les humbles.
« Le cercueil ou la valise » ? Mais ce fut faux. 200.000 français d’Algérie sont restés au pays et ont pu continuer leur vie, devenant d’ailleurs, algériens. C’est encore une fois la parole confisquée par quelques extrémistes pieds noirs, qui parlent plus fort et plus violemment, qui sont d’ailleurs pensionnés sur nos impôts, qui ont empoigné les tribunes, interdisant par-là aux modérés, ceux qui veulent que cessent les mensonges et que commence le temps de la reconnaissance, de tendre une main apaisée vers vous. N’oublions pas… nous sommes des frères, des sœurs, dispersés, mais des frères et des sœurs…
Je te souhaite, Chère Amina, à toi, à toute cette jeunesse si vivante que j’ai rencontrée à Bab El Oued, de beaux jours et que vous puissiez étayer l’espoir infini de nos pays réconciliés…
[/tab]
[tab name=’Hair le dimanche’]
Hair le dimanche
Ah ! Ville rigolote qui conjugue le dimanche, ses dimanches en de populaires agapes. L’étrange étrangère apprécie son quartier où se fabriquent de petites usines à rêves. Où se bricolent de chaleureuses rencontres qui parlent de peinture et de musique.
Ce jour, sur la place, se tenait une brocante d’artistes, un marché de l’échange de toiles. Il y avait là tous les styles picturaux qui se côtoyaient, une buvette, un orchestre. De quoi éclairer un ciel que la grisaille chagrinait.
Un concours avait été organisé, qui consistait à croquer un détail, un lieu, une ambiance. Un dizaine de barbouilleurs, amateurs ou professionnels, s’étaient frottés à la toile.
Du coup, elle avait transformé sa chambre en atelier, passant une dizaine d’heures le nez dans la couleur, les doigts dans l’acrylique, pour un résultat très moyen. Jamais elle ne saurait mettre les images qui peuplent ses émotions, en coups de pinceaux. Quand les formes lui échappent, les mots s’inscrivent. On ne peut pas vouloir tout maîtriser. Les mots la comblent, ses rêves sont d’amour, ils ne sont pas au format portrait ou paysage.
Même Médor s’est baladé libre sur la place, se faufilant de stand en stand, reluquant sous les jupes des filles, reniflant le jambon ou le beurre. Sympathique, ce foutu canidé, curieux comme un singe et timide comme un paresseux, pataud et dodu.
Les œuvres barbouillées par tous ceux qui avaient eu le courage de se coller au défit, ont fait l’objet d’un classement. Bien sûr, la cathédrale flamboyante ne pouvait pas arriver dans les premières, il y avait tant de talents qui s’étaient alignés. Mais l’important, c’était d’être là, de savourer cette chaleureuse convivialité qui raconte que sa ville pense au nord, et s’assoie aux portes du midi.
Même la buvette se donnait des allures de guinguette, un petit vin blanc et la saucisse bien chaude dans sa moutarde. Ben voui, à peindre sans arrêt parce qu’on ne sait pas, on en oublie de se sustenter.
Du coup, c’est bien stupide de haïr le dimanche, surtout quand on peut guincher sur du musette. Sans doute que l’étrangère rêvait d’entendre et de contempler un beau chanteur marocain qu’elle a croisé, un jour, sur un bateau… une voix et quelques notes de musique… un regard et un sourire. Mais c’est une autre histoire.
[/tab]
[end_tabset]