Le Livre de Raison d’un roi fou d’André Fraigneau écrit en 1947 plonge le lecteur dans l’imaginaire et la psyché de Louis II de Bavière en proposant un bel ouvrage sous forme de journal intime revisité…
Louis II de Bavière et ses métamorphoses
Ce « Journal » imaginaire du souverain, sans doute le plus beau livre jamais inspiré par Louis II de Bavière (Ludwig II), a été écrit par André Fraigneau en 1947.
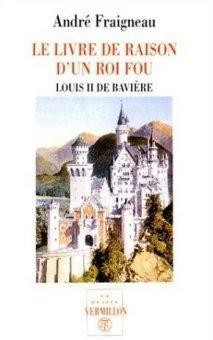
Le journal intime recomposé par André Fraigneau commence en 1861, alors que Ludwig a 16 ans, pour s’achever en 1885. Tout au long des trois périodes qu’il intitule Le Cygne, Le Soleil et Le Paon, Ludwig-Fraigneau fait pénétrer son lecteur dans les méandres de son cœur solitaire tout entier tourné vers les hautes sphères de l’art contre les servitudes de la vie.
« Je suis mangé par le silence, la solitude et quelques rêves tenaces » (p.22), « je crois que je suis né en disant non » (p.27). Ce refus de l’existence revient d’ailleurs comme un leitmotiv lancinant, comme la blessure la plus profonde : « Je haïrai mon père et ma mère, cette stupide Hohenzollern, en ce monde-ci et en l’autre, pour un crime aussi impardonnable: m’avoir tiré à la vie. » (p.81)
Deux nouvelles naissances cependant lui rendent plus supportable la première. C’est d’abord la rencontre avec Wagner, c’est ensuite le voyage à Paris et la découverte, la révélation même, de la grandeur royale à travers Louis XIV en qui il se projette avec frénésie. Devant le spectacle grandiose de Versailles, il dit : « Pourquoi pensais-je invinciblement au Walhalla ? au seul Walhalla possible pour le premier être humain après les dieux, le roi ? ». (p.85)
Dernier vestige de l’absolutisme royal de droit divin, Ludwig est malgré tout conscient que son personnage n’a plus sa place en ce bas monde. Il a beau dire : « Depuis que je suis roi, je n’ai imaginé une fois que je puisse être mortel » (p.41), ou encore : « C’est nous qui commandons aux circonstances » (p.64), il n’est pas dupe. Et lorsqu’il s’avise soudain d’être lucide sur lui-même, c’est-à-dire de consentir à se situer vraiment par rapport aux choses temporelles, il devient émouvant, pathétique de vulnérabilité et de faiblesse : « Abdiquons, abandonnons ce monde incompréhensible » (p.64), formule désespérée et défaitiste qui donne son sens secret à l’appropriation d’une formule célèbre : « Mon royaume n’est pas de ce monde » (p.113).
Souverain absolu, cela implique que le bon vouloir du roi a force de loi. Ludwig n’a cure que sa position lui commande d’obéir à ses devoirs envers son peuple ; il ressort de ce journal, de ce « Livre de raison », une impuissance totale à assumer son pouvoir autrement que pour lui-même. Sa fatuité et son mépris, cette certitude périmée et absurde de la supériorité du sang, apparaissent bien puérils : en fait, Ludwig, qui n’avait pas accepté son existence, était ensuite resté en enfance.
Louis II de Bavière et Wagner, une passion absolue
Wagner occupe naturellement dans l’ouvrage de Fraigneau une place importante à l’instar de ce que fut leur relation abordée en profondeur dans le livre de Jacques de Decker, Wagner. « Il est fait pour être adoré, admiré, non aimé » (p.60), fait-il écrire à Ludwig. Dès 1861, la musique de Wagner le transporte dans cet univers immatériel où il se complaît déjà, et les états d’âme que provoque en lui la représentation de Lohengrin à Munich, sont proches de la transe. Le miracle a été d’entendre dans la musique de Wagner et de ressentir à travers son art tout ce qu’il attendait : « Mais ce soir… comment ce Wagner avait-il noté ma voix ? Je me sentais volé et à la fois compris, consacré, raffermi. » (p.23) Et encore : « C’était la voix, la voix exacte, que j’avais entendue, à treize ans, dans une galerie du château pendant que je jouais tout seul, délicieusement, à me taire, et cette voix, je me souviens, naissait de ma contemplation… C’était donc une voix à moi » (p.23).
Par rapport à Wagner, Ludwig ne sera pas dupe : il continuera à lui prodiguer ses faveurs comme s’il n’avait pas remarqué sa nature de rapace. Il se devait de servir jusqu’au bout l’homme qui avait su créer ce que lui-même, Ludwig, recelait au fond de son cœur.
L’évolution de sa propre personne transparaît aussi dans le livre de Fraigneau. Au début, Ludwig est parfaitement conscient d’être irrésistible : « On tâche de me cacher le pouvoir de cette beauté. C’est elle, pourtant, qui désarme mes ennemis intimes » (p.28). Son refus de la laideur est d’ailleurs catégorique et entier, au point que sa façon d’exprimer ce qu’il est devenu à la fin de sa vie est d’une rare force :
« Cette nuit, aux flammes des bougies, j’ai contemplé longuement mon visage dans un miroir. J’évitais depuis longtemps cette confrontation… Je me découvre tel que l’exercice de la vie m’a fait. Plutôt m’a défait… Mes dents, gâtées par les sucreries, je les dissimule, assez bien d’ailleurs… J’ai grossi. Je suis énorme, gigantesque. Si je me rencontrais au coin d’un bois, je me ferais peur… Les romantiques ont l’imagination courte, ils ont inventé des monstres laids : Quasimodo, Vautrin, Fafner. Je suis un monstre beau. C’est pire. » (pp. 184-185)
Louis II de Bavière et l’amour…
Reste la vie amoureuse de Ludwig qui, dans l’esprit du roi, semble avoir été considérée comme une faiblesse. André Fraigneau a le talent de ne jamais insister lourdement tout en sachant suggérer. Un soir de printemps de 1865, dans la montagne où il est seul avec son piqueur Wölk, Ludwig ramène celui-ci, endormi contre un arbre, jusqu’à son lit.
« J’entends encore le halètement de Wölk réveillé par mon baiser (sans doute il avait feint le sommeil) et qui, soudain, embrasé comme un feu de camp, me guidait, me pressait, m’étourdissait. Il me semblait que tout le ciel et la campagne résonnassent de notre activité médiocre, touchante de maladresses. » (p.54)
Il y aura ensuite l’épisode avec le valet Hornig raconté avec un discret brin d’humour. D’autres allusions suivront, mais le sens de la faute, le remords, la conviction de céder à des faiblesses indignes de lui, accompagnent souvent ses expériences.
Livres sur Louis II de Bavière :
- Les châteaux fabuleux de Louis II de Bavière
- Louis II de Bavière ou le roi foudroyé
- Louis II de Bavière de Jacques Bainville
- Louis II de Bavière : le roi des lunes
- Louis II de Bavière – Le Roi bâtisseur de rêves
- Louis II de Bavière et ses psychiatres: Les garde-fous du roi
- Louis II de Bavière et Elisabeth d’Autriche, âmes soeurs
■ Editions de La Table Ronde, Collection La Petite Vermillon, 1997, ISBN : 2710306441
Lire aussi : Le Roi Vierge, de Catulle Mendès
Ces articles ont été publiés à l’origine sur le blog: « Culture & questions qui font débats »
- Edouard II, Christopher Marlowe - Juil 5, 2014
- Le Roi vierge de Catulle Mendès ou la tragédie de Louis II de Bavière - Juil 5, 2014
- Le Livre de Raison d’un roi fou ; Louis II de Bavière vu par André Fraigneau - Juil 5, 2014
