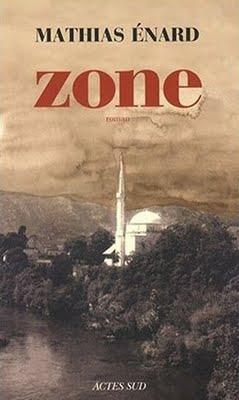Zone de Mathias Enard a été lauréat du prix du Livre Inter 2009, second prix littéraire reçu par ce romancier français, qui offre au lecteur une plongée dans l’histoire du bassin méditerranéen. Un roman atypique de par la construction de l’intrigue et l’absence quasi totale de ponctuation, ce qui laisse un goût d’inachevé et rend l’oeuvre difficile d’accès.
A Milan, un homme traverse la gare vers les quais d’embarquement. Ses papiers sont au nom d’Yvan Deroy même si l’homme qui répond à ce nom est en réalité un néo-nazi interné en hôpital psychiatrique pour schizophrénie violente. Il est heurté par un clochard coiffé d’un bonnet de lutin et avec une clochette au poignet gauche qui lui propose en italien « une dernière poignée de main avant la fin du monde? »
Notre homme, visiblement troublé, repart avec nervosité, serrant un peu fort d’une main crispé la poignée de sa valise. Car notre homme s’appelle en réalité Francis Servain Mirkovic; il est Franco-Croate, agent de renseignement français, porteur d’une valise qui rassemble ses cinq ans de travail passés au service de l’Etat français, contenu qu’il va vendre au Vatican à Rome afin de changer de vie.
Il monte enfin dans le train, s’avachit sur son fauteuil alors que le paysage commence à défiler derrière sa fenêtre, et, écrasé mentalement par une gueule de bois de la veille qui lui a fait raté son avion entre Paris et Rome et qui l’a obligé à prendre le train, ses pensées défilent alors, réminiscences de 20 ans passés dans la « Zone », c’est-à-dire la Méditerranée, de la guerre des Balkans aux montagnes de l’Atlas algérien, des cabarets sordides d’Alep aux chambres d’hôtels de Venise, d’Alexandrie, de Barcelone en compagnie de ses maîtresses – Marianne, Stéphanie, Sashka – jusqu’aux couloirs aux bruits étouffés des services secrets français.
Il serait difficile de résumer Zone car ce roman est écrit tout entier sans point (sauf dans quelques chapitres qui sont des mises en abîme d’un autre roman, un récit de la guerre du Liban): il est un fil continu ininterrompu comme le fil de la pensée du narrateur qui suit le cheminement nocturne du train lancé à travers la campagne italienne entre Milan et Rome. On ne résume donc pas Zone, car on ne résume pas le cheminement d’une pensée; on le suit. On ne résume pas non plus un voyage en train; on ne peut qu’en faire l’expérience, l’expérience du temps qui passe et de l’espace traversé, franchi, avalé. Wikipedia m’a appris qu’on appelle cette technique stylistique le courant de conscience ou flux de conscience.
Imprégné tout entier de Méditerranée, Zone puise une inspiration explicite chez Homère dans l’Iliade surtout mais aussi chez James Joyce. Je pense notamment à Ulysses et à ce passage qui m’avait bouleversé la première fois que je l’avais lu, sur la quatrième de couverture de l’édition de poche, et qui me fait dire régulièrement que je devrais lire Ulysses mais à chaque fois je m’arrête devant cette « cathédrale de la prose », intimidé, je n’ose franchir son imposant portait de critiques et d’éloges et d’études :
O cet effrayant torrent tout au fond O et la mer la mer écarlate quelquefois comme du feu et les glorieux couchers de soleil et les figuiers dans les jardins de l’Alameda et toutes les ruelles bizarres et les maisons roses et bleues et jaunes et les roseraies et les jasmins et les géraniums et les cactus de Gibraltar quand j’étais jeune fille et une Fleur de la montagne oui quand j’ai mis la rose dans mes cheveux comme les filles Andalouses ou en mettrai-je une rouge oui et, comme il m’a embrassée sous le mur mauresque, je me suis dit après tout aussi bien lui qu’un autre et alors je lui ai demandé avec les yeux de demander encore oui et alors il m’a demandé si je voulais oui dire oui ma fleur de la montagne et d’abord je lui ai mis mes bras autour de lui oui et je l’ai attiré sur moi pour qu’il sente mes seins tout parfumés oui et son cœur battait comme fou et oui j’ai dit oui je veux bien Oui.
Zone dessine, à travers ce monologue intérieur, le canevas d’un espace à la corruption millénaire, religieuse, putrescence du Mal, hanté par les vies qui l’ont peuplé, par les multiples guerres (mondiales, d’Espagne, d’Algérie, du Liban, des Balkans), massacres (par les islamistes en Algérie, par toutes les armées après une bataille), des déportations et génocides (arménien, juif, tsigane), tortures (des islamistes par la Syrie, l’Egypte, l’Algérie…) qui hantent la conscience du narrateur, conscience que le lecteur habite par le biais de ce roman.
Ainsi, Zone est tout entier hanté par les fantômes, par les cadavres, les victimes. Vertigineuse mise en parallèle entre les morts de la Shoah, ceux de la guerre de Troie, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d’Algérie et de toutes les autres guerres qui ont nourri l’impressionnant charnier qui sert de fondations aux civilisations qui ont grandi autour de la Méditerranée. Car depuis la guerre originelle de Troie, mère de toutes les guerres, celle qui a dispersé Enée et les autres fils portant leurs pères sur leurs dos autour de la Méditerranée, et qui a engendré un cycle sans fin de vengeances, le fil est continu pour Francis lorsqu’il combattait en Yougoslavie :
… de l’assaut que l’on contient ou celui qu’on lance, et dans notre position, sans hommes ni matériel, il était difficile de décider ce qui était le plus effrayant, si c’était d’attendre les tanks ou aller à leur rencontre, nous lancions une contre-offensive pour libérer Vukovar il allait falloir nous battre comme des lions pour reprendre d’abord le village de Marinci sur la route de Vinkovci, ma première bataille d’envergure, et il en était de même pour Andrija – il compensait son inexpérience par un courage hors du commun et patientait bravement sous les obus alors que je croyais devenir fou, la bouche sèche, sourdingue, en pensant que bientôt il faudrait y aller, aller déloger l’armée yougoslave de ses positions et bondir sur leurs blindés par petits groupes armés de quelques RPG9, affronter leurs mitrailleuses leurs mortiers leurs fusils, nous étions prêts, les bottes bien lacées comme Intissar la vaillante, prêts à repousser les Serbes grands dompteurs de cavales jusqu’aux remparts de Belgrade, je tremblais sous les coups de canon, le 3e régiment d’artillerie yougoslave nous arrosait à raison d’un tir toutes les vingt ou trente secondes, l’aube pointait sur les champs extraordinairement plats face à nous, boue et maïs pourrissant sur pied, couchés, une plaine marronnasse dans la grisaille du ciel encore tiède en ce début d’automne, pas du tout le jour rêvé pour mourir, pas du tout… (p. 384-385)
Francis, le narrateur que l’on suit dans ses réminiscences hantées par le souvenir de la guerre qu’il a fait, possédé par les guerres qu’il n’a pas fait, est un concentré, une incarnation de cette Zone. Fasciné par le fascisme, par les fanatiques, par les combattants, par les morts, par les victimes, il ne cesse de rassembler des notes, d’accumuler des faits sur ces massacres, et notamment ceux sur lesquels il a été amené à enquêter pour le compte du Service. Et c’est ce qu’il porte dans sa mallette qu’il veut vendre au Vatican. C’est en quelque sorte le résumé de sa vie, son CV, son fardeau. En lui se reflètent tous les guerriers, tous les morts.
… et je me dis que j’aurais beau prendre une barcasse à destination de l’Europe en clandestin je resterais moi-même, Francis fils de ses parents, fils de la Croate et du Français, de la pianiste et de l’ingénieur, comme on dit Achille fils de Pélée, Ajax fils de Télamon, Antiloque fils de Nestor, nous allons tous reposer au Leucé l’île Blanche à l’embouchure du Danube, tous les fils de, fils du destin des pères, qu’on les appelle Faim, Courage ou Douleur, nous ne deviendrons pas immortels comme Diomède fils de Tydée transformé en paon, nous allons tous claquer, dévisser notre billard et trouver une belle sépulture, Mohamed Choukri le traîne-misère avare et généreux est déjà dans la terre, Burroughs le tireur d’élite et Lowry l’ivrogne aussi, même le pape va passer la crosse à gauche incessamment, et moi ensuite, peut-être faudrait-il abandonner le combat et se laisser aller à la mort, à la défaite, s’admettre vaincu et reprendre les noirs vaisseaux et l’ironie comme Cervantès, mais vers où, c’est trop tard, plus d’arrêts avant la destination finale, il va falloir aller jusqu’au bout, il va falloir se porter jusqu’à Rome et continuer la bataille, le combat contre les Troyens grands dompteurs de cavale, contre moi-même mes souvenirs et mes morts qui m’observent en grimaçant… (p. 367-368)
Ainsi le périple funèbre se poursuit-il, flux de conscience qui sert d’examen de conscience d’une humanité qui se dit civilisée, à travers le cas d’un homme qui les représente tous. Un homme perdu dans ses identités multiples, héritées de grands-parents touchés par le Destin, réceptacle d’héritages de la Croatie fasciste des oustachis et de l’Espagne franquiste. Un homme hanté par la violence des autres mais aussi celle qu’il a commise, un homme incapable d’aimer les femmes, sorte de déesses aux épithètes divins qui ont éclairé sa morne vie, ses ténèbres intérieurs lorsqu’il a essayé de les aimer : Marianne aux blancs seins, Stéphanie la raisonnée, Sashka la silencieuse.
… il y a des amours qui résistent à la mort, des promesses, surtout dans les livres, dans les livres et les pièces de théâtre, les Palestiniens vont s’éparpiller dans la Méditerranée, qui à Tunis, qui à Alger, qui en Syrie, Arafat le gris tentera de revenir au Liban à Tripoli en 1984 avec ses combattants avant que les Syriens ne le renvoient à la mer d’un bon coup de pied au derrière, comme on le ferait avec un vieux chien, pauvre Intissar, Ahmad pauvre type victime de son désir et de sa violence, victime qui fait des victimes, comme nous autres en Bosnie, comme les Achéens aux belles cnémides, ceux qui saccageront Troie tueront les enfants et emmèneront les femmes en esclavage, moi je n’ai sauvé personne, ni en laissant traîner mon flingue par terre ni en ressuscitant d’entre les morts, personne, ni Andi, ni Vlaho, et personne ne m’a sauvé, ni Marianne ni Stéphanie ni Sashka la blonde, je me demande si Raphaël Kahla me ressemble, pourquoi écrit-il ces histoires terrifiantes, a-t-il essayé d’étrangler sa femme comme Lowry, ou l’a-t-il assassinée comme Burroughs, incita-t-il à la haine et au meurtre comme Brasillach ou Pound, peut-être est-ce une victime comme Choukri le misérable, ou un homme trois fois vaincu comme Cervantès – qui lavera mon corps une fois mort, elle est bien triste cette histoire, bien triste, une ville qui tombe, qui s’effondre, une ville se brise comme du verre entre les mains de ceux qui croient la défendre, Barcelone en 1939 Beyrouth en 1982 Alger en 1992 Sarajevo en 1993 et tant d’autres avec les masses de combattants promis à la mort ou à l’exil… (p. 446)
Roman-fleuve, donc, roman-monde, le roman de la Méditerranée, Zone est extrêmement ambitieux: Homère, Joyce sont ses mânes, la Méditerranée plusieurs fois millénaire sa scène, et l’Histoire est le chœur de cette tragédie qui a pour héros ce narrateur; et nous, le public, qui le regardons accomplir ce périple final en train jusqu’à sa destination ultime: Rome l’immortelle, le centre de la Méditerranée et donc du Monde, où le Monde prend fin. Au milieu de ces siècles d’horreur, ou plutôt au sommet de cette pyramide de cadavres, de torturés, d’exécutés, de déportés, de gazés, de mitraillés, on se demande comment l’homme peut-il trouver encore la force, l’espoir, la volonté de continuer à vivre. Et c’est sans doute là où l’ambition de Mathias Enard se transforme en succès impressionnant: il nous montre, à l’instar de Cervantès qui puise Don Quichotte dans la bataille de Lépante et dans son emprisonnement à Alger, que l’homme est capable de trouver la beauté dans toutes ces vies qui s’agitent vers la mort, malgré la mort ou, comme le dit Achille lui-même, grâce à la mort. On passe de cet impossible à ce possible emporté malgré nous par la force de cette phrase continue qui est toujours d’une lecture évidente. Ainsi, Mathias Enard nous montre que ses modèles ont transcendé voire sublimé l’horreur pour créer de la beauté et lui-même cherche à reproduire cet exploit, comme si c’était pour lui la seule condition, l’impérieuse condition pour donner du sens à cette Zone qu’il aime et pour laquelle il éprouve une fascination/ répulsion qui n’est pas sans interroger la condition humaine.
Exorcisme de la violence qui a coloré de rouge les flots de la mer ? Peut-être, car Mathias Enard répond lui-même à la question qu’il pose : pourquoi a-t-il écrit ce roman ? Sans doute est-il lui aussi fasciné (au sens grec) par cette violence qui affleure sans cesse derrière l’écume des vagues de la Méditerranée. Sans doute est-il hanté par les morts de la Zone. Et en tant qu’humain il livre donc une méditation funèbre sur ce que cela signifie. Et en tant qu’artiste, en tant que romancier, il essaie de donner un sens à ces ombres. D’ailleurs, l’ombre tutélaire de Joyce surgit dans le roman, car lui aussi a arpenté la Zone, et Mathias Enard paie son dû aux mânes de ses illustres précurseurs :
… Joyce disait au moment de la parution de Finngean’s Wake que la nuit rien n’était clair, Joyce si sage professeur dans la journée devenait un ivrogne concupiscent le soir, obscur à lui-même, obsédé par l’argent, par un Dieu dont il ne voulait pas, par des pulsions inavouables, de toutes les jeunes filles qui ressemblaient à la sienne, fragile et aliénée tel Yvan Deroy le fou, Joyce souhaitait écrire un morceau d’ombre, six cents pages d’un rêve de tous les rêves, toutes les langues tous les glissements tous les textes tous les fantômes tous les désirs et le livre est devenu vivant mouvant scintillant comme une étoile dont la lumière parvient longtemps après la mort et cette matière se décomposait dans les mains du lecteur, inintelligible poussière car Joyce n’osait pas s’avouer ses désirs secrets, la violence qui l’habitait et son amour coupable pour sa fille, il était obligé de se dissimuler dans l’écriture, pauvre petit bonhomme à l’estomac perforé et aux yeux malades… (p. 425)
Lecture longue, roman de la Méditerranée, Zone est en quelque sorte comme cet espace, difficile d’accès. La lecture est également non pas ardue (le style, on l’aura vu, est limpide) mais guidée par les chapitres qui sont des chants qu’il faut lire de bout en bout. C’est une lecture lancinante: un sentiment diffus me hante, j’ai vécu en quelque sorte une expérience en suivant la pensée de Francis le narrateur, de Mathias l’écrivain.
Pourtant, c’est avec un sentiment d’inachevé que je repose ce roman, car si deux dauphins bondissants dans les vagues scintillantes au large d’Alexandrie offrent une image satisfaisante qui montre, par contraste, la noirceur de celui qui cherche à les approcher, je dois bien reconnaître ne pas avoir bien su à qui s’adressait l’appel des hauts parleurs dans le hall d’embarquement de l’aéroport. Etais-je alors celui à qui ce pauvre type me demandait de l’emmener car j’avais fini par le comprendre ou, au contraire, étais-je devenu celui qui demandait à ce qu’on l’emmène tant on avait de compassion pour ma misérable personne?
(Note en forme d’aveu face à mon inculture: la quatrième de couverture, « le point de vue des éditeurs », fait référence à Michel Butor et La Modification en évoquant Zone. Pourquoi? N’ayant pas lu ce roman (ni aucun autre de Michel Butor), je sens que je suis du coup passé à côté de quelque chose.)
- Les Onze de Pierre Michon (Editions Verdier) - Août 20, 2014
- Chroniques de Jerusalem de Guy Delisle ; une naïveté construite - Juil 5, 2014
- La mort de Staline: l’agonie de Staline en BD selon Fabien Nury et Thierry Robin - Juil 5, 2014